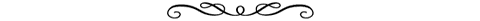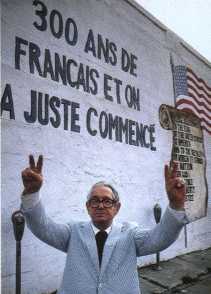|
| Louisiane |
|
Histoire de la Louisiane
américaine
À partir de 1803
(États-Unis)
|
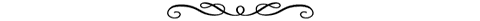
| Remarque: cette
page
portant sur la Louisiane a pu
bénéficier de la collaboration de MM. David Cheramie
et David-Émile Marcantel, tous deux du CODOFIL.
|
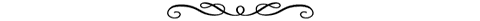
Préalable facultatif
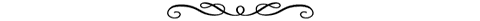
1
Les nouveaux propriétaires
américains en 1803
|
 |
Le 20 décembre 1803, William Charles Cole
Claiborne
(1775-1817) et James Willinson entrèrent à La Nouvelle-Orléans au nom du
Congrès américain. Les nouveaux propriétaires instaurèrent immédiatement les
règles du jeu. En tant que gouverneur, Charles Claiborne mit sur pied une nouvelle administration,
qui comprenait un Conseil législatif composé de six
Français et de sept Américains (l'année suivante, de cinq Français et de huit
Américains), puis un système judiciaire formé de trois juges anglophones
unilingues.
Le nouveau gouverneur gagna progressivement la confiance des Créoles
blancs de la Louisiane en répartissant équitablement les postes
entre francophones et anglophones, en imposant que les procès soient
tenus dans les deux langues et en publiant une version bilingue du
code civil.
En 1804, une loi du Congrès américain divisa l'ensemble du territoire en deux,
isolant les francophones dans les bayous du Sud et rattachant la partie nord à
d'autres futurs États de l'Union, à la disposition des Anglo-Américains. Par la suite, seule une petite partie sud du territoire a pu conserver le nom de
Louisiane (Louisiane
actuelle). Le 1er janvier 1804, la colonie française de
Saint-Domingue proclama son indépendance, et devint officiellement , la première république noire libre.
Aussitôt, près de10 000
Blancs et Noirs vinrent se réfugier en Louisiane. Les Blancs parlaient un
français régional des Caraïbes, les Noirs employaient le créole qui
s'introduisit en Louisiane. |
Puis, le
10 mars 1804, la totalité de la «Grande Louisiane» passait sous
l'administration des États-Unis, qui doublèrent leur superficie grâce à l’acquisition de la Louisiane
occidentale. Le 18 mai 1804, Bonaparte devenait empereur des Français sous le
nom de Napoléon Ier. En 1805, on comptait 3551 Blancs à La
Nouvelle-Orléans, 1556 esclaves libérés et 3105 esclaves; seuls 350 habitants
blancs parlaient anglais.
En 1807, le territoire d'Orléans fut divisé en 19
paroisses (d'où "parishes" en anglais), une originalité dans les les divisions
administratives aux États-Unis, qui préféraient le terme de «comté» ("county"),
ce qui en dit long sur l'influence de l'Église catholique sur cet État. Deux
années plus tard, l'Administration américaine réussit à faire venir 3100
immigrants anglophones. En 1810, la population de la Louisiane était passée à
quelque 76
000 habitants, encore à grande majorité francophone. D'ailleurs, la
Nouvelle-Orléans demeurait encore
une ville francophone et réellement française. Des Français venus de France y
ouvraient des restaurants, des commerces, des théâtres, et l’opéra y était
florissant; on y imprimait des quotidiens et des revues en français, alors que
les les écrivains y apportaient une production littéraire abondante et
originale.
Ce fut une
période prospère pour le français colonial en Louisiane, mais la guerre civile
allait porter un coup mortel au français; les planteurs blancs passeront à
l'anglais et s'américaniseront.
Pour les Louisianais, la vente de leur territoire
allait provoquer un grand nombre de changements, qui entraînera une
américanisation de leur coutumes et de leur langue, et les plongera dans
l'assimilation.
2 Un nouvel État américain
 |
Après l'acquisition de la Louisiane française, le
gouvernement américain scinda aussitôt ce vaste territoire en deux parties
inégales: le Nord, avec 88 % de la superficie, fut appelé "Louisiana Territory" (Territoire de la Louisiane),
le Sud, avec 12 % de la superficie, devint l'"Orleans Territory" (Territoire d'Orléans). Le 26 mars 1804, une loi fut
adoptée à cet effet : la Act erecting Louisiana into two territories, and
providing for the temporary government thereof («Loi érigeant la Louisiane en
deux territoires et prévoyant le gouvernement provisoire de celle-ci»).
Voir la carte de la
partition de 1804. Le
Territoire d'Orléans devint l'État de la Louisiane le 30 avril 1812, devenant ainsi le
18e État américain, mais la Louisiane
américaine était devenue un petit État de 134 264 km², contre plus de 2,2 millions
pour la Louisiane française de 1802. Quant au "Territoire de la
Louisiane", il devint aussi en 1812 le "Territoire du Missouri".
Puis ce fut la partition
de 1812 avec la création du territoire du Missouri,
l'ancienne Louisiane. |
En effet, allèrent être créés dans ce même territoire du
Missouri ou une partie de celui-ci (voir
la carte) :
1. l'État du Missouri (1821);
2. l'État de l'Arkansas (1836);
3. l'État du Texas (1845);
4. l'État de l'Iowa
(1846);
5. l'État du Minnesota (1858);
6. l'État du Kansas (1861);
7. l'État du Nebraska (1867); |
8. l'État du Colorado
(1876):
9. l'État du Dakota du Nord (1889);
10. l'État du Dakota du Sud (1889);
11. l'État du Montana (1889);
12. l'État du
Wyoming (1890);
13. l'État de l'Oklahoma (1907);
14. l'État du Nouveau-Mexique (1912) |
Au moment de son entrée dans l'Union en 1812, la Louisiane
était le premier et le seul État américain dans lequel un
groupe
non anglophone, les
descendants d’Acadiens — les Cadiens ou Cajuns en anglais — et de Français, constituait une majorité
linguistique. Grâce au juriste Louis Moreau-Lislet, un Code civil plus complet
(que le précédent basé sur la Coutume de Paris) reposant sur le Code
Napoléon fut adopté par le législateur du nouvel État. Ce code avait été
rédigé en français, puis traduit en anglais.
Cependant, il n'en fut pas ainsi pour la Constitution de
l'État. Non seulement, elle fut rédigée uniquement en anglais, mais elle ne
comportait aucune disposition linguistique à l'égard des francophones, alors
qu'elle protégeait les droits des anglophones. En effet, l'article 6 de la
Constitution de 1812
énonçait que toute loi
et tout document officiel devaient être publiés dans la langue «dans laquelle
est rédigée la Constitution des États-Unis», c'est-à-dire en anglais:
|
Constitution of 1812
[texte original]
Article 6
That
all laws that may ber passed by the legislature, and the public records
of the State, and the judicial and legislative written proceedings of
the same, shall be promulgated, preserved and conducted in the language
in wich the constitution of the United States is written. |
Constitution de 1812
[traduction]
Article 6
Que toutes les
lois qui peuvent être adoptées par la législature, ainsi que les archives
de l'État, les procédures judiciaires et les débats législatifs soient promulgués, conservés et publiés dans la langue dans laquelle
est rédigée la Constitution des États-Unis. |
Il est évident que la prédominance du français en Louisiane
pouvait causer certains problèmes à Washington et que l’Assemblée de l’Union ait cru bon
de faire en sorte que la Constitution louisianaise soit plus «adaptée» à la
situation nord-américaine. Néanmoins, on peut se demander pourquoi les 23 représentants
francophones (sur un total de 41: soit 56 %), qui rédigèrent la Constitution de 1812, n'ont
pas profité de leur majorité pour se doter ou se garantir de droits spécifiques en tant que
francophones. Selon les historiens, les Créoles blancs qui ont rédigé la
Constitution auraient totalement manqué de «vision historique». Imbus
d'eux-mêmes, vivant complètement à l'heure de l'Europe et éprouvant le plus
grand mépris pour les autres cultures (dont celle des Américains), ils croyaient que le fair play
anglo-saxon était suffisant pour protéger leurs valeurs culturelles. Pour la
plupart d'entre eux, il paraissait plus important de se joindre immédiatement à l'Union, sans
causer de difficulté, quitte à modifier par la suite la Constitution et
l'ajuster à leur jeune démocratie. Pour les historiens, les Créole blancs
furent ou bien naïfs ou bien totalement inconscients. Cette constitution est restée en vigueur jusqu'en 1845.
2.1 Un petit répit pour le français
Ces événements n'ont pas empêché, d'une part, que la législature adopte des lois en
français, d'autre part, que de nombreux
fonctionnaires, dont le second gouverneur Jacques Villeré (de 1816 à1820),
continuent d'ignorer la langue anglaise. La Louisiane continua de publier ses documents
officiels en français et sa législature adopta le bilinguisme comme une sorte
de nécessité
pratique. C'était le fair play américain qui joua pour un temps en faveur des
francophones. Toutefois, la Cour suprême de la Louisiane, de son côté, a
souvent invalidé plusieurs lois parce qu'elles avaient
été adoptées uniquement en français, donc inconstitutionnelles.
Lorsque Napoléon fut vaincu à Waterloo (Belgique) en
1815 et fait prisonnier par les Anglais qui l'envoyèrent en exil à
Sainte-Hélène,
de nombreuses riches familles créoles blanches de La Nouvelle-Orléans proposèrent aux
Anglais de libérer Napoléon contre rançon et de le laisser vivre en
Louisiane; les États-Unis refusèrent de soutenir la demande des Louisianais, tandis que les
Créoles blancs se sentirent abandonnés par leurs nouveaux
maîtres qu'ils trouvaient «arrogants» et «mal élevés».
Grâce à l'initiative du président
James Monroe, le
marquis de La Fayette (1757-1834), ou
simplement
«Lafayette» pour les Américains, visita
en 1825, soit du 9 au 15 avril, La Nouvelle-Orléans et la nouvelle
place Lafayette; les Créoles francophones l'acclamèrent et Thomas Jefferson
proposa à «Lafayette» de devenir le premier gouverneur de la Louisiane.
Après un séjour d'un an et demi au
États-Unis, Lafayette avait visité 182 villes (dans les États de New-York,
du Massachusetts, du New Hampshire, de la Pennsylvanie, de la Virginie, du
Maryland, des deux Carolines, de la Géorgie et de l'Alabama) et reçu du Congrès
américain une indemnité financière de 200 000 $ ainsi que 12 000 hectares de
terres en Floride, en remboursement des frais engagés par l'officier français
sur ses propres deniers. Partout, en tant que «hôte de la Nation», le marquis de
La Fayette fut accueilli avec un enthousiasme et des hommages
extraordinaires. La résolution du Congrès américain confirmait également que Lafayette
avait
«volontairement avancé de son argent et risqué sa vie pour la liberté des
Américains». L'université Princeton lui décerna à cette occasion un
doctorat honoris causa, attribué en 1790.
Lors de ses voyages, il visita des villes aux noms
français, dont Lafayette, Napoléonville, Bâton-Rouge, Carondelet et Saint-Louis.
Il se fit servir des discours en anglais, en français, en «patois acadien» et en
créole. En dépit de son statut de héros national, le célèbre marquis, alors âgé
de 68 ans, préféra poursuivre sa carrière militaire en France. La Louisiane
l'avait ébloui, mais elle ne correspondait pour lui qu'à un rêve réalisé alors
qu'il n'avait que vingt ans. Encore aujourd'hui, La Fayette est, avec W.
Churchill, l'étranger le plus populaire et le plus reconnu par les
États-Unis. John Adams, qui fut le deuxième président des États-Unis de
1797 à 1801, voyait en La Fayette un mélange de patriote français et de patriote
américain: «He is a mongrel
character of French patriot and American patriot.» Il voulait ainsi démontrer
les sentiments hybrides du marquis, à la fois français et américain.
En 1825, le nouveau Code pénal de l'État
de la Louisiane, préparé par MM. Edward Livingston, Louis Moreau-Lislet et Pierre Derbigny, fut
rédigé en français; il était presque entièrement calqué sur le Code de Napoléon
et concrétisait une forme de bilinguisme juridique. Les tribunaux ont même
établi que, en cas de conflit d'interprétation, la version française devait
prévaloir. La même année, la Louisiane a aussi adopté le Code de
procédure civile (1825), qui rendait le français obligatoire (art. 172 et art. 2903):
| Article
172 [traduction] Cette pétition doit être
rédigée dans les langues anglaise et française, si le français est
la langue maternelle de l'une des parties. |
Article
2903
[traduction] Cet avis sera publié par le
shérif, en anglais et en français, à savoir par affiches aux lieux
accoutumés, dans les endroits où il ne s'exprime point de gazettes, ou
en le faisant insérer par trois fois en anglais et en français, dans
au moins une des gazettes des lieux où il s'imprime des papiers
publics. |
Le Code de procédure civile de l'État
de la Louisiane (en français et en anglais) suivit en 1839. Par la suite, en 1843, Alexandre Mouton
(1804-1882), pour la première fois un francophone d'origine acadienne, fut élu
gouverneur de la Louisiane. M. Mouton était un homme riche et instruit, il avait
été sénateur et possédait plus de 120 esclaves; il fut président de la Convention
de sécession de 1860, qui constitua un
gouvernement séparé: la Confédération sudiste.
Au cours de cette période, les Louisianais purent utiliser
le français sans entraves. La plupart des riches Créoles blancs envoyaient
encore leurs fils dans les grandes écoles de France afin de les familiariser
avec la culture et les mœurs françaises. En général, Les Créole blancs
continuaient de vivre en marge de leur nouveau pays devenu américain et
méprisaient ouvertement la langue anglaise. Rares étaient les parents
louisianais qui eurent la clairvoyance de faire apprendre l'anglais à leur
progéniture. Au contraire, l'affection des Créoles pour la langue française
tourna au fanatisme. Beaucoup de grands propriétaires louisianais ne toléraient
même pas qu'on prononçât devant eux un seul mot anglais, celle langue considérée
comme «barbare», tandis qu'ils ne se formalisaient nullement lorsque leurs
enfants parlaient le créole louisianais des Noirs. Il n'existe que fort peu de
témoignages du français parlé par les Louisianais de l'époque. L'ornithologue et
portraitiste américain d'origine française, John James
Audubon (ou Jean-Jacques), écrivit vers 1803 dans son journal ce commentaire peu élogieux sur le
français des Louisianais:
|
C'est une race d'animaux qui
ne parle ni le français ni l'anglais, ni l'espagnol correctement, mais
un jargon composé des mots les moins purs de ces trois langues. |
Évidemment, comme au Canada, les Louisianais parlaient un
français archaïsant et qui pouvait paraître «vieillot» pour John James Audubon qui ne
devait pas faire de différence entre les Créoles Blancs, les Acadiens (ou Cadiens) et les Chacalatas (Indiens).
2.2 L'instauration du bilinguisme
En 1830, La Nouvelle-Orléans comptait 46 000 habitants en
majorité francophones. Dix ans plus tard, La Nouvelle-Orléans était devenue la
quatrième ville la plus importante des États-Unis avec 102 000 habitants. En
1860, la ville allait atteindre 168 675 habitants. Pendant ce temps, les
francophones ne représentaient plus que 7 % de la population de La
Nouvelle-Orléans, alors que les Irlandais (15 %) et les Allemands (12 %) étaient
majoritaires et plus enclins à parler anglais que français. Des situations
similaires ont dû se répéter dans plusieurs autres villes. Cette époque se
caractérisa par l'instauration d'un bilinguisme social. En raison de leur
religion, les Irlandais entrèrent en contact avec les francophones; mais de par
leur langue ils devinrent aussi les interlocuteurs naturels des anglophones. De
plus, l'augmentation des unions mixtes entre francophones et non-francophones
entraînèrent l'accroissement de locuteurs bilingues ou anglophones. Beaucoup de
nouveaux immigrants, dont la langue maternelle n'était ni l'anglais ni le
français, apprenaient l'une ou l'autre des langues, mais souvent les deux.
Toutes les communautés linguistiques avaient intérêt à apprendre l'anglais et le
français devenus des langues indispensables. Dans ces conditions, les planteurs
blancs francophones se sont mis à se tourner vers l'anglais afin de bénéficier
des avantages de la langue anglaise et aussi pour se distinguer des Créoles
noirs avec lesquels ils ne voulaient plus être associés dans la nouvelle
structure sociale. Par voie de conséquence, ils envoyèrent leurs enfants dans
les écoles anglaises afin qu'ils puissent jouir d'avantages par rapport aux
Noirs. Cependant, les populations francophone et anglophone profitaient chacune
des bénéfices de l'apprentissage de leur langue respective. Ce sera différent
après la guerre de Sécession.
La
Constitution de 1845 fit de
la pratique du bilinguisme une exigence pour la
reconnaissance des lois linguistiques des francophones de la Louisiane, alors
qu'en 1847,
une loi autorisait l'instruction bilingue dans les écoles publiques de l’État.
L'article 132 de la Constitution de 1845 (auquel correspond l'article 129 de la
Constitution de 1852) proclamait ce qui suit:
|
Constitution of 1845
[texte original]
Article 132
The Constitution and laws of this
State shall be promulgated in the French and English languages.
Article 104
The Secretary of the Senate, and Clerk
of the House of Representatives, shall be conversant with the French and
English languages ; and members may address either house in the French
or English language. |
Constitution de 1845
[traduction]
Article 132
La Constitution et les lois de l'État sont
publiés en anglais et en français.
Article 104
Le secrétaire du Sénat et le greffier de la
Chambre des représentants doivent connaître le français et l'anglais.
Les membres des deux Chambres peuvent s'exprimer en français ou en
anglais. |
En réalité, ces articles ont été insérés afin de faire
taire les protestations ou «injustices» de la part des Créoles blancs au
chapitre des lois et règlements. Les Créoles ne formaient plus que 35 % des
représentants de la Convention (contre près de 60 % en 1812). Le chapitre VII se
rapportait à l'éducation. On mit sur pied un ministère de l'Éducation qui
devait administrer les écoles depuis le primaire jusqu'à l'université.
Cependant, la question linguistique ne fut guère soulevée. Il faut
dire que ce problème ne touchait que fort peu les «grandes familles» créoles,
qui envoyaient généralement leurs enfants poursuivre leurs études en France.
Le 31 juillet 1852,
les Louisianais se dotèrent d'une nouvelle
constitution,
alors que les Créoles ne représentaient que 20 % des rédacteurs (25 francophones
sur les 114 membres de la Convention). Cette fois-ci, le texte officiel présentait
une version française et une version anglaise. Les articles 100 et 101
revêtent un intérêt particulier en ce qui concerne la langue juridique
louisianaise:
|
Constitution of 1852
[texte original]
Article 100
The laws, public records, and the judicial and legislative
written proceedings of the State shall be promulgated,
preserved and conducted in the language in which the
Constitution of the United States is written.
Article 101
The Secretary of the
Senate and Clerk of the House of Representatives shall be
conversant with the French and English languages, and
members may address either house in the French or English
language.
|
Constitution de 1852
[traduction]
Article 100
Les lois, les archives, les
procédures judiciaires, les délibérations législatives sont rédigées et
promulguées dans la langue dans laquelle est écrite la Constitution des
États-Unis.
Article 101
Le secrétaire du Sénat et
le greffier de la Chambre des représentants doivent savoir l'anglais et le
français, et les membres de l'Assemblée générale pourront prendre la
parole dans l'une ou l'autre Chambre, en français ou en anglais. |
Le chapitre VIII portait sur l'éducation et la création
d'écoles publiques gratuites. L'article 136
énonce ce qui suit:
|
Constitution of 1852
[texte original]
Article 136
The General Assembly shall establish
free public schools throughout the State, and shall provide for their
support by general taxation on property or otherwise; and all moneys so
raised or provided shall be distributed to each parish in proportion to
the number of free white children between such ages as shall be fixed by
the General Assembly. |
Constitution of 1852
[texte original]
Article 136
L'Assemblée générale établira
des écoles gratuites et publiques dans tout l'État, et devra pourvoir à
leur entretien au moyen d'une taxe générale sur les propriétés ou
autrement. Le montant ainsi perçu ou obtenu de toute autre façon sera
distribué entre les différentes paroisses proportionnellement au nombre
d'enfants libres et blancs qu'elles refermeront, et de l'âge indiqué par
l'Assemblée générale. |
On constate que, comme dans la Constitution précédente
(1845), la
question linguistique n'avait été guère soulevée. Le texte constitutionnel
de 1852 est
suivi des Règlements de la Chambre des représentants (1852) rédigés en
français. Voici ce
qu'on y retrouve au sujet de la langue:
|
Article 67
[texte original français]
Il sera du devoir du commis
aux minutes (sic) de la Chambre d'écrire de sa propre main la partie anglaise du
journal de cette Chambre, et le greffier surveillera avec soin le journal
écrit dans les deux langues.
Article 68
Le greffier lira le journal
tous les jours sur les feuilles sur lesquelles elles sont écrites; et
après qu'elles auront été ainsi lues et corrigées, et pas auparavant, ces
minutes (sic) seront enregistrées dans le livre et, s'il est
nécessaire, elles seront corrigées et amendées sous la section de la
Chambre, et une copie dans les deux langues en sera fournie à l'imprimeur
sous la signature du greffier, le lendemain du jour où elle aura été lue,
à 10 heures.
Article 69
Le greffier sera
responsable de la rédaction du procès-verbal dans les deux langues. [...] |
Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Louisianais
ne semblaient guère s'intéresser à protéger leur langue française. Ils allaient en payer
le prix bientôt!
2.3 La fin de la francophonie officielle
Comme d'autres États esclavagistes, la Louisiane fit sécession en 1861.
Celle-ci ne voulait pas libérer ses esclaves qui travaillaient dans les
plantations et assuraient les richesses de ces exploitations gérées par les
Créoles blancs. L'Assemblée louisianaise proclama son indépendance par 112 voix contre 17, le 12 février
1861, sous le nom de République de la Louisiane. Quelques jours plus tard, les
troupes fédérales entrèrent en Louisiane et commencèrent à investir les forts
Pike, Jackson et St. Philip. Les autorités louisianaises firent appel au
patriotisme des Créoles blancs pour combattre le Nord. En 1864, on compta plus
de 50 batailles sur le seul territoire de la Louisiane. Par la suite, les
constitutions républicaines radicales, imposées par les troupes de l’Union en
1864 et 1868, réussirent à abolir le statut officiel du français en Louisiane. Il s'agissait
sans aucun doute d'une forme de représailles de la part des confédérés envers
la Louisiane qui entretenait des contacts réguliers avec la France de
l'époque. De plus, non seulement la France soutenait la Louisiane dans le conflit, mais
bon nombre de familles créoles (blanches) fortunées envoyaient leurs fils faire des études
à Paris ou à Bordeaux, et mariaient leurs filles à des Français fraîchement
débarqués à La Nouvelle-Orléans; la Louisiane était le dernier État à
sortir de la Reconstruction (l'époque d'après-guerre: The Reconstruction)
même si c'était le premier État, en raison de
l'importance du port de La Nouvelle-Orléans, à se faire «saisir» par
l'armée de l'Union. Cela dit, à cette époque, beaucoup de Créoles blancs
étaient déjà linguistiquement assimilés. Le bilinguisme français-anglais
qui constituait auparavant un avantage et un atout se transformait à cette
époque en handicap. De peur d'apparaître antipatriotiques et antiaméricains, la
plupart des francophones préférèrent rejeter leur héritage linguistique et
culturel. Les Noirs francophones firent de même.
Alors que la Louisiane était occupée par les troupes de
l'Union, le major-général N. B. Banks ordonna que la Constitution de 1852 devait
être révisée. Cette fois-ci, les représentants de la Convention chargés de
rédiger le texte constitutionnel ne comptaient que 18 % de francophones,
partagés entre les Créoles et les Acadiens. De plus, les représentants furent
soumis, en tant que vaincus, à la cause nordiste (dont l'abolition de
l'esclavage). C'est pourquoi la
Constitution de 1864 (la
"Constitutional Convention of 1864"),
d'inspiration très nordiste, supprima toutes les
dispositions juridiques en faveur du français. L'anglais devint la seule langue
officielle pour les lois, documents et procès-verbaux, alors que
l'article 142 de la Constitution stipulait, pour la première fois, que
l'enseignement primaire devait se faire en anglais; quant à la variété du «français colonial»,
elle disparut presque complètement.
Parmi les 155 articles constitutionnels, il n'était fait mention nulle part de la langue des
tribunaux.
|
Constitutional Convention of 1864
[texte original]
Article 142
The laws, published records and
judicial and legislative proceedings of the State shall be
promulgated and preserved in the English language; and no laws shall
require judicial process to be issued in any other than the English
language. |
Convention
constitutionnelle de 1864
[traduction]
Article 142
Les lois, les documents publiés et
la procédure judiciaire et législative de l'État doivent être
promulgués et conservés en anglais; et aucune loi ne doit prescrire
une procédure judiciaire qui serait attribuée à autre langue que
l'anglais. |
En somme, les Yankees imposaient l'anglais aux Créoles blancs parce
qu'ils avaient pris parti pour le Sud, aux Acadiens parce qu'ils n'avaient pas
osé prendre parti pour le Nord et aux Noirs francophones pour les rendre aptes à
bien s'intégrer au melting pot américain. En Louisiane, autrement dit en
pays acadien, la répression du Nord contre le Sud avait pris un tour «anti-français».
Après le bilinguisme collectif qui avait caractérisait
l'époque précédente, survint un changement radical dans les relations entre les
Blancs et les Noirs. À la suite de l'abolition de l'esclavage en 1865, la
structure sociale entre Blancs, Noirs et Créoles de couleur (Métis) changea
progressivement. Auparavant, les Créoles de couleur étaient soit solidaires et
unis aux Noirs soit condescendants et distants, selon qu'ils s'identifiaient ou
non à ces derniers. Puis les Créoles de couleur se dissocièrent des Noirs,
substituant ainsi un système binaire basé sur la race opposant les Blancs d'un
côté et les Noirs de l'autre.
En 1868, la Louisiane était toujours occupée par les
troupes fédérales (elle le sera jusqu'en 1877). La situation économique de la
Louisiane s'était effondrée. De nombreux propriétaires francophones furent
obligés de vendre leur plantation à de riches entrepreneurs terriens (unilingues
anglais) venus du Nord et quittèrent la Louisiane. Puis des groupes racistes,
tels le Ku Klux Klan, les "Knights of the White Camelia" (en français :
«Les chevaliers du camélia blanc») et la "White League", qui
prônaient la suprématie de la «race blanche» contre les Noirs, se multiplièrent
dans les États sudistes. En principe, l'abolition de l'esclavage avait pour
effet que les Noirs jouissent des mêmes droits que les autres citoyens
américains, notamment grâce aux XIIIe,
XIVe et XVe
amendements de la Constitution des États-Unis. Mais les groupes racistes
demeurèrent longtemps hostiles à ces lois et organisèrent de nombreuses
opérations violentes contre les Noirs afin d'affirmer la supériorité des Blancs.
En même temps, l'anglais devint l'unique langue véhiculaire avec le résultat que
les anglophones délaissèrent le français considéré comme inutile, pendant que
les francophones continuaient à tirer des avantages à apprendre l'anglais. Afin
de ne pas être associés aux Noirs francophones, les Blancs francophones se
rapprochèrent d'avantage des anglophones, particulièrement l'élite qui avait
tout à gagner de s'assimiler.
Parmi les 80 représentants de la
Convention, 25 francophones (31 %, les Acadiens ayant été exclus) furent chargés
de rédiger la Constitution de 1868. Les 161
articles furent adoptés le 7 mars 1868; l'article 109 comportait une nouvelle
disposition qui interdisait l'usage de toute autre langue que l'anglais:
|
Constitution of 1868
[texte original]
Article 109
The
laws, publics records, and judicial and legislative proceedings of the
State shall be promulgated and preserved in the English language; and no
law shall require judicial process to be issued in any other than the
English language. |
Constitution de 1868
[traduction]
Article 109
Les lois, archives publiques,
procédures judiciaires et délibérations législatives de l'État doivent
être rédigées et
promulguées en anglais; et aucune loi n'exigera que la
procédure judicaire ne soit publiée dans une autre langue que l'anglais. |
En 1870, le Code civil fut refait et adopté dans sa version anglaise
seulement. Quant au Code de procédure civile, il fut refondu et toute
obligation d'utiliser le français fut supprimée.
Les troupes fédérales finirent par quitter l'État de la
Louisiane en 1877. Afin de rétablir la paix sociale et mettre fin aux querelles
raciales, les Louisianais décidèrent de remanier toutes les lois et ordonnances,
ainsi que la Constitution. Il en résulta que la
Constitution de 1879 réadmit certaines mesures
au sujet du français, lesquelles sont restées
en vigueur jusqu’en 1921. Selon l'article 154, la législature de l'État
pouvait publier ses lois en français, mais ce n'est pas une obligation. Pour
sa part, l'article 226 prescrivait la langue anglaise dans les écoles primaires
tout en autorisant l'enseignement en français dans les paroisses où le français
prédomine «à la condition qu'il n'en
résulte aucuns frais supplémentaires».
|
Constitution of 1868
[texte original]
Article 154
The laws, public
records, and the judicial and legislative written proceedings of the
State shall be promulgated, preserved and conducted in the English
language; but the General Assembly may provide for the publication
of the laws in the French language, and prescribe that judicial
advertisements in certain designated cities ans parishes shall also
be made in that language.
Article 226
The general exercices
in the public schools shall be conducted in the English language and
the elementary branches taught therein; provided, that these
elementary branches may also be taught in the French language in
those parishes in the States or localities in said parishes where
the French language predominates, if no additional expense is
incurred thereby.
Article 228
No funds raised for
the support of the public schools of the State shall be appropriated
to or used for the support of any sectarian schools. |
Constitution de 1868
[traduction]
Article 154
Les lois, les
archives publiques et la procédure écrite, judiciaire et législative
de l'État doivent être promulguées, conservées et tenues en anglais; mais
l'Assemblée générale peut prévoir la publication des lois en
français et prescrire que les avis judiciaires dans certaines villes
et paroisses désignées soient également transcrits dans cette
langue.
Article 226
Les exercices
généraux dans les écoles publiques doivent se dérouler en anglais et
les disciplines élémentaires, enseignées dans cette langue; pourvu
que ces disciplines puissent aussi être enseignées en
français dans ces paroisses dans les États ou les localités dans
lesdites paroisses où le français prédomine, à la condition qu'il
n'en résulte aucuns frais supplémentaires.
Article 228
Aucuns fonds
supplémentaire pour le soutien des écoles publiques de l'État ne
doivent être affectés ou utilisés pour soutenir une école
confessionnelle. |
Dans le cas contraire, c'est-à-dire
si cela occasionnait des coûts, le gouvernement louisianais interdit
spécifiquement, sous peine de réprimande, l'usage de fonds publics pour les
écoles confessionnelles, ce qui correspondait aux écoles minoritaires
françaises. Autrement dit, l'enseignement de la langue française était toléré à
la condition qu'il n'en résulte aucuns frais supplémentaires, mais
cet enseignement n'avait plus aucun statut officiel. L'impact de la Constitution
de 1868
a, selon le juriste louisianais
Roger K. Ward,
aurait entraîné
un holocauste
linguistique ("a
linguistic holocaust")
perpétré par une
majorité anglophone
vindicative
("a vindictive Anglophone majority")
contre une
minorité francophone vulnérable.
À ce moment, plus de 80 % des Créoles
blancs étaient irréversiblement assimilés. D'ailleurs, les jeunes Louisianais
n'allaient plus se «ressourcer» en France. Après la guerre de Sécession, c'est
au rythme des mœurs américaines que les Louisianais durent ajuster leur
culture et leur vie quotidienne, même si certains Louisianais rêvaient encore
d'un empire français en Amérique.
2.4 L'anglicisation et l'assimilation
À la fin du XIXe siècle, les Créoles blancs
n'exercèrent plus aucune influence en Louisiane. Discrédités ou assimilés, voire
décédés en grande partie, ils n'avaient plus de voix au chapitre des décisions. Ce furent les
Acadiens qui prirent alors la relève en ce qui a trait à la défense de la langue
et de la culture françaises en Louisiane. En 1896, un jugement de la Cour suprême
des États-Unis décréta, tout particulièrement à l'égard des écoles: «Separate
but Equal». L'anglicisation des écoles s'intensifia grâce au clergé catholique
anglo-irlandais. L'évêque Ireland (c'est son nom!) déclara à Saint-Paul du Minnesota en 1887:
|
Nous ne voulons pas plus dans
le catholicisme américain d'un nationalisme allemand que d'un nationalisme
français ou irlandais [...] Un drapeau, une nation, une langue.
|
Par devoir américain (cf. la célèbre formule «one flag,
one nation, one language»), Mgr Ireland supprimait l'enseignement du français
dans les écoles. Le haut clergé francophone fut progressivement remplacé par des
prêtres anglophones.
La
Constitution de 1898
fit encore régresser le statut du français en Louisiane. L'article 251
sur la langue d'enseignement reprenait le texte de l'article 226 de la
Constitution précédente de 1879, alors que la langue anglaise était imposée dans les
écoles primaires, tout en autorisant l'enseignement en français dans les
paroisses où le français prédomine «à la condition qu'il n'en
résulte aucuns frais supplémentaires».
|
Constitution of 1898
[texte original]
Article 251
The general exercices
in the public schools shall be conducted in the English language and
the elementary branches taught therein; provided, that these
elementary branches may also be taught in the French language in
those parishes in the States or localities in said parishes where
the French language predominates, if no additional expense is
incurred thereby. |
Constitution de 1898
[traduction]
Article 251
Les exercices
généraux dans les écoles publiques doivent se dérouler en anglais et
les disciplines élémentaires, enseignées dans cette langue; pourvu
que ces disciplines primaires puissent aussi être enseignées en
français dans ces paroisses dans les États ou les localités dans
lesdites paroisses où le français prédomine, à la condition qu'il
n'en résulte aucuns frais supplémentaires. |
Au sein des représentants de la
Convention, on ne comptait plus aucun Créole blanc, seulement des Acadiens (22
%). Bref, les Créoles blancs étaient définitivement éliminés dans les décisions
politiques de la Louisiane. Néanmoins, la majorité de la population
louisianaise continuait de parler français.
La
Constitution de 1913
reprit les dispositions de la Constitution précédente, notamment aux articles
248 et 251, qui maintenaient les écoles séparées et l'imposition de la langue
anglaise, tout en tolérant le français dans certaines écoles. Sur 73 signataires
de cette constitution, seulement 14 (19 %) étaient francophones.
| Constitution
of 1913 [texte
original] Article 248
There shall be free public schools
for the white and colored races, separately established by the
General Assembly, throughout the State for the education of all the
children of the State between the ages of six and eighteen years;
provided, that where kindergarten schools 'exist, children between
the ages of four and six may be admitted into said schools. All
funds raised by the State for the support of public 'schools, except
poll taxes, shall be distributed to each parish in proportion to the
number of children therein between 'the ages of six and eighteen
years. The General Assembly shall provide for the enumeration of
educable children.
Article 251
The general exercises in the
public schools shall be conducted in the English language; provided,
that the French language may be taught in those parishes or
localities where the French language predominates, if no additional
expense is incurred thereby.
Article 253
No funds raised for the support of
the public schools of the State shall be appropriated to or used for
the support of any private or sectarian schools. |
Constitution de 1913
[traduction]
Article 248
Il doit exister des écoles
publiques gratuites pour la race blanche et les gens de couleur,
établies sur une base séparée par l'Assemblée générale, dans tout
l'État destinées à l'éducation de tous les enfants de l'État âgées
entre 6 et 18 ans; à la condition que, lorsque les écoles
maternelles existent, les enfants âgés de 4 à 6 ans puissent être
admis dans lesdites écoles. Tous les fonds recueillis par l'État
pour le soutien des écoles publiques, sauf les impôts de capitation,
seront distribués à chaque paroisse en proportion du nombre
d'enfants correspondant entre 6 et 18 ans. L'Assemblée générale doit
prévoir le dénombrement des enfants admissibles.
Article
251
Les exercices généraux dans les
écoles publiques doivent se dérouler en anglais, à la condition, que
la langue française puisse être enseignée dans les paroisses ou dans
les localités où le français prédomine, s'il n'en résulte aucune
dépense supplémentaire à ce sujet.
Article 253
Aucuns fonds recueillis pour le
soutien des écoles publiques de l'État ne doivent être affectés ou
utilisés pour soutenir des écoles privées ou confessionnelles. |
La
Constitution de 1921
ne fit même plus allusion au mot «français» ("French"). Seul le terme «anglais»
("English") apparut comme exigence pour être désignée juge de paix:
|
Constitution of 1921
[texte
original] Section 47
Qualifications election and terms
Justices of the peace shall be of good moral character, freeholders
and qualified electors, able to read and write the English language
correctly, and shall possess such other qualifications as may be
prescribed by law.
They shall be elected at the general state election for terms of
four years, by the qualified voters within the territorial limits of
their jurisdiction. |
Constitution de 1921
[traduction]
Article 47
Qualifications aux
élections et mandats
Les juges de paix doivent avoir
une bonne moralité, être propriétaires fonciers et être qualifiés
comme électeur, savoir lire et écrire l'anglais correctement et
posséder toute autre qualifications prescrite par la loi.
Les juges de paix sont élus lors
des élections législatives générales pour un mandat de quatre ans
par les individus qualifiés comme électeurs dans les limites
territoriales de leur juridiction. |
En ce qui concerne les écoles publiques et paroissiales,
il ne fut plus question du français. L'article XII prévoit encore des écoles
séparées pour les Blancs et les Noirs (section 1), mais impose l'emploi exclusif
de l'anglais (section 12), tandis que les fonds publics ne doivent pas être
destinés à soutenir une école privée (française) ou confessionnelle
(catholique).
|
Constitution of 1921
[texte
original] Article XII
Public Education
Section 1
Educational system, how
constituted
The educational system of the
State shall consist of all free public schools, and all institutions
of learning, supported in whole or in part by appropriation of
public funds. Separate free public schools shall be maintained for
the education of white and colored children between the ages of six
and eighteen years; provided, that kindergartens may be authorized
for children between the ages of four and six years.
Section 12
Exercices in English
The general exercises in the
public schools shall be conducted in the English language.
Section 13
No public funds for private or
sectarian schools
No public funds shall be used for
the support of any private or sectarian school. |
Constitution
de 1921 [traduction]
Article XII
Éducation publique
Constitution du système
d'éducation
Section 1
Le système d'éducation de l'État
est composé de toutes les écoles publiques gratuites et tous les
établissements d'enseignement pris en charge en totalité ou en
partie au moyen des fonds publics. Des écoles publiques gratuites
séparées doivent être maintenues pour l'éducation des enfants blancs
et des enfants de couleur âgés de 6 à 18 ans; à la condition que des
écoles maternelles puissent être autorisées pour les enfants âgés de
4 à 6 ans.
Section 12
Exercices en anglais
Les exercices généraux dans les
écoles publiques doivent se dérouler en anglais.
Section 13
Aucun fonds publics pour les
écoles privées ou confessionnelles
Aucuns fonds publics ne doivent
être destinés à soutenir une école privée ou confessionnelle. |
La Constitution de 1913 obligea les écoles publiques à n'enseigner qu'en
anglais. Les maîtres avaient le droit de punir leurs élèves qui, par
mégarde, parlaient français en classe ou dans les cours de récréation. Il
arrivait que l'on oblige les enfants surpris à parler français à se laver la
bouche avec du savon et à s'agenouiller pendant une heure sur des épis de maïs.
Cette discrimination toucha plus les Blancs que les Noirs, car ces derniers
étaient moins perméables à l'anglais. L'État recruta, dans le nord de la
Louisiane, dans le Mississipi et dans le Kentucky des professeurs qui ne
parlaient qu'anglais. Cette interdiction du français n'avait rien de rigoureux
dans les écoles privées. Dans ces écoles fréquentées par les communautés
acadiennes, l'interdiction passa plus ou moins inaperçue, mais le «Code de Napoléon»
a continué à s'appliquer dans les lois de l'État. Toutefois, les Acadiens francophones ne comptaient plus que pour 2 % des signataires de la
Constitution. C'est au cours de ces années que les enfants surpris à
parler français à l'école recevaient des coups de fouet sur les fesses.
Durant une décennie (au cours des années 1930), certains
membres du clergé catholique, par ailleurs fortement américanisé depuis le
début du XXe siècle, encouragèrent les Louisianais francophones à abandonner le
français pour l’anglais; par la suite, le clergé local fut formé selon les
valeurs anglo-américaines du Sud. C'est ce qui explique probablement que, dans les années
1980, une seule communauté religieuse offrait encore une messe en
français le dimanche (à sept heures le matin); quelques autres communautés
offraient une messe en semaine dans les centres d'accueil pour les personnes
âgées.
C'est au cours de ces années que les Louisianais
francophones ont véritablement découvert les Américains, qu'on appelait encore
«les Anglais»! L'exploitation intensive du pétrole à partir de 1940
changea le visage de la Louisiane, tout en faisant la fortune des habitants de
Lafayette. L'arrivée de la Seconde Guerre mondiale a mis les Louisianais
francophones en contact avec les soldats américains. Les Louisianais qui
revinrent d'Europe poursuivirent l'œuvre d'américanisation commencée par les
hommes d'affaires et les professeurs américains, tandis que la Louisiane sortait
de sa ruralité.
2.5 L'absence de politique linguistique
institutionnalisée
Après la Seconde Guerre mondiale, le français (ou ses
variantes) n’était
plus la langue majoritaire en Louisiane, alors que l’avènement de la radio
et surtout de la télévision allait s'introduire dans les foyers et accélérer le changement amorcé par
les établissements scolaires et les communautés religieuses. Dès la
décennie 1950, on peut affirmer que le français était pratiquement perdu en
Louisiane. La plupart des Louisianais d'origine francophone étaient assimilés, à
l'exception des personnes âgées.
Quant à la Constitution actuelle (adoptée en 1974,
modifiée en 1999), l'article 12 (paragraphe 4) précise, en anglais, que «le
droit du peuple de préserver, favoriser et promouvoir ses origines respectives,
historiques, culturelles et linguistiques, est reconnu».
|
Constitution of 1974
[texte
original]
Article 12
Section 4
Preservation of Linguistic
and Cultural Origins
The right of the people to preserve, foster, and promote their
respective historic linguistic and cultural origins is recognized. |
Constitution de 1974
[traduction]
Article 12
Section 4
Préservation des origines
linguistiques et culturelles
Le droit du peuple de préserver,
de favoriser et de promouvoir ses origines respectives, historiques
linguistiques et culturelles, est reconnu. |
C'est le seul article à contenu linguistique dans la
présente Constitution de la Louisiane et aucune allusion n'est faite au sujet ni
de l'anglais ni du français. L'anglais est donc la langue officielle de facto,
le français, tout au plus une langue étrangère protégée, sans véritable
assise juridique. Il faut donc retenir que,
juridiquement parlant, la Louisiane n'a de langue officielle, pas plus
l'anglais que le français. Ce n'est même plus nécessaire!
L'exemple de la Louisiane démontre que, comme au Canada,
l'expansion de l'anglais s'est faite sans aucune politique linguistique
institutionnalisée qui aurait eu pour objectif l'imposition de l'anglais aux
francophones. C'est la même dynamique que l'on retrouve dans plusieurs autres
régions des États-Unis où les Européens non anglophones se sont anglicisés et
américanisés.
3 L'apport de James Domengeaux
(1907-1988)
Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Louisianais étaient devenus
anglophones. Les francophones qui, pour des raisons ethniques et linguistiques,
n'étaient pas assimilés, étaient définitivement devenus des marginaux. Pendant
que leur culture française était discréditée, leur variété de français
dévalorisée, leur variété d'anglais était ridiculisée. À la fin de la décennie
de 1950, le tourisme incita les francophones à sortir de leur ghetto social.
Les origines françaises devinrent un élément distinctif de l'État de la
Louisiane, sinon son principal attrait.
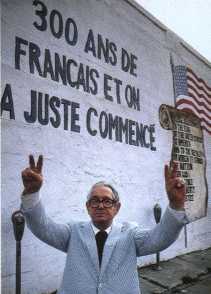 |
Or, la Louisiane devait pouvoir compter sur la
détermination d'un James Domengeaux, un prestigieux et riche avocat de
Lafayette, membre du Congrès de Washington. M. Domengeaux
faisait le constant suivant lors d'une entrevue:
|
Peut-être que c'est
vrai, parce que en réalité le français était fini, le français
était abandonné dans les églises, dans les écoles, dans les
familles, il n'était pas parlé dans les chemins, dans les
magasins, c'était déclassé, c'était associé à l'ignorance. Et ça,
c'est une des grosses erreurs et c'est triste qu'on a laissé ça
arriver. Et les éducateurs louisianais administrateurs, je veux
dire plus que les écoles, ont découragé le français, et les
commissions dans les écoles dans le sud de la Louisiane et où le
français était natif, ces commissaires étaient tous
français-acadiens, ils avaient le pouvoir de mettre solidement le
français dans les écoles et ils ne l'ont pas fait, et personne ne
l'a demandé, personne n'a insisté pour ça. Alors, je crois qu'on a
tous contribué à cette triste attitude et je souhaite qu'il ne
soit pas trop tard pour le préserver. |
À partir de 1968, M. James Domengeaux entreprit une campagne
destinée à restaurer la langue française. À cette époque, seulement le
quart de la population parlait une variété de français, sans pouvoir le lire
ni l'écrire. Domengeaux était l'un de ceux-là!
|
Lors d'un voyage en France, James Domengeaux rencontra le
président français (alors Georges Pompidou) à qui il demanda d'envoyer des
professeurs en Louisiane pour enseigner le français aux jeunes. Dans son
français caractéristique, il déclara: «Monsieur le Président, si tu
m'aides pas, le français, il est foutu en Louisiane.» Ce
fut l'origine de l'accord de coopération qui lie encore aujourd'hui la France
et la Louisiane. Ces enseignants furent ensuite rejoints par des Belges et des
Québécois. L'apport de M. Domengeaux fut considérable pour le français de la
Louisiane. Il fit adopter à l'unanimité par le Sénat et la Chambre des représentants
un ensemble de lois à incidences linguistiques:
- la loi no 408 (1968) prévoyant
l'enseignement du français dans les cinq premières années des écoles
primaires et les trois premières années des écoles secondaires;
- la loi no 259 (1968) exigeant que les
universités et les collèges forment des enseignants qualifiés en français;
- la loi 256 (1968) reconnaissant la langue
française comme officielle dans la publication des avis juridiques et des
contrats;
- la loi 458 (1968) autorisant l'établissement
d'une station de télévision en français, sans but lucratif (mais la loi n'a
pas été appliquée).
C'est également grâce à M. Domengeaux que fut créé en
1968 le Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL), un
organisme gouvernemental qui a but de favoriser l'enseignement du français et
de maintenir l'héritage français en Louisiane. James Domengeaux fut nommé président-fondateur
du CODOFIL par le gouverneur de l'État. En 1978, M. Domengeaux
reçut de l'Office de la langue française du Québec l'Ordre des francophones
d'Amérique. Peu avant sa mort, le 11 avril 1988,
alors qu'il était âgé de 81 ans, le gouvernement français le gratifia du
titre de commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur.
3.1 Les nouveaux
développements
 |
Dès 1971, la partie méridionale
de la Louisiane fut reconnue officiellement par la Législature comme comme
«la région francophone» de l'État sous le nom
d'Acadiana (voir
la description plus détaillée à ce sujet). Par contre, la
Louisiane du Nord (North Louisiana), la Louisiane centrale (Central
Louisiana), les Paroisses de Floride (Florida Parishes) et le
Grand-Nouvelle-Orléans (Greater New Orleans) sont des régions
essentiellement anglophones. En 1980, lors du procès «James
Roach contre Dresser Industries, Valve and Industries Division», le juge
fédéral Hunter déclara les «Cadiens» une minorité protégée par la Loi
sur le droit civil de 1964.
En 1987, pour
la première fois, la Louisiane participa au Sommet de la Francophonie de
Québec en tant qu'observateur; une délégation de la Louisiane fut présente
en 1991 à Chaillot, au Vietnam en 1997 et à Moncton en 1999. Les premiers programmes d'immersion en français commencèrent en
1992. En 1994, l’Université de Louisiane à Lafayette lança le premier
programme de doctorat en Études francophones en Amérique du Nord.
|
 |
3.2 Le fantôme de La Fayette Le 17 juillet 2002, le Congrès américain a décidé d'élever
le marquis de La Fayette au rang de «citoyen d'honneur des États-Unis
d'Amérique», un privilège accordé seulement à quatre reprises en quelque
200 ans d'histoire (l'ancien premier ministre britannique Winston Churchill
en
1963; le diplomate suédois Raoul Wallenberg en 1981, le philosophe quaker
anglais et fondateur de la Pennsylvanie, William Penn, en 1984;
Mère Térésa,
la bienfaitrice albanaise des bidonvilles de Calcutta, en 1997). La Fayette avait
écrit au sujet des États-Unis d'Amérique:
|
Du premier moment où j'ai entendu
prononcer le nom de l'Amérique, je l'ai aimée; dès l'instant où j'ai su
qu'elle combattait pour la liberté, j'ai brûlé du désir de verser mon sang
pour elle; les jours où je pourrai la servir seront comptés par moi, dans tous
les temps et dans tous les lieux, parmi les plus heureux de ma vie. |
|
 |
Le marquis de La Fayette fut parfois plus américanophile
que francophile; et on comprend que le gouvernement américain l'ait
officiellement remercié 168 ans après sa mort. L'année 2003 commémorait le
bicentenaire de la cession de la Louisiane par Bonaparte aux États-Unis (voir
l'affiche du bicentenaire).
À cette occasion, le gouvernement fédéral a
émis un timbre commémoratif (30
avril 2003) pour rappeler la vente de la Louisiane par
Bonaparte (et non Napoléon), d'après une
illustration de 1904 d'André Castaigne. On y aperçoit le gouverneur de la Virginie,
Robert Livingstone
(au centre),
serrant la main au ministre français du Trésor public, le marquis de Barbé-Marbois (de dos,
à gauche), alors que l'ambassadeur des États-Unis, James Monroe (à droite),
signe le document.
La Louisiane a connu une histoire
mouvementée, avec ses hauts et ses bas. L'histoire la plus positive a sans
doute eu lieu sous l'administration espagnole, alors que le français a vécu
une expansion presque incroyable, plus importante que sous l'administration
française. L'administration fédérale américaine a précipité le déclin du français,
surtout au XXe siècle.
Nous en connaissons les causes: l'interdiction du français dans les écoles à
partir de 1921, l'ouverture de routes qui désenclavèrent les communautés
francophones isolées, l'industrie pétrolière qui vint creuser des puits dans
les marais, l'influence des médias électroniques, la dévalorisation sociale
de tous les francophones et créolophones.
|
3.3 Le français louisianais
aujourd'hui
Le français en Louisiane n'est pas mort. Il survit
aujourd'hui avant tout comme langue identitaire. Ce n'est pas rien, mais cela n'en fait pas
un État francophone de langue maternelle. La Louisiane est un État américain qui
accorde au français le statut de langue minoritaire. De nombreuses familles
vivent une situation dans laquelle les grands-parents unilingues francophones
ont appris l'anglais à l'école, les parents sont nécessairement bilingues et les
petits-enfants, des unilingues anglais qui ont appris le français à l'école.
Dans une enquête effectuée à la fin des années
quatre-vingt par Mme Cécyle Trépanier, professeure au Département de géographie
de l'Université Laval, on constatait que seulement 8 % de mes répondants du
troisième âge étaient unilingues anglais, alors que 36 % de leurs enfants et 91
% de leurs petits-enfants l'étaient devenus. Moins de la moitié des répondants
âgés parlaient français avec leur conjoint et moins du quart s'adressaient à
leurs enfants dans cette langue; cinquante pour cent des enfants des répondants
du troisième âge étaient bilingues; moins de 5 % d'entre eux utilisaient le
français avec leur conjoint ou leurs enfants. Bref, Mme Trépanier constatait
qu'il y avait une réduction dans la capacité de parler français. Pour les
petits-enfants des répondants âgés, l'anglais était alors la seule langue
parlée. De fait, il est rare que les parents décident d'élever leurs enfants en
français, car le bilinguisme anglais-français en Louisiane ne se traduit pas par
une meilleure situation économique.
Rien ne pourra enrayer le déclin et la disparition du
français langue maternelle en Louisiane, mais le français langue seconde semble
avoir un meilleur avenir. Cela nous amène à nous interroger sur le type de
français à enseigner. Du temps du sénateur James Domengeaux, le CODOFIL devait
avoir pour mission d'enseigner le français du «bon usage». Les Louisianais,
notamment les Cadiens, utiliseraient une langue de «mauvaise qualité» qu'il fallait
absolument corriger. C'est pourquoi l'État fit appel à des instituteurs
québécois, français et belges, afin de manifester la volonté d'insérer la
Louisiane dans le monde francophone en adoptant un français plus standardisé.
Cependant, ce français demeure relativement éloigné de celui des Louisianais.
Encore au début du XXe
siècle, on distinguait au moins quatre
groupes linguistiques:
1) les Créoles blancs, descendants des premiers colons
français, sinon canadiens-français ou espagnols;
2) les Créoles de couleur,
d'origine raciale mixte;
3) les Amérindiens francophones;
4) les Cadiens, descendants
des réfugiés acadiens.
Un siècle plus tard, seuls les Louisianais d'origine
acadienne et de leurs descendants peuvent encore transmettre ce qui reste du
français. Ainsi, la Louisiane a été en grande partie «cadianisée» sur l'ensemble
du territoire de la région culturelle française. Étant donné le faible nombre
des enfants parlant le français cadien ou le créole à leur arrivée à l'école, il
apparaît irréaliste d'enseigner les variétés locales du français en Louisiane.
De plus en plus, les enseignants considèrent que le rôle de l'école est de
valoriser les variétés locales dans le cadre d'un enseignement du français
standard. Si la consolidation ethnique n'est pas complétée dans l'État, le
processus de cadianisation unifie maintenant le territoire de la région
culturelle.
Lorsque l'ouragan Katrina frappa la Louisiane en août 2005, la
plupart des écoles furent détruites. Mais la solidarité francophone joua un
grand rôle dans la reconstruction en Louisiane. Ainsi, la France envoya rapidement des millions d'euros,
de sorte que toutes les écoles où l'on enseignait le français à la Nouvelle-Orléans
furent réparées et rouvertes. Il n'en demeure pas moins que le français en
Louisiane s'apparente à celui de nombreux États francophones en Afrique.
Cependant, une seconde catastrophe attendait les
Louisianais en 2010: la marée noire dans le golfe du Mexique. Selon le président
du CODOFIL, Warren Perrin, cette catastrophe écologique constitue une menace
pour la langue française en Louisiane: «La catastrophe a surtout touché la côte
de la Louisiane, et c'est là où l'on compte le plus de familles qui parlent le
français.» Le problème vient des conséquences économiques de la marée noire sur
les ressources allouées à la langue française. En temps de crise, les budgets
accordés pour la langue sont toujours réduits en premier. Ainsi, le budget du
CODOFIL a chuté de 60 % depuis 2008. Au printemps 2010, l'Université Nicholls
State à Thibodaux annonçait qu'elle mettait fin à ses programmes en français. Selon
Warren Perrin: «La catastrophe pétrolière va nécessairement aggraver le
problème.» Toutefois, à long terme, la fuite de pétrole pourrait aussi avoir un
effet bénéfique sur la culture cajun: «Ça pourrait mettre l'éclairage sur la
question du français? Les gens vont comprendre que, si on perd la côte, on perd
aussi la langue.» Rappelons que, selon le recensement de 2000, la Louisiane
compterait près de 200 000 francophones, soit 4,7 % de la population.
Quoi qu'il en soit, l'héritage français pourrait bien se
transformer en héritage multiethnique, incluant certains apports français, mais
aussi espagnols, irlandais, allemands, italiens, juifs, vietnamiens, etc.
Évidemment, ce multiculturalisme semble conforme à l'histoire passée et
contemporaine de la Louisiane, comme c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des
États américains, mais en même temps il gomme la spécificité louisianaise. Ce
processus est le résultat de l'absence de l'État louisianais dans la
restauration du français, laquelle n'est pas perçue comme une projet d'avenir
pour la société.
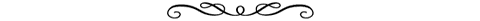
Dernière version mise à
jour:
19 janv. 2024
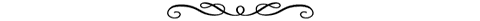
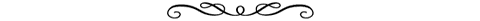
Les
États-Unis d'Amérique
- Amérique
du Nord -
Francophonie