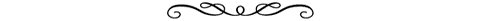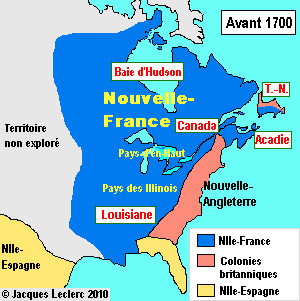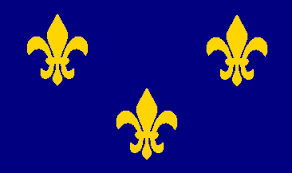Histoire de la
Nouvelle-France
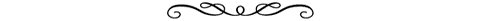
|
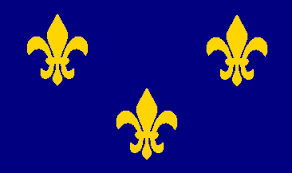
Royaume de France |
La colonie
française de
l'Île-Royale
(Louisbourg)
1713-1758
|
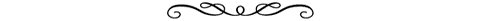
|
Avis: cette
page a été révisée par Lionel Jean, linguiste-grammairien. |
Plan de l'article
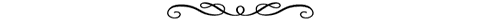
REMARQUE 1:
Théoriquement, la colonie de l'Île-Royale vécut de
1713 à 1758, soit quarante-cinq ans; mais il s'écoula en réalité un
intermède de quatre ans, de 1745 à 1749, alors qu'elle était sous
occupation britannique.
REMARQUE 2:
Lorsqu’on
parle de la «colonie», on écrit Île-Royale, avec une
majuscule initiale sur le terme générique «Île» et sur le terme spécifique
«Royale», ainsi qu'un trait
d’union les reliant. Lorsqu’on parle de l’île en tant que «réalité géographique», on
écrit île Royale, avec une minuscule initiale uniquement sur le terme
spécifique, sans trait d'union; on écrit aussi île Saint-Jean,
laquelle faisait alors partie de la colonie de l'Île-Royale.
Aujourd'hui, au Canada, on écrit île du Prince-Édouard
(l'île) et Île-du-Prince-Édouard (la province).
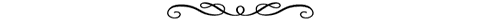
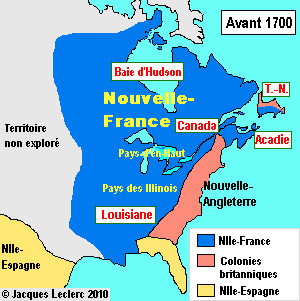 |
Avant
le traité
d'Utrecht de 1713, la Nouvelle-France
comprenait cinq colonies: le Canada
(incluant les «Pays d'en haut» ou région des Grands Lacs), l'Acadie
(aujourd'hui la Nouvelle-Écosse), la Baie du
Nord (aujourd'hui la baie d'Hudson),
Terre-Neuve (que la
France partageait avec la Grande-Bretagne sous le nom de
Plaisance) et la
Louisiane (voir
la carte agrandie de la Nouvelle-France avant 1713). Le «Pays des Illinois» faisait partie de la Louisiane, mais le «Pays-d'en-haut»
(ou région des Grands Lacs) était rattaché au Canada. Après le traité d'Utrecht, la Nouvelle-France
a vu son territoire réduit, qui comprenait alors le Canada, l'Acadie
continentale (aujourd'hui le Nouveau-Brunswick), l'Île-Royale (le Cap-Breton et
l'île Saint-Jean, aujourd'hui l'île du Prince-Édouard) ainsi que la
Louisiane.
En principe, chacune des
colonies possédait son gouverneur local et son administration
propre. Cependant, la Nouvelle-France était relativement unifiée en
vertu des pouvoirs conférés au gouverneur du Canada, obligatoirement
un militaire de carrière, qui résidait à
Québec, mais qui était en même temps gouverneur général de la
Nouvelle-France. |
Autrement dit, les colonies de
l'Amérique française étaient administrées par un gouverneur local, mais aussi
par un gouverneur général à Québec ainsi que par le roi et ses ministres à
Versailles.
Le
gouverneur général de la
Nouvelle-France avait effectivement autorité pour intervenir dans les affaires des autres
colonies de l'Amérique du Nord, à la seule exception de Louisbourg. En temps de guerre, le commandement suprême de
la Nouvelle-France était à Québec, mais après 1748 le gouverneur du Canada ne
put commander les troupes françaises stationnées à Louisbourg, parce que leur
commandement relevait directement de Versailles. En temps normal, le gouverneur local devait
non seulement rendre des comptes au roi et au
ministre de la Marine, mais
également au gouverneur général et à l’intendant de Québec. Certains gouverneurs
généraux ont considéré les colonies voisines comme leur arrière-cour et sont
intervenus régulièrement, souvent même sans en aviser le gouverneur local, tant
à Terre-Neuve, en Acadie qu'en Louisiane. Théoriquement, la
Nouvelle-France était gouvernée par un seul chef militaire pour toutes les
colonies. Toutefois, la distance et les difficultés des communications rendaient la
mainmise du gouverneur général de Québec parfois aléatoire. Les gouverneurs
locaux
communiquaient souvent avec Versailles et les ministres du roi, sans passer par
Québec.
Toutes les colonies de la
Nouvelle-France étaient administrées par le secrétaire d'État à la Marine. Les plus célèbres
ministres furent sans nul doute
Jean-Baptiste Colbert, le comte de Maurepas, le comte de Pontchartrain, Antoine
Rouillé et Étienne-François de Choiseul (voir
la liste). Bref, la France exerçait un contrôle étroit sur ses colonies de
l'Amérique du Nord et avait réussi une unité nécessaire à la défense
de son empire, sans oublier l'Alliance avec la quasi-totalité des nations
amérindiennes du continent. Cette cohésion a d'ailleurs fait longtemps la force de la Nouvelle-France par
opposition aux colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre, toutes divisées
entre elles et peu enclines à coopérer. Le système français suscitait l'envie
des Anglais qui auraient bien apprécié une telle unité pour leurs colonies.
 |
La colonie française de l'Île-Royale (Cap-Breton) fut fondée après le
traité d'Utrecht de 1713, qui mettait
fin à la guerre de Succession d'Espagne (1701-1713). En novembre 1700, Charles
II, roi d'Espagne, décédait sans héritier. Les deux grandes familles
régnantes d'Europe, les Bourbon de France et les Habsbourg d'Autriche,
revendiquèrent le trône d'Espagne parce qu'elles étaient apparentées au défunt
roi. Craignant l'hégémonie de la France, l'Angleterre et les Provinces-Unies
formèrent la Grande Alliance de La Haye, avec la Prusse, l'Autriche, le Portugal,
la Savoie, la Bohème et la Hongrie, contre la France et l'Espagne. Toute
l'Europe entra en guerre durant une longue décennie.
Épuisés, les belligérants tentèrent de trouver une issue
honorable. Lors du Congrès d'Utrecht de 1712, les plénipotentiaires perruqués en arrivèrent à
une entente en faisant fi des populations existantes sur les territoires. |
Du côté de la France,
Louis XIV reconnaissait les droits de George
Ier
au trône d'Angleterre et s'engageait à ne plus soutenir les Stuart. La France restituait
alors à l'Allemagne les villes de Brisach, de Fribourg et de Kehl, mais conservait
ses principaux territoires acquis ainsi que le maintien de son petit-fils
Philippe, duc d'Anjou,
sur le trône d'Espagne, sous le nom de Philippe V de Bourbon; celui-ci devait
toutefois renoncer à ses droits
sur le trône de France. La Grande-Bretagne
recevait de la France certains territoires d'Amérique : la colonie de Plaisance
(Terre-Neuve), incluant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Acadie
péninsulaire (la Nouvelle-Écosse), le territoire de
la Baie-d'Hudson (sans la baie James), ainsi que l'île Saint-Christophe aux Antilles. La France, ayant
perdu la guerre de la Succession d'Espagne, avait dû céder une partie de ses colonies d'outre-mer.
C'était le prix à payer pour le vieux Louis XIV qui tenait à voir son petit-fils accéder au trône
d'Espagne, mais perdre celui de France. Bref, Louis XIV aurait dû refuser le
testament de Charles II, car il n'a rien gagné, bien au contraire. Ce traité de
1713 mit fin à l'expansion française et amorça l'essor de l'empire britannique.
L'île de Terre-Neuve, soit la colonie de Plaisance incluant
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, devint exclusivement britannique en 1713.
Mais l'article 13 du traité
d'Utrecht accordait en retour l'île du Cap-Breton au roi de France, ainsi
que les autres îles du golfe Saint-Laurent, c'est-à-dire les îles de la
Madeleine et l'île Saint-Jean (aujourd'hui l'île du Prince-Édouard). Voici le libellé de l'article 13 concernant la
cession des îles du Saint-Laurent:
|
Article 13
[...] Mais l'isle dite
Cap-Breton, et toutes les autres quelconques, situées dans l'embouchure
et dans le golphe de Saint-Laurent, demeureront à l'avenir à la France,
avec l'entière faculté au Roy T.C. d'y fortifier une ou plusieurs
places.
|
En conséquence, la France devait accepter de rendre les
fortifications de Plaisance (Terre-Neuve) aux Britanniques et de ne pas y
ériger d'établissements pour la pêche. La France conservait cependant des droits de
pêche qui s'étendaient en 1713 du cap Bonavista, en passant par
le cap John, jusqu'à la pointe Riche au nord-ouest. De plus, la France acceptait de transporter sa colonie
de Plaisance à
l'île du Cap-Breton, avec Louisbourg comme future capitale et la possibilité
d'y construire des fortifications. Dès le départ, il était clair pour la France
que la nouvelle colonie de l'île du Cap-Breton ne serait pas seulement
le siège d'une forteresse gardant l'accès au Canada, mais constituerait aussi une
initiative de colonisation importante avec sa propre économie distincte et
son intérêt militaire stratégique. Autrement dit, il y aurait une
forteresse, pas un simple avant-poste de Québec défendant la Nouvelle-France.
Dans l'esprit des Français, Louisbourg allait être en Amérique du Nord l'équivalent
de Gibraltar pour les Britanniques sur la Méditerranée.
C'est le 16 mars 1713 que le Conseil
de la Marine décida de la politique à adopter pour les pêcheries de l'île du Cap-Breton,
d'une superficie de 6350 km² (île Saint-Jean: 5683 km²;
île de Corse: 8600 km²),
composée surtout de côtes rocheuses,
de roches apparentes, de montagnes, de forêts et de plateaux, avec des
pâturages dans des vallées. Les Français savaient que l'île comptait de bons
sites comme ports de mer : Port-Dauphin, Baie-des-Espagnols, Baie-de-Miré, Havre-à-l'Anglais (à l'emplacement de Louisbourg) et Port-Toulouse (voir
la carte de l'île).
3.1 Le choix de la
capitale
Après de longues discussions sur le choix entre
Port-Dauphin et Havre-à-l'Anglais, le Conseil de la Marine se prononça pour Havre-à-l'Anglais
désigné alors par «Port-Saint-Louis» en l'honneur du roi. Cependant, à
la mort de Louis XIV décédé le
1er septembre 1715,
l'appellation
Port-Dauphin fut retenu de préférence en l'honneur du jeune dauphin, le duc d'Anjou (futur
Louis XV); il fallut
donc effectuer le transfert de l'administration, de la
garnison et des principaux services de la colonie. Le village de
Port-Dauphin prit naissance à proximité du fort; ce fut le premier
établissement français sur l'île.
 |
Étant donné que Louis XV, le petit-fils héritier de Louis XIV,
n'avait alors que cinq ans, Philippe d'Orléans devint régent du
royaume de France pendant la minorité du roi; il exerça ses
fonctions jusqu'à la majorité du roi, le 16 février 1723, date de
l'entrée du jeune roi dans sa quatorzième année. C'est donc le duc
Philippe d'Orléans qui décida en
1715 de l'essor de la colonie de l'Île-Royale.
La plus grande partie de la population de l'île venait surtout de
l'ancienne colonie de Plaisance à
Terre-Neuve. L'année 1716 fut
entièrement consacrée à installer la nouvelle colonie. Il fallut
assurer le transport des canons et la construction des forts et des
logements, rétablir la pêche morutière, aménager des grèves,
construire des vigneaux et des échafaudages, explorer les côtes,
etc. Presque au même moment, soit en 1718, le gouvernement français
autorisait la fondation de la Nouvelle-Orléans (Louisiane) et le renforcement des ouvrages
de défense de Montréal, de Québec et des Antilles.
Contre toute attente, en
1719, Philippe d'Orléans ordonna de ramener la capitale Port-Dauphin à Havre-à-l'Anglais, avec comme nouvelle appellation officielle Louisbourg, désignée ainsi en
l'honneur du défunt roi Louis XIV. |
On
effectua à nouveau le transfert de l'administration coloniale de
Port-Dauphin à cet
obscur village de pêcheurs qu'était alors Louisbourg, qui allait rester la capitale de la colonie jusqu'en 1758,
c'est-à-dire jusqu'à la
chute de la forteresse. Quant à l'île Saint-Jean, toute proche, l'objectif
était d'en faire le «grenier» de Louisbourg, puisque l'île Royale, trop
rocailleuse, se prêtait mal à l'agriculture.
3.2 L'organisation
de la colonie
 |
La nouvelle colonie
créée après 1713 comprenait l'île du Cap-Breton (aujourd'hui en
Nouvelle-Écosse), renommée pour l'occasion
île
Royale, les îles de la Madeleine (aujourd'hui dans la
province de Québec) et l'île Saint-Jean (aujourd'hui l'île du
Prince-Édouard). Cette colonie faisait partie
intégrante des territoires de la Nouvelle-France, avec un gouverneur
local
relevant directement de Versailles, mais elle ne faisait pas partie
du Canada, tout comme l'Acadie et la Louisiane.
Le premier gouverneur
de la colonie de l'Île-Royale fut Philippe Pasteur de Costebelle
(1714-1717); il avait été nommé en 1695 lieutenant
du roi à Plaisance (Terre-Neuve), puis en 1706 gouverneur de la
colonie de Plaisance et, le 1er
janvier 1714, gouverneur de l'Île-Royale. Il quitta Plaisance le 23 juillet
1774 à bord du
Héros
pour venir exercer ses fonctions à Louisbourg.
Fait intéressant à noter,
tous les
gouverneurs de Louisbourg (sauf un)
ont été des capitaines de navire ou des officiers de la marine à un moment de
leur carrière.
Le gouverneur était le représentant
officiel du roi dans la colonie de l'Île-Royale; il était assisté d'un «commissaire-ordonnateur»,
dont les fonctions relevaient de
l'intendant de la
Nouvelle-France, qui résidait à Québec. |
Sur le plan
hiérarchique, après le gouverneur et le commissaire-ordonnateur, venaient
un petit nombre de fonctionnaires subalternes, responsables de la
correspondance officielle, du budget,
de l'entrepôt du roi et de divers services liés à
l'approvisionnement, sans oublier les juges, les clercs et les huissiers
pour les affaires judiciaires.
|
Plan de Louisbourg |
La construction
de la forteresse de Louisbourg ne commença qu'en 1719 et ne fut achevée qu'en
1743, mais le gros œuvre était terminé en 1728. Les défenses de Louisbourg
furent conçues et érigées selon les règles de l'époque mises au
point par l'ingénieur de Louis XIV, Sébastien Le Prestre de Vauban
(1633-1707). L'édification de la forteresse créa de nombreux
emplois et la demande en matériaux favorisa l'économie de l'île
durant des décennies. Deux mille ouvriers
participèrent à l'entreprise de la forteresse, dirigée par l'ingénieur
militaire français Jean-François de Verville (v. 1670-1729). Celle-ci devait
comprendre trois batteries interdépendantes et
un bastion de front, en vue de défendre la ville contre les attaques venant
du port et, à l'ouest, des marécages.
Avec ses
remparts de pierre et de mortier, qui encerclaient la ville,
Louisbourg devint la plus grande forteresse d'Amérique du Nord.
Dans les faits, la place constitua un chantier permanent, les travaux de réfection n'ayant
jamais cessé en raison de modifications jugées nécessaires, des
conditions climatiques et géologiques, etc. Les administrateurs détournèrent
en plus une partie des fonds
destinés à la construction et employèrent des matériaux inadéquats.
Enfin, une bonne partie des matériaux (grès, ardoise, articles
de verre et de quincaillerie, etc.) dut être importée de France. Les coûts de
construction parurent à ce point élevés (plus de 30 millions de livres
françaises) que Louis XV, prétend-on, se serait plaint régulièrement en disant : «Est-ce
que les rues y sont pavées d'or? Va-t-on voir bientôt poindre
ses tours à l'horizon de Paris?» En réalité, il est peu
probable que Louis XV ait effectivement employé ces mots, car les sommes
autorisées chaque année à la construction ne constituaient qu'une
petite portion du budget de la Marine, évalué à neuf millions de
livres (décennie 1720-1730); en 1759, ce budget annuel
augmentera à 57 millions, dont quelques millions pour Louisbourg.
En valeur d'aujourd'hui,
les 30 millions de livres françaises équivaudraient à environ
360 millions d'euros, dans la mesure où 1 livre correspondrait à
12 euros actuellement, le tout étalé sur neuf années. Toutefois,
il faut considérer que la colonie de Louisbourg fut finalement
très rentable au point de vue commercial, soit quatre à cinq
fois plus que le coût de la construction de la forteresse.
|
La forteresse de Louisbourg fut surnommée la
«Gibraltar de l'Amérique du Nord», parce qu'elle était la plus importante place
forte française de la Nouvelle-France et de tout le continent. C'était
une ville fortifiée à l'européenne installée sur les
rivages boisés de l'Amérique du Nord.
Pour
un
Européen toutefois, cette forteresse avait l'air d'une place
forte plutôt modeste et assez faiblement défendue.
C'est ainsi qu'avant la chute de Louisbourg en
1758, les
officiers militaires français estimeront, comme cela avait
été le cas en 1744, que la ville n'était pas dotée d'une artillerie
suffisante, même avec ses 110 canons (plus tard, 400). De plus, les
défenses
de la ville étaient conçues pour résister à des tirs
d'artillerie provenant uniquement de vaisseaux de guerre, alors que la partie arrière de la forteresse était
vulnérable par voie de terre.
Il y avait cependant une cinquantaine de
canons ailleurs dans l'île, surtout à Port-Toulouse au sud et à Port-Dauphin
au nord
(voir
la carte de l'île Royale).
|
 |
La nouvelle
ville de Louisbourg bourdonnait d'activités dès 1725 et était devenue l'un des
principaux ports de pêche de toute la Nouvelle-France; comme elle
était stratégiquement bien située, l'industrie de la pêche à la morue commença vite
à être
très lucrative. Près d'un millier d'emplois étaient reliés à la pêche. De
nombreux marchands pratiquaient le commerce international: le sel, le vin et les
produits manufacturés étaient importés de France, tandis que le sucre, la
mélasse, le rhum, le café et le tabac provenaient des Antilles. Avec tous ses petits magasins et entrepôts, Louisbourg avait un caractère nettement
commercial.
Des navires arrivant de France, du Canada,
de l'Acadie et des Antilles, ainsi que des caboteurs de la Nouvelle-Angleterre,
mouillaient continuellement dans son port. Celui-ci accueillait
annuellement quelque 150 navires, sans compter les petits bateaux qui
se livraient au cabotage, ce qui en faisait le port de mer le
plus achalandé de toute la Nouvelle-France, bien avant Québec. |
Le port de Louisbourg était également un
importante base de ravitaillement et de réparation pour les flibustiers français
qui attaquaient les vaisseaux des marchands anglais dans l'Atlantique Nord. Il
avait l'immense avantage d'être libre de glace toute l'année et était bien
protégé. Le port servait aussi de base d'entraînement pour la marine française. En somme, Louisbourg
était à la fois une forteresse, un poste de pêche à la morue et
un vaste comptoir, où la France, le Canada, les Antilles et la
Nouvelle-Angleterre échangeaient des marchandises.
Sur le plan
commercial, la France en a tiré de grands avantages. Si elle a dépensé 30
millions de livres pour construire Louisbourg, la pêche à la morue à elle seule
a rapporté, selon les années, trois ou quatre fois plus que la dépense
initiale. De plus, le passage des navires marchands par Louisbourg était tout aussi
lucratif. On comprend pourquoi le ministère de la Marine accordait autant
d'importance à l'île Royale et au port de Louisbourg. Déjà en février 1715, le ministre de
la Marine, le comte de Pontchartrain,
déclarait : «Si la France perdoit cette Isle, cela seroit irréparable et il
faudroit par une suite nécessaire abandonner le reste de l'Amérique
septentrionale.» Bref, la petite colonie qui gravitait autour de Louisbourg était à ce
point rentable que le Canada, par comparaison, paraissaient une
dépense inutile. Pour la France, la colonie du Canada représentait avant tout
une charge, car le marché de la fourrure restait limité. Néanmoins, le Canada et
la Louisiane empêchaient l'expansion des colonies britanniques en Amérique du
Nord. Mais la perte de Louisbourg rendrait le Canada beaucoup moins intéressant.
Avec le temps, la vocation militaire
de la colonie de l'Île-Royale
finit par prendre le dessus sur le volet économique de la pêche. La forteresse
envahit des secteurs réservés aux pêcheurs, de sorte que ces derniers durent se
rendre ailleurs et abandonner graduellement la pêche côtière pour la pêche
hauturière (en haute mer). Contrairement à la situation au Canada, il n'y eut jamais de
régime
seigneurial à l'île Royale. Louisbourg entretenait aussi le courage et l'espoir
des Acadiens restés en «Acadie anglaise» (Nouvelle-Écosse).
3.3 La
population de l'île Royale
Avant la construction de
la forteresse de Louisbourg, l'île du Cap-Breton n'avait jamais fait l'objet
d'une colonisation soutenue de la part de la France. Le 2 septembre 1713,
lorsque la France prit officiellement possession de l'île du Cap-Breton, un seul
Français y habitait et il y vivait en compagnie d'une trentaine de familles
indiennes (des Micmacs). Trois mois plus tard, 155 habitants de la
colonie de Plaisance qui vinrent trouver
refuge à l'île; attirés par la proximité des lieux de pêche, d'autres familles
les suivirent. En
1716, on comptait environ 1500 habitants à l'île du Cap-Breton, qui allait devenir
l'île Royale. Il s'agissait d'artisans engagés pour la construction de la
forteresse, de militaires pour sa défense, de gens de métiers divers, de
commerçants, de matelots et de fonctionnaires. On dénombrait aussi plus de
1100 pêcheurs qui ne résidaient que l'été, surtout sur la côte est et la côte
sud, entre la baie des Espagnols et l'île Madame
(voir
la carte de l'île Royale).
En dehors de la ville fortifiée de Louisbourg, seuls quelque 600 Français
habitaient l'île Royale avant 1745. Après 1749, Petit-de-Grat est devenue la
seconde agglomération en taille de la colonie, suivie de Port-Toulouse, pour une
population totale de moins de 900 habitants répartis surtout sur la côte est et
sud-est.
- La
population française
Un recensement
officiel fait en 1724 révélait que la population sédentaire de l'île Royale (Cap-Breton) comptait
890 habitants, puis 951 en 1726, 1116 en 1734, 1463 en 1737, 2690 en 1752. Les
recensements officiels ne tenaient jamais compte des militaires, ni des
pêcheurs, ni des travailleurs saisonniers qui ne venaient habiter Louisbourg que
l'été.
Différents recensements (1724, 1726 et
1734) donnent une idée de la provenance des Français habitant l'île Royale:
|
Recensement de 1724: 890 habitants |
Recensement de 1726: 951 habitants |
Recensement de 1734: 1116 habitants |
Normandie/Bretagne: 15 %
Canada: ?
Île-de-France: ?
Centre-Ouest (France): 7,5 %
Sud-Ouest (France): 11,2 %
Autres régions (France): 19,6 %
Étranger: ? |
Normandie/Bretagne: 20 %
Canada: 16 %
Île-de-France: 9,2 %
Centre-Ouest (France): 23,5 %
Sud-Ouest (France): 11 %
Autres régions (France): 16 %
Étranger: 2 % |
Normandie/Bretagne: 19,2 %
Canada: 21,2 %
Île-de-France: 18,5 %
Centre-Ouest (France): 16,4 %
Sud-Ouest (France): 11 %
Autres régions (France): ?
Étranger: 6,2 % |
La plupart de ceux qui
venaient de la Bretagne et de la Normandie
étaient originaires de la région
immédiate de Saint-Malo. D'autres arrivaient de l'Île-de-France, la région
parisienne; du sud-ouest de la France, c'est-à-dire de la Gascogne et du
Béarn, y compris le Pays basque; du Centre-Ouest, ce qui inclut le sud de la
Bretagne, le Poitou, l'Aunis, l'Angoumois et la Saintonge (voir
la carte). La plupart des
Français provenaient des villes de Paris, de Saint-Malo, de Bordeaux,
de Nantes, de La Rochelle, de Rochefort, de Limoges et de quelques autres (voir
la carte). Au fur et à mesure de
l'expansion de la colonie de l'Île-Royale, des «Canadiens» (un terme encore
peu utilisé à l'époque), des Acadiens (terme tout aussi peu utilisé) et des Français
arrivèrent du Canada et de l'Acadie. Selon les recensements périodiques,
environ 80 % des
habitants de l'île Royale étaient nés en France.
L'île Royale comptait beaucoup plus d'hommes que de
femmes,
soit de huit à dix hommes pour une seule femme.
Par conséquent, les femmes se mariaient plus
jeunes à Louisbourg que partout ailleurs
en Nouvelle-France: la moyenne était de
19,9 ans pour un premier mariage, alors qu'il était de 29,2 ans pour les
hommes.
Fait à noter: 15 % des jeunes femmes
qui se mariaient se présentaient à l'autel alors qu'elles étaient enceintes
de plus d'un mois, un taux nettement supérieur à celui des femmes de Québec
ou de Montréal.
La rareté des femmes favorisait aussi le remariage des veuves, car la
perspective de se retrouver seule dans une ville peuplée de soldats, de
matelots et de pêcheurs esseulés paraissait inacceptable.
Plusieurs femmes sont devenues propriétaires d'auberges, de cabarets ou de
pêcheries. Il arrivait que des Européens
trouvent des femmes micmacs avec lesquelles ils formaient des unions plus ou
moins officielles, plus ou moins stables. Louisbourg attirait surtout
les hommes célibataires, car c'était avant tout une ville de
garnison et un port militaire et commercial de première importance.
Les documents sur la ville de Louisbourg révèlent qu'elle
tolérait les prostituées, c'est-à-dire des «femmes de mauvaise vie», mais les
plus graves problèmes sociaux semblaient surtout associés à la consommation
d'alcool et aux jeux de hasard.
Quant
aux enfants, il y en avait beaucoup à Louisbourg. D'après l'historien
Johnston (2011), en 1720, les enfants représentaient
22,4 % de la population civile de la ville; en 1724, cette proportion était
montée à 29,4 %. Puis, en 1737, les enfants atteignaient 45,4 % du nombre
des civils, ce qui correspondait à 664 enfants.
Environ un enfant sur cinq né à
Louisbourg décédait avant d'avoir atteint l'âge de douze ans
(c'était un sur quatre en France). Il est surprenant que,
malgré le nombre important des enfants, le ministre de la Marine ne se
soit jamais préoccupé de construire une école pour eux, et ce, malgré
les recommandations du commissaire-ordonnateur de Louisbourg. Il n'y avait
pas d'écoles statutaires, même si les Frères de la Charité et les sœurs de
la Congrégation de Notre-Dame enseignaient le catéchisme, la lecture et
l'écriture.
Pendant ce temps, au Canada,
les établissements d'enseignement étaient assez répandus. À Louisbourg, même les enfants des officiers et des
gentilshommes savaient à peine lire et écrire. Bref, les possibilités
d'instruction chez les enfants demeuraient limitées dans cette colonie. Parfois,
des maîtres donnaient des cours spécialisés pour les enfants de la garnison,
notamment en écriture, en mathématiques, en hydrographie, en navigation, en
escrime, en danse, etc., mais l'instruction n'était pas gratuite, de telle sorte que seuls les
fils ou filles d'officiers pouvaient y accéder. La majorité des parents, on
s'en doute, n'avaient
guère les moyens de se payer des tuteurs ou d'envoyer leur progéniture au
Canada (Québec) ou en France.
Il n'y avait pas d'écoles statutaires,
même si les Frères de la Charité et les sœurs de la Congrégation de
Notre-Dame enseignaient le catéchisme, la lecture et l'écriture. Dans la
plupart des cas, les enfants qui apprenaient à lire et à écrire le
faisaient à la maison, de leur propre initiative, en se procurant un livre
au magasin général. La plupart des riches de la
ville possédaient des bibliothèques privées. Le taux d'analphabétisme «normal» pour l'époque variait autour de 60 % pour les femmes et de 40 %
pour les hommes.
Les
classes sociales
étaient très visiblement différenciées dans la ville de Louisbourg, alors
qu'elles l'étaient beaucoup moins
dans le reste de l'île, en Acadie ou au Canada. En effet, 13 % des Louisbourgeois détenaient 73 %
des richesses de la colonie de l'Île-Royale. Le rang et la fonction
conféraient à la personne qui les détenait un statut social supérieur. Louisbourg présentait un contraste frappant entre les perruques poudrées des
bien-nantis et les vêtements en lambeaux des classes ouvrières. Le gouverneur
et le commissaire-ordonnateur agissaient en autocrates et contrôlaient dans
les moindres détails la vie de la colonie, sous réserves des décisions de la
Métropole ou des hauts dirigeants de la Nouvelle-France (Québec). Suivaient, dans l'ordre
hiérarchique, quelques hauts-fonctionnaires et quelques
nobles, les officiers, puis un certain nombre de riches commerçants
installés à Louisbourg. Ensuite venaient les petits commerçants, les
artisans, les corps de métier, les militaires, les domestiques et les servantes
(quelques centaines), les pêcheurs, etc. La plupart des pêcheurs étaient
originaires de Saint-Malo et du Pays basque; ils vivaient dans une douzaine
de petits ports répartis dans le reste de l'île.
Il y avait aussi à Louisbourg un grand
nombre d'auberges et de cabarets où l'on buvait de grandes quantités de
rhum provenant de la Martinique,
la boisson la plus populaire dans la ville.
Les données du recensement de l'année 1752
montrent qu'il y avait presque cinq fois plus de domestiques que de
servantes, c'est-à-dire 366 hommes pour 71 femmes. Durant une douzaine
d'années, la France expédia à Louisbourg des coupables de délits mineurs
ainsi que des fils de famille indésirables. Mais en général, les «Louisbourgeois»
vinrent en Amérique par leurs propres moyens et à leurs frais.
Il n'y avait que fort peu d'agriculteurs
à
l'île Royale, car les terres rocailleuses n'étaient guère propices à la
culture. Ce fut même la raison principale qui portait les Acadiens à rester
en Nouvelle-Écosse, sous le pouvoir d'un monarque anglais et protestant, plutôt qu'à l'île Royale, sous
un régime français et un roi catholique. Il y eut certaines tentatives pour développer
l'agriculture sur la côte est de l'île Royale et c'est là que se trouvaient
les quelques établissements agricoles. Certains paysans élevaient des poules,
des vaches, des cochons, etc., destinés à la consommation pour les habitants
de la forteresse.
Cependant, faute d'une agriculture développée et d'une bonne flotte de pêche
locale, l'île Royale ne fut jamais autosuffisante: elle ne pouvait même pas
compter, sur une base régulière, sur les exploitations agricoles de l'île
Saint-Jean. Ce sont les Acadiens de la Nouvelle-Écosse qui fournissaient en
denrées de première nécessité les habitants de Louisbourg. Pour le reste, il
fallait tout importer de France.
- Les
Acadiens
Malgré les efforts des autorités françaises pour inciter les Acadiens à venir
s'installer à l'île Royale, peu d'entre eux finiront par accepter: entre 1713 et 1734, seules
67 familles acadiennes, sur un total de 500, émigreront à l'île Royale. Au recensement de 1752, la population
de l'île atteignait 3500, dont plus de la moitié à Louisbourg même. L'île
n'attirait pas beaucoup les Acadiens parce que la
vie agricole y était peu développée : la pêche constituait
l'industrie principale, alors que la traite des fourrures était inexistante. Les
Acadiens étaient avant tout des agriculteurs et des éleveurs, non des pêcheurs
ou des navigateurs.
À partir de 1750, plus d'Acadiens,
qui cherchaient à éviter la tourmente imminente, ont commencé à
affluer à l'île Royale, surtout à Port-Toulouse. D'une centaine en 1749, ils étaient plus de 550
en
1752. Ces Acadiens y ont séjourné pendant un certain temps, mais la majorité
serait retournée en Acadie ou aurait traversé à l'île Saint-Jean. En 1753, il ne
restait plus que 200 Acadiens sur l'île Royale. La plupart fuiront à
l'île Madame. Lors du siège de Louisbourg en
1758, il restait moins de 100 Acadiens dans la ville fortifiée.
- Les
militaires
En 1737, l'île Royale
comptait 65 % de civils et 35 % de militaires. En 1740, pour la seule garnison
de Louisbourg, on dénombrait au moins 700 soldats sur une population approximative de 2500 à 3000 personnes;
le nombre de militaires augmentera à près de 1000 après 1750, puis à 3500 en
1758.
De façon générale, les militaires formaient entre la moitié (en temps de guerre)
et le quart (en temps de paix) de la population totale de l'île Royale.
 |
La plupart des soldats
faisaient partie des Compagnies franches de la
Marine, où seul le
français était utilisé. Dans les années 1740, on comptait huit
Compagnies franches de 70 hommes chacune, mais il y avait d'autres
détachements
ailleurs dans l'île, notamment à Port-Dauphin et à Port-Toulouse
(voir
la carte de l'île Royale).
Après 1750, il y eut 24 compagnies dans la ville, de 50 hommes
chacune.
À partir de 1755,
Louisbourg reçut un bataillon de 520 hommes du
régiment de Bourgogne,
un autre de 520 hommes du régiment d'Artois et, juste avant le siège
de 1758, un bataillon de 680 hommes du régiment de Cambis. En 1758,
la garnison comptait quelque 3500 militaires, leur nombre ayant
augmenté de manière appréciable cette année-là.
À l'époque, la France et la
Grande-Bretagne engageaient beaucoup de «mercenaires» dans leurs
troupes. Entre 1713 et 1745, environ 20 % des soldats venaient
d'Espagne, d'Écosse, de l'Irlande, de l'Allemagne (États
germaniques), de la Prusse, de la Suisse, et même de l'Angleterre. |
La grande majorité des soldats
étrangers étaient de religion protestante et parlaient peu le français, même
s'ils recevaient leurs ordres dans cette langue, car presque tous les officiers
étaient des Français, sauf dans le régiment de Karrer
(environ 150 hommes)
commandé par trois officiers allemands. Ces militaires menaient une existence
séparée des soldats français, avec leur propre cantine et leur propre buanderie. Le régiment de Karrer avait été fondé en
1719 par Franz Adam Karrer (1672-1741), un officier suisse au service du roi de France. Dans
les faits, seule une minorité des soldats ayant servi dans le régiment de Karrer
à Louisbourg entre 1722 et 1745 étaient réellement suisses; la plupart étaient
allemands. En 1758, la France enverra des bataillons formés des
Volontaires
étrangers, formés de mercenaires suisses, irlandais, écossais et italiens.
Aux troupes de fantassins s'ajoutaient une ou deux
compagnies de spécialistes en artillerie, c'est-à-dire des
canonniers-bombardiers, comptant selon les époques de 30 à 60 hommes pour chacune des
compagnies.
De son côté, la Marine française employait beaucoup de marins
et d'hommes à tout faire.
L'exploitation du port exigeait de
nombreux spécialistes. En plus des marins, Louisbourg avait besoin d'un capitaine de
port, de pilotes, de navigateurs, de commis et de notaires. Il y eut un
hydrographe, qui dessinait des cartes marines, et même
un astronome, Joseph-Bernard Chabert de Cogolin. Le premier observatoire d'astronomie de la Nouvelle-France fut
ainsi construit à Louisbourg, afin de trouver une
façon efficace de mesurer la longitude. C'est aussi à Louisbourg qu'on
construisit en 1734 le premier
phare
de la Nouvelle-France.
Enfin, certains militaires étaient mariés
et accompagnés de leur épouse et de leurs enfants. Ces femmes étaient
généralement appelées «accompagnatrices de camp». On n'en comptait en général que cinq ou six par année. À
la veille de la capitulation en juillet 1758, les prêtres de Louisbourg se sont
mis à marier les jeunes femmes à des soldats afin de protéger «leur honneur».
La vie des militaires à l'île Royale
était un peu monotone: elle consistait principalement à monter la garde ou,
moyennant un léger supplément d'ordre financier, à reconstruire les
fortifications. Il n'y avait jamais d'expéditions guerrières
comme au Canada, accompagnées d'Indiens. Parfois, de petits détachements
partaient pour les postes avancés de
Port-Toulouse ou de Port-Dauphin, ou encore à
Port-la-Joy dans l'île Saint-Jean. Le poste
de Port-Toulouse comptait généralement 25 soldats et deux officiers;
Port-Dauphin, une dizaines d'hommes; et Port-la-Joy, selon les années, entre 15
et 45 militaires, avec un à trois officiers.
Les
simples soldats devaient se contenter d'un bas salaire, soit une livre et demie
par mois, comparativement à 6 livres pour un caporal, 90 livres pour un
capitaine, 100 livres pour un commandant et 750 livres pour le gouverneur de la
colonie. En général, les petites gens de la Nouvelle-France gagnaient entre 40 à
120 livres annuellement. Une livre française valait 20 sols ou 240 deniers; une livre française
de l'époque équivalait à environ 3,75 $ d'aujourd'hui ou 2,3 euros.
Les langues employées dans
l'armée étaient le français, mais aussi l'allemand (régiment de Karrer), ainsi
que l'espagnol. Venaient ensuite l'irlandais et l'écossais. Ironie de
l'histoire: Louisbourg, ville réputée pour être un bastion français de religion
catholique, était défendue en partie par des germanophones et des celtiphones
protestants. Après 1750, les soldats étrangers ne formèrent plus que 5 % du
contingent militaire.
- Le clergé
En ce qui
concerne le clergé,
il était très réduit à Louisbourg, mais néanmoins présent. L'évêque était à
Québec, donc bien loin de Louisbourg, et seuls quelques prêtres résidaient sur place comme aumôniers.
Il n'y
avait pas d'église paroissiale à Louisbourg, bien que la paroisse puisse porter le nom de
«Notre-Dame-des-Anges». En fait, l'église
fut toujours installée dans de modestes chapelles : d'abord, dans la chapelle de Sainte-Claire
sur le bord de la mer appartenant aux récollets (entre 1724 et 1735), puis
dans la
chapelle de Saint-Louis installée dans la caserne du bastion du roi.
Il y eut
plusieurs projets pour construire une véritable église paroissiale, mais le
commissaire-ordonnateur ne put jamais convaincre les Louisbourgeois de payer une taxe
pour le faire. Par la suite, tout projet de construction d'une église
fut abandonné, tant du côté des fonctionnaires du roi que de celui des
paroissiens qui répugnaient à en assumer les frais. Par contre, les petites
agglomérations avoisinantes, telles La Baleine et Lorembec, pourtant dix fois
moins populeuses, possédaient leur propre église.
 |
La
ville de Louisbourg comptait ordinairement quatre ou cinq prêtres,
soit un curé et trois ou quatre aumôniers, tous des récollets
bretons, parlant français et breton. Les aumôniers militaires devaient généralement réciter les prières
du matin et du soir, célébrer la messe ainsi que les vêpres le dimanche et les
jours de fêtes, ou confesser les soldats. Avant tout affrontement, les prêtres
se livraient à des exhortations pour soutenir le moral des troupes et
donnaient l'absolution générale. Les fêtes les plus populaires de la colonie
étaient la Fête-Dieu et la Saint-Louis, ce qui impliquait des processions dans
toute la ville, des salves d'artillerie et des feux de joie.
Les récollets enseignaient
en principe les rudiments de l'écriture et de la lecture, en plus du
catéchisme, mais aucun document ne témoigne qu'ils auraient dirigé
une quelconque école paroissiale.
En 1751, le grand vicaire général
du Canada et de l'Acadie,
Pierre de La Rue (1688-1779),
abbé de l'Isle-Dieu,
se plaignit au ministre de la
Marine,
Antoine Rouillé, que les
récollets de Louisbourg n'offraient pas tous les services
habituellement dispensés par les religieux. D'après le vicaire
général, qui ne vint jamais en Nouvelle-France, les récollets «négligent
tout, instructions, confessions, administration de sacrements,
visites et consolations des malades, catéchisme des enfants, rien
n'est rempli et tout est négligé». Les récollets de
Bretagne furent
souvent critiqués pour «leur manque d'instruction et leurs mœurs
relâchées», mais à l'époque il en était souvent ainsi dans les
villages de France.
Presque tous les prêtres résidents exerçaient
leur apostolat à Louisbourg, mais certains visitaient leurs ouailles
dans les paroisses environnantes de l'île Royale (La Baleine, Lorembec, Niganiche,
Scatary, Port-Toulouse, Port-Dauphin) ou de l'île Saint-Jean (Port-la-Joy,
Pointe-Prime, St-Pierre-du-Nord, etc.). |
 |
Au fil des années, trois
missionnaires français, affectés à l'évangélisation des Micmacs, semblent avoir laissé des traces
durables dans la courte histoire de Louisbourg: le sulpicien
François Picquet
(1708-1781), l'abbé Pierre-Antoine Maillard (1710-1762) et l'abbé Jean-Louis Le Loutre
(1709-1772), un prêtre très apprécié des ministres de Versailles. Ces
personnages ont servi de guides et de conseillers auprès des représentants des
autorités françaises. Pour leur part, Maillard et Le Loutre ont côtoyé
huit gouverneurs différents à
Louisbourg, soit donc tous les gouverneurs, sauf deux (de Costebelle et de
Châteauguay). |
De façon générale, les Britanniques imputaient à
l'influence des missionnaires les actes de guerre des Micmacs. Ils n'avaient pas
tout à fait tort, comme en fait foi cette lettre de l'abbé Jean-Louis Le Loutre
envoyée en juillet 1749 au ministre de la Marine,
Antoine Rouillé: «Je feray mon
possible de faire paraître aux Anglois que ce dessein vient des Sauvages et que
je n'y suis pour rien.»
Il existait à Louisbourg
deux communautés religieuses: les Frères de la Charité de Saint-Jean-de-Dieu et
la
Congrégation de
Notre-Dame de Montréal. La mission des Frères de la Charité était d'assurer
les soins auprès des malades et des
infirmes, sous la supervision du chirurgien-major de la garnison.
Sauf au début de la colonie, les frères furent
affectés à l'hôpital du roy, qui comptait alors 100 lits. Les maladies les plus
courantes étaient la dysenterie, la variole et le typhus. Ceux qui décédaient de
maladies contagieuses n'étaient généralement pas enterrés dans le cimetière de
la ville, mais dans des fosses d'urgence creusées à l'extérieur des murs. Non seulement
les Frères de la Charité
devaient s'occuper des maladies
de leurs patients (civils, soldats et marins), mais ils devaient aussi informer
ces derniers de la nécessité de «purifier leur âme pendant le rétablissement de
leur corps». En général, les soldats étaient supérieurs en nombre aux autres
patients. Au cours des années 1740, on
dénombrait à Louisbourg cinq
ou six Frères de la Charité, accompagnés de quelques domestiques.
La
Congrégation de Notre-Dame,
une communauté religieuse de femmes, avait quant à elle été fondée par Marguerite Bourgeoys (1620-1700). Les sœurs de la Congrégation ne venaient donc
pas de France, mais du Canada. En général, on comptait trois
sœurs de la
Congrégation à Louisbourg, mais il y en eut six en 1742.
La tâche des
sœurs était
d'enseigner le catéchisme aux jeunes filles, mais aussi la lecture et
l'écriture, ainsi que la couture. L'école
des
sœurs
accueillait parfois jusqu'à 50 ou 100
élèves. Cependant, les
sœurs de la Congrégation connurent sans cesse des difficultés financières
dont le résultat fut de réduire considérablement leur mission auprès des
jeunes filles.
Contrairement à la situation qui prévalait
au Canada, notamment à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal, l'Église catholique n'a jamais exercé une influence
considérable sur les habitants de Louisbourg. D'abord, l'évêque résidait à
Québec, puis le clergé était peu nombreux; le clergé local comptait tout au plus une douzaine de
personnes, incluant les prêtres, les Frères de la Charité et les
sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame.
L'emprise de l'Église
à Louisbourg était donc limitée, alors que les pêcheurs ne recevaient la
visite des missionnaires venus de l'Acadie que de façon sporadique. L'histoire
a aussi retenu que les prêtres résidents et les Frères de la Charité de Louisbourg sombraient
presque tous dans l'alcool, leur vie leur paraissant sans doute trop difficile. La
faible présence de l'Église à Louisbourg, notamment l'absence d'un
haut-clergé, pourrait expliquer en partie le comportement de certains religieux.
Au mois de février 1756, l'évêque de
Québec, Mgr
Henri-Marie Dubriel de Pontbriand (1709-1760), adressa aux membres du clergé et aux paroissiens de Louisbourg
une lettre pastorale en leur
rappelant que «toutes les puissances de la terre ne sont rien devant Dieu». Pour
l'évêque, le plus grand danger n'était pas les Anglais, mais le comportement douteux
des «pécheurs» de l'île Royale: «Si les pecheurs perseverent dans leurs désordres,
nous osons dire, tout est à craindre pour cette colonie Et nous verrions
peutetre bientôt [que] Louisbourg retombes une seconde fois.» Il n'est pas
certain que les militaires aient été convaincus que l'attitude morale des
civils, plutôt que leur présence, puisse empêcher les Britanniques de reprendre
Louisbourg. Mgr
de Pontbriand donna ses directives pour combattre le malheur anglais: ajouter une
prière aux messes locales, organiser une procession dans les rues avec une
statue de la Vierge Marie le premier dimanche de chaque mois et exposer le
Saint-Sacrement le quatrième dimanche de chaque mois. Les faits semblent
démontrer que ces directives n'ont pas eu une grande incidence sur
l'issue du conflit franco-britannique.
Les langues utilisée par les membres du
clergé étaient le français (par tous), le breton (les récollets bretons) et le
latin (dans les cérémonies religieuses). Il
y eut même des prêtres irlandais qui exercèrent leur ministère dans l'île
Royale; ils parlaient irlandais, anglais et français.
- Les
esclaves
Entre 1713 et 1758, au
moins 216 esclaves ont été recensés;
c'étaient des Noirs dans une proportion de 90 %, les autres étant des
Amérindiens. Les esclaves résidaient presque tous à Louisbourg. Ce grand nombre
d'esclaves pour une si petite colonie s'explique dans la mesure où le commerce
avec les Antilles était florissant; ils arrivaient par bateau et trouvaient
aussitôt des acheteurs.
Les esclaves pouvaient appartenir à des nobles, mais
ce sont surtout les
grands négociants français qui en possédaient. Au fil des années, beaucoup de
Noirs sont devenus libres (affranchis) et ont pu s'intégrer dans la vie des Louisbourgeois
en se francisant.
- Les
étrangers
L'île Royale
comptait,
en plus des Français et de quelques dizaines d'Acadiens,
beaucoup d'étrangers, dont des Basques espagnols, des Allemands, des Espagnols, des Suisses,
des Irlandais, des Écossais et des Anglais. Les
Basques, avec les Bretons et les Normands, étaient surtout occupés à la pêche,
alors que les Allemands et les Suisses étaient embauchés comme mercenaires dans
l'armée française.
La
forteresse de Louisbourg
abritait aussi une importante minorité d'Irlandais catholiques, ainsi que des
Écossais et des Anglais convertis au catholicisme, et qui avaient fui la
répression religieuse dans leur pays. Il existait même, dans les années 1750, un
«village des Allemands», car plusieurs soldats du régiment de Karrer y
habitaient avec leurs épouses et leurs enfants; ces soldats conservaient
beaucoup plus facilement leur langue maternelle.
- La
population estivale
Durant la saison estivale,
s'ajoutaient à la population résidente plusieurs centaines de
pêcheurs, de marins et de
marchands
en transit. En effet, le port de Louisbourg accueillait des navires de France, des
Indes occidentales (Antilles) et de la Nouvelle-Angleterre. Les
allées et venues des bateaux
et des barges faisaient du port de Louisbourg l'un des lieux les plus dynamiques
de toute la Nouvelle-France. Au cours de l'été, diverses langues étaient
entendues sur les quais: le français d'abord, mais aussi l'anglais, le basque, le
breton et l'allemand. Les pêcheurs bretons, basques et portugais, les commerçants anglais, les
marchands des Antilles et les clients acadiens, de même que les militaires
allemands et suisses contribuaient à l'atmosphère
cosmopolite de Louisbourg.
- Les langue parlées
Le français parlé dans la ville de Louisbourg était le
«français du roy», utilisé au sein de l'administration,
de l'armée, de la marine et des grands commerces. Les autres
habitants s'exprimaient pour leur part dans un français populaire
alors en usage dans la
région de Paris et parlé par le peuple de Paris. Très tôt, ce français s'est
assuré la prédominance à Louisbourg et dans l'île Royale, comme partout ailleurs en Nouvelle-France,
sans qu'aucune politique linguistique n'ait été élaborée ni même envisagée. Ce
n'était certes pas dans les habitudes de l'époque.
Il se parlait
en même temps beaucoup d'autres langues dans la ville de Louisbourg. On y entendait
en effet le basque, le breton, le poitevin, l'allemand et le suisse-allemand,
l'espagnol, l'anglais, l'irlandais, le néerlandais, le portugais, l'italien et
le micmac. Parmi toutes ces langues, c'est le basque qui était le plus parlé
après le français, en raison de la présence de plusieurs centaines de pêcheurs
basques, surtout durant la période estivale. Ceux-ci ont même souvent demandé,
bien en vain, de recevoir les services d'un prêtre basque. En somme, si la ville
de Louisbourg avait un caractère multilingue et cosmopolite, dans le reste de
l'île, on parlait surtout le français du roy, le français populaire, le basque
et le micmac.
Il est légitime de se
demander comment les autorités françaises de l'époque appelaient les habitants de
la colonie de l'Île-Royale. Quelle que soit leur origine, tous les habitants
étaient considérés comme des Français et des «sujets du roi». Le
problème se posera après 1758 lorsque tous les habitants seront rapatriés en
France. Ils deviendront alors des «Français de l'île Royale», des «Français de
Louisbourg» ou, selon le cas, des «Français de l'île Saint-Jean» ou encore des «Français de
l'Amérique septentrionale». Les termes «Acadiens» ou «Canadiens» furent
rarement utilisés, sauf par les Anglais (qui employaient parfois le terme "Canadians"
en 1758). Quant à l'appellation «Louisbourgeois», elle ne fut jamais utilisée,
sauf par les
historiens, deux siècles plus tard, de même que le mot «Île-Royalais». On
entendait aussi l'expression «les Français de l'île Saint-Jean».
3.4
L'île Saint-Jean
L'île Saint-Jean,
d'une superficie de 5683 km² (île Royale: 6350 km²), faisait partie de la colonie de l'Île-Royale; elle était fréquentée par les Basques depuis
fort longtemps. En 1534, Jacques Cartier semble avoir été le premier explorateur
à avoir annoncé l'existence de l'île, qu'il décrivit comme «la terre la plus belle
que l'on puisse imaginer». Les premiers colons français, au nombre d'environ 300, arrivèrent
sur l'île durant l'été de 1620. La plupart d'entre eux fondèrent des villages de
pêcheurs sur la côte nord de l'île, mais certains s'installèrent dans un petit
bourg appelé Port-la-Joy
(aujourd'hui Charlottetown) et dans les environs immédiats, pour y cultiver la terre.
-
Nicolas Denys
 |
En
1653, Nicolas Denys (1598-1688), un marchand français originaire de La Rochelle
mais né à Tours, obtint la concession de pêche de l'île Saint-Jean. En
fait, Nicolas Denys avait obtenu la concession de toutes les terres, îles et régions
du littoral continental, comprenant un territoire qui
s'étendait depuis le Cap-des-Rosiers, sur la côte de Gaspé, en passant par toute
l'Acadie continentale, l'île Saint-Jean, l'île Royale, jusqu'aux îles de la
Madeleine. Il s'agissait d'un territoire maritime immense, dont seul un roi
pouvait en principe revendiquer l'équivalent en Europe. La propriété de Nicolas
Denys équivalait à la totalité du littoral atlantique français, rien de moins. Tous
les sites de pêche du golfe Saint-Laurent lui revenaient en exclusivité, mais il
était tenu d'y implanter des établissements permanents et d'y amener des colons,
ce qui fut pratiquement un échec.
|
Après un séjour de
quarante ans en Nouvelle-France, Nicolas Denys retourna en France pour publier
en 1672 le résultat de ses observations en terre d'Amérique sous le titre de
Description géographique et historique des côtes de l'Amérique septentrionale,
avec l'histoire naturelle de ce païs (Paris), un livre qu'il avait écrit à Nipisiguit (baie des Chaleurs en Acadie continentale). Cet ouvrage
demeure encore aujourd'hui l'un des plus précieux documents du
XVIe
siècle sur l'Acadie et la Nouvelle-France. Autrement dit, Nicolas Denys doit sa
célébrité à son livre (publié en deux tomes), dont la valeur historique est considérable,
plutôt qu'à son rôle comme explorateur ou entrepreneur.
-
La situation de l'île après
1713
Après le traité d'Utrecht de 1713,
le roi accorda en 1720 une nouvelle concession à un Normand proche de
Louis XV, Louis-Hyacinthe
Castel, comte de Saint-Pierre et marquis de Crevecoeur et de Kersilis, qui envoya un
groupe de colons l'année suivante, la majorité de ces recrues étant originaires
de la région de La Rochelle et du Poitou. Ils étaient de tous les métiers :
scieurs, tonneliers, taillandiers, charpentiers, menuisiers, maçons, tailleurs
de pierre, couvreurs, matelassiers, portefaix, cultivateurs, boulangers,
bouchers. Il y avait aussi beaucoup d'ouvriers non spécialisés, mais aucun
pêcheur ni marin. On comptait alors une trentaine de femmes. Cette petite
colonie d'une centaine de personnes vécut de 1720 à 1724. Dès 1721, une petite
garnison des Compagnies franches de la Marine fut installée
à Port-la-Joy, dans le sud de l'île; cet
endroit fut choisi en 1722 comme «capitale administrative» de l’île en raison de
son chenal d'entrée étroit et de son havre à la fois large, abrité et facile à
défendre. On y
construisit une caserne, un magasin et une chapelle; suivirent d'autres
bâtiments destinés à divers services, ainsi que des abris pour les animaux. La
pêche y battait son plein et s'est révélé un franc succès. L'île Saint-Jean fut
élevée au rang de «poste du roi» dirigé par un commandant, appuyé par une petite
garnison, approvisionné et financé par l'État. Mais les hivers étaient
difficiles, car environ 20 % des colons décédaient chaque année. En 1724, la compagnie
du comte de Saint-Pierre, la Compagnie de l'île Saint-Jean, fit
faillite. Les colons français et la garnison retournèrent en France, à
l'exception de quelques Acadiens demeurant à Port-la-Joy et tout autour dans
l'île. En octobre 1725, le roi révoqua les lettres patentes de 1722.
L'entreprise du comte de Saint-Pierre ne fut quand même pas inutile, car elle
avait permis la fondation d'établissements comme Port-la-Joy et
Havre-Saint-Pierre (voir
la carte). De plus, la colonie, initialement peuplée presque entièrement
de Français, avait commencé à prendre un visage acadien.
Puis, en 1726, l'île Saint‑Jean passa aux mains des Britanniques
pour être restituée aux Français en 1730. On dénombrait alors
environ 1000 habitants sur l'île
Saint-Jean, dont quelque 200 Acadiens. De nombreux établissements furent fondés un peu partout dans le
centre de l'île: Trois-Rivières, Tracadie, Belair, Anse-aux-Sangliers, La
Traverse, Grande-Anse, Anse-aux Matelots, Anse-du-comte-Saint-Pierre, Anse-à-Pinnet,
etc. Le village de Malpec (Malpèque) fut fondé au nord-ouest. L'immigration française
s'arrêta au milieu des années 1730. Dorénavant, seuls des Acadiens allaient
venir
peupler l'île considérée alors comme une annexe agricole ou le «grenier» de Louisbourg. En 1735,
quelque 37 % de la population était d'origine acadienne, les autres habitants étaient des Français
ou des Basques.
En 1740, ce fut la guerre
de la Succession d'Autriche (1740–1748, traité d'Aix-la-Chapelle), une guerre que les
Britanniques appelèrent "King
George's War" en Amérique du Nord (1744-1748). En raison de la
menace de conflit entre la France et la Grande‑Bretagne, le gouverneur de
l'Île-Royale limita la garnison de Port-la-Joy à 37 soldats, pour finalement
la réduire à un petit détachement symbolique de 18 soldats. À l'automne de 1744, la
garnison se déplaça à Havre-Saint-Pierre, dans le nord de l'île (voir
la carte). Le village de Port-la-Joy fut abandonné, alors que la plupart des
civils suivirent les soldats à Havre-Saint-Pierre.
En juin 1745, un important
contingent armé de la Nouvelle‑Angleterre prit possession de la forteresse de Louisbourg,
à la suite d'un siège de six semaines. Après la reddition de la ville de Louisbourg,
quelque 300 miliciens de la Nouvelle-Angleterre (en fait, la colonie du
Massachusetts) se rendirent à l'île Saint-Jean
afin d'y anéantir la colonie française. Ils débarquèrent à Trois-Rivières dans
l'est de l'île (voir la carte);
une fois arrivés à Port-la-Joy, ils mirent le feu à tous les bâtiments du village
abandonné, et poursuivirent leur route. Tous les habitants avaient déjà fui vers la
France, à l'exception de quelques familles acadiennes qui avaient décidé de
rester. L'île Saint-Jean devint St. John Island, l'île Royale, Cape
Breton Island.
-
La situation de l'île après
1748
Après
le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, l'île Royale et l'île Saint-Jean furent
rendues à la France, en échange de la ville de Madras en Inde que les Français
avaient enlevée aux Britanniques. Si les Français s'estimaient satisfaits, les
Britanniques de la Nouvelle-Angleterre étaient en furie devant la décision du
roi George II, apparemment indifférent à l'effort de guerre des miliciens
coloniaux, les "New Englanders", qui avaient pris Louisbourg. Pour apaiser leur
colère, le gouvernement britannique versera finalement un
dédommagement de quelque 180 000 £ anglaises à la colonie du Massachusetts.
En 1749, Claude-Élisabeth Denys de Bonaventure
(1701-1760), commandant de l'île
Saint-Jean, fut chargé d'y rétablir le chef-lieu de Port-la-Joy. Afin
d'encourager l'immigration, la France avait promis des provisions et du matériel
gratuits aux éventuels colons; de Bonaventure se chargea de leur transport à
l'île et évoqua la perspective de la liberté de culte qui serait refusée aux
Acadiens sous la domination anglaise. Il réussit à attirer environ 1000 nouveaux
colons. Pour promouvoir l'agriculture, il leur interdit la pêche.
- La
population de l'île
En 1751, le colonel Louis
Franquet, un officier ingénieur envoyé par la France comme directeur des
fortifications à Louisbourg (puis pour toute la Nouvelle-France), visita l'île Saint-Jean. Il remit un rapport
recommandant la création de quatre ports avec une garnison, de trois paroisses,
l'autorisation de pêcher, une administration autonome de l'île Royale et des
communications directes avec la France. En 1752, le sieur de La Roque fut
chargé par le comte de Raymond d'effectuer un recensement général des colons dans l'île en
indiquant leur âge respectif, le nombre d'arpents de terre de chacun, la
quantité
de leur bétail, etc. La population totale, à l'exclusion des militaires, était
de 2223 habitants pour 368 familles. Le recensement de 1755 révélait une
population de 2969 habitants, dont 2000 Acadiens qui s'étaient réfugiés à
l'île Saint-Jean en raison de la déportation annoncée par les Britanniques en
Nouvelle-Écosse.
Devant l'imminence de la
guerre (1758), les autorités françaises s'attendaient à ce que les insulaires reçoivent
la visite des Britanniques. Elles armèrent les colons des zones côtières et
leur distribuèrent des munitions. Les femmes et les enfants devaient fuir dans
les bois si l'ennemi approchait. Entre-temps, le commandant de l'île
Saint-Jean depuis le 1er
avril 1754, le major Gabriel Rousseau de Villejouin, un ancien capitaine de
compagnie à Plaisance, envoyait
occasionnellement des Micmacs en Acadie afin de piller et de harceler les
Britanniques. On peut consulter une
carte représentant l'île Saint-Jean en 1758 (cliquer
ICI, s.v.p.), juste avant la prise de Louisbourg et la chute de la colonie
de l'Île-Royale. On constatera que l'île était habitée à peu près partout, sauf
dans l'ouest où il n'y avait qu'un seul village (Malpec).
Les conditions de vie sur
l'île Saint-Jean étaient particulièrement mauvaises pour les militaires
stationnés à Port-la-Joy, ce qui rendait plus forte la tentation de déserter.
Lorsque les soldats étaient envoyés dans des avant-postes, comme Port-la-Joy, ils
perdaient le supplément qu'ils auraient reçu s'ils avaient été employés à la
construction de la forteresse. Pour cette raison, les soldats ne demeuraient
jamais plus d'une année à l'île Saint-Jean. En général, on ne comptait qu'une
quinzaine de soldats dans la garnison avant 1744, puis deux fois plus (30-40)
après 1749.
- Les
langues parlées
Qu'en était-il en ce qui avait
trait aux langues parlées dans l'île Saint-Jean? Si beaucoup de
colons s'exprimaient dans un français populaire, la plupart parlaient aussi le poitevin, la
langue de la province du Poitou, mais les pêcheurs
employaient généralement le
basque. Quoi qu'il en soit, le bilinguisme français-patois était fréquent dans
l'île, car tous étaient en contact avec le «français du roy», que ce soit par
l'entremise des administrateurs, des militaires ou des prêtres. La situation
était différente sur les rives du Saint-Laurent au Canada où les patois étaient
déjà disparus. Mais il ne faut pas oublier non plus les Micmacs qui habitaient
aussi l'île Saint-Jean.
3.5 Les
Indiens micmacs
 |
La colonie de
l'Île-Royale, y compris l'île Saint-Jean, abritait des Indiens micmacs (graphies
possibles: Micmac, Mikmak, Mikmaq ou Mí'kmaq) depuis des
temps immémoriaux. Ils appelaient l'île Royale «Onamag», et celle-ci servait de
siège au grand sachem de tous les Micmacs de cette partie de l'est
de la Nouvelle-France; ils se désignaient eux-mêmes comme les
Onamag. Il y avait des Micmacs sur l'île Saint-Jean (les
Pigtogeoag), sur le littoral de l'Acadie continentale (les
Sigenigteoag et les Epegoitnag), ainsi qu'en Acadie péninsulaire (les Esgigeoag, Segepenegatig et
les Gespogoitnag). La région nommée aujourd'hui «Gaspésie»
sur le continent comptait aussi des Micmacs: les Gespegeoag.
En somme, la
nation micmac comptait sept nations qui occupaient chacune un
territoire défini. Plus à l'ouest vivaient les Malécites et les
Abénakis.
|
-
La langue des Micmacs
Tous ces peuples
parlaient des langues de la
famille algonquienne,
dont font partie le micmac, le malécite et l'abénaki. Les Micmacs de
l'île Royale faisaient usage d'une variété linguistique légèrement
différente de celles employées sur le continent (Acadie). En raison de
leurs contacts fréquents avec les Français, les Micmacs empruntèrent un
certain nombre de mots au français, plus d'une centaine. En voici quelques
exemples:
|
Mots micmacs |
Mots français |
la-siet
atout
puesu
lapol / lebol
putay
tèsipow
laglem
laglos
latusen
mägasün |
< assiette
< atout (jeu de carte)
< boisseau
< bol / tasse
< bouteille
< cheval
< crème
< cruche
< douzaine
< magasin |
À noter la
présence de l'article
français dans certains de ces mots: la-siet (<assiette), lapol / lebol
(<bol), laglem (<crème), etc.
- La population et
les alliances
|

Guerrier micmac vers 1740 |
Dès
la construction de la forteresse de Louisbourg, la plupart des Micmacs
s'installèrent dans le sud de l'île et autour du lac Bras-d'Or
(voir
la carte de l'île Royale), dans de
petits hameaux, mais il y avait un fort groupe
établi à Mirligueche (Malagawatch),
une mission catholique installée près de Port-Toulouse,
où ils recevaient périodiquement la visite des missionnaires français.
La population totale des Micmacs à l'île
Royale ne semble pas avoir dépassé 250 à 300 personnes, mais en 1757, à la
veille du conflit, ils atteindront les 700, pour retomber l'année suivante à
70 à l'intérieur de la forteresse. Seuls quelques
représentants des Micmacs se rendaient occasionnellement à Louisbourg,
qu'ils appelaient Luipo'lk en micmac, par
exemple à l'occasion des baptêmes ou lorsqu'on
les employait comme domestiques ou comme servantes.
Les nations
amérindiennes furent alliées des Français et vécurent en harmonie avec
eux. De façon périodique, les gouverneurs de Louisbourg devaient distribuer
aux Micmacs des présents et leur envoyer des missionnaires en
vue
d'élever les petits enfants «selon les préceptes de la foi»,
mais surtout dans le but de s'assurer la soumission et
l'obéissance des Indiens.
|
Joseph de Monbeton de Brouillan, dit Saint-Ovide,
second gouverneur de Louisbourg,
traduisit l'opinion générale dans une lettre où il demandait des
missionnaires: «Il n'y a que ces gens là qui puissent contenir les Sauvages
dans ce qu'ils doivent être à Dieu et au Roy.» N'oublions pas que les
missionnaires connaissaient fort bien la langue micmac et qu'ils servaient
régulièrement d'interprètes auprès des autorités coloniales.
Évidemment, celles-ci
étaient tout à fait conscientes du fait que le meilleur moyen de consolider
l'alliance franco-micmac était de présenter la fidélité au roi de France et
l'attachement des Micmacs à la religion catholique comme étant deux éléments
indissociables. Ainsi, il apparaissait tout à fait logique de considérer le
rôle du missionnaire comme un intermédiaire incarnant l'alliance à la foi et
au roi. Les autorités françaises profitaient de cette façon de la présence
de certains prêtres, notamment Maillard, Le Loutre et Picquet, pour
mettre sur pied des actions militaires concertées avec leurs alliés
amérindiens. Par exemple, en 1739, dans sa lettre «Déclaration de guerre des
Micmacs aux Anglais s'ils refusent d'abandonner Kchibouktouk (Halifax)»,
l'abbé Maillard montre bien qu'il savait comment gagner l'allégeance des Micmacs
: c'était en les convainquant que le seul moyen de se racheter devant Dieu
consistait à
prouver leur fidélité à son représentant direct sur terre, le roi de France:
|
Il faut penser avant
toutes choses à vous réconcilier dès maintenant au Seigneur par
une humble et sincère déclaration de vos fautes que je vous
exhorte à faire au plûtôt à son ministre; bien entendu que vous
devez commencer par marquer à Dieu un vif repentir de l'avoir
offensé. Purifiez d'abord vos consciences par ce sacrement.
Marchez ensuite, sans que rien soit capable de vous arrêter, à
la deffense d'une ville que notre prince Louis XV votre Père a
fait exprès bâtir sur cette Isle pour mettre par cette
précaution tous ces pays-ci à l'abry des insultes, des
incursions et des ravages que viendroient souvent sans cela
faire des nations non Priantes. Voyci, mes enfans, voicy le
moment venu de vous signaler en zèle, en valeur, et en
obéissance; en zèle pour votre Prière, dont ceux qui maintenant
nous assiégent sont les ennemis jurés. |
Comme on peut le
constater, l'ennemi anglais était diabolisé et présenté comme une «nation
non priante». La crainte de perdre la colonie aux mains des Anglais et de
voir l'œuvre de christianisation anéantie incitait les missionnaires à
prendre une part active en temps de guerre aux conflits franco-britanniques.
-
Le paternalisme français
Certains
gouverneurs ont développé un style très paternaliste lorsqu'ils
s'adressaient aux Indiens, par interprètes interposés, bien sûr. Voici un
extrait d'un long texte rapporté par l'ex-secrétaire du gouverneur
Jean-Louis de Raymond, Thomas Pichon (1700-1781). Alors qu'il avait accès
aux documents officiels, Pichon présentait un passage d'un discours qu'aurait prononcé le
gouverneur de Raymond à l'intention des Micmacs, vers 1751:
|
Si les cendres de
vos peres, de vos meres, de vos femmes, de vos enfans, de vos
parens et amis qui ont été massacrés pouvoient se ranimer et se
faire entendre, elles vous diroient : Ne faites jamais votre
paix sans le consentement de votre soutien ; défiés-vous d'un
ennemi qui ne respire que votre ruine, qui ne veut vous voir
isolés que pour vous entourer plus facilement et vous immoler.
Gardés-vous de recevoir leurs presens. Ils cacheroient sous des
fleurs des serpens qui déchireroient vos entrailles. Elles
ajouteroient : Deputer deux de vous vers vos freres, qu'ils
partent, qu'ils ne perdent point de tems, qu'ils leur fassent connoître le pas dangereux qu'ils ont fait ; qu'ils leur ouvrent
les yeux sur tout ce que je viens de vous dire, et que par ce
moyen ils les empêchent de consommer une paix qui les conduiroit
indubitablement à une ruine totale.
Voilà, mes enfans, ce que ma
tendresse m'a suggeré de vous dire en vous faisant venir ici.
C'est à vous à présent à voir le parti que vous avés à prendre.
|
Ce style
de langage paternaliste (cf. «mes enfans») avait été employé tôt lors de la
colonisation de la Nouvelle-France. Le gouverneur général, le
comte de Frontenac, était
passé maître dans ce domaine.
-
Les soldats étrangers dans l'armée française
Une autre
fait
mérite d'être mentionné: la présence de soldats étrangers de religion
protestante dans l'armée française. Les Micmacs considéraient comme
suspects ces soldats allemands, écossais ou suisses, qui n'étaient pas
catholiques. En 1724, Joseph de Monbeton de Brouillan, dit Saint-Ovide,
gouverneur de Louisbourg,
écrivit au ministre de la Marine,
le comte de Maurepas, pour lui signaler l'inquiétude des Micmacs à ce sujet.
Plus tard, il se plaignit que les officiers du régiment de Karrer
avaient refusé de participer avec leurs soldats à la procession de la
Fête-Dieu qui s'était déroulée dans la ville. Il faut dire aussi que, durant
la troisième semaine de décembre 1744, le commandant du régiment,
Louis-Ignace Karrer, et ses soldats présentèrent au
gouverneur Louis
Dupont du Chambon une pétition dénonçant
«l'injustice qui règne à toutes mains en ce pays». François Bigot, le
commissaire-ordonnateur, avait investi pour son bénéfice personnel dans des
entreprises maritimes l'argent que le roi avait prévu pour la colonie de
l'Île-Royale. Ils accusèrent Bigot et ses amis de vivre comme à Versailles,
alors que les soldats du roi tremblaient de froid et étaient nourris de
légumes pourris. Seuls quelques Français ajoutèrent leur nom à la pétition
suisse. Bigot accusa les Suisses de tous les crimes. L'ordre fut rétabli,
mais le malaise persista au sein de la garnison suisse bien déterminée à
livrer la forteresse aux Anglais le printemps venu.
Si Versailles
estimait que l'île Royale et la forteresse de Louisbourg présentaient un
intérêt stratégique considérable, l'attachement pour la colonie elle-même,
de même que pour les colons qui y habitaient, était faible ou presque nul.
Quant aux peuples autochtones, ils étaient considérés comme des pions dans une
partie d'échecs à l'échelle mondiale, non comme des partenaires qu'il fallait
encourager à avancer de leur propre initiative.
Les autorités de
Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-Écosse avaient mesuré très vite
l'intensité de la
concurrence que
représentait la présence de Louisbourg avec les colonies anglaises. Comme les
Britanniques ne disposaient pas de ressources immédiates pour
coloniser l'Acadie, qui était peuplée alors d'environ 1700 habitants très
majoritairement francophones, ils
prirent le parti de se concilier la population afin d'éviter son exode sur l'île
Royale. Pendant les décennies qui suivirent sa fondation, Louisbourg connut la
paix et la prospérité. En 1737, la valeur des exportations de morue de l'île
Royale était huit fois supérieure à la valeur de la traite des fourrures au
Canada à la même époque. Les principaux marchés d'exportation demeuraient la
France et les Antilles. Les marchands de la Nouvelle-Angleterre
acceptaient pour leur part très mal l'emprise de la forteresse de Louisbourg
devenue un centre commercial florissant et un sérieux concurrent pour eux. Le
succès des pêcheries de l'île Royale était tel qu'il entraînait le déclin de
l'industrie de la pêche dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Les
Acadiens de la Nouvelle-Écosse participaient à ce fructueux commerce avec l'île
Royale, même si cela leur était interdit.
Pour le gouverneur du
Massachusetts, William Shirley, Louisbourg était un repaire de pirates qui
ruinaient les pêcheries et le commerce britannique. Tant que l'île et la
forteresse appartiendraient aux Français, la Nouvelle-Écosse serait en péril; et
si cette province retombait entre leurs mains, il y aurait 6000 ou 8000 ennemis
de plus à combattre. Selon Shirley, en conquérant Louisbourg, les Britanniques porteraient un
coup mortel aux pêcheries françaises. Les Français, de leur côté, se doutaient bien que
le spectre de la guerre planait sur cette place forte dont le rôle était
déterminant
dans la lutte qui les opposait aux Anglais pour la maîtrise de l'Amérique du Nord.
4.1 La
première occupation britannique de 1745
En 1740, la guerre de
Succession d'Autriche éclata entre la
France et la Grande-Bretagne. C'est alors que les Bostonnais incitèrent le gouverneur
du Massachusetts, William Shirley (1694-1771) et l'amiral
Peter Warren (1703-1752) à attaquer Louisbourg.
En 1745, informés de la démoralisante situation dans laquelle se trouvait la
forteresse dont les troupes, mal approvisionnées, menaçaient de se mutiner, des
Britanniques de la Nouvelle-Angleterre décidèrent de s'emparer de la forteresse
de Louisbourg.
 |
En mai 1745, donc deux ans après la fin des travaux de la forteresse,
une flotte de 90 navires, dont 10
vaisseaux de guerre, et 4200 hommes assiégèrent la ville de Louisbourg.
La ville fut pilonnée jour et nuit. Le 25 juin, après un siège de près de sept
semaines, les habitants de la ville supplièrent le
gouverneur du Chambon de capituler.
Parmi les termes de la
capitulation signée par le gouverneur du Chambon, l'amiral Peter
Warren et le commodore William Pepperrell, figurait
la permission pour tous les officiers de la garnison et les
habitants de la ville de continuer à demeurer dans leurs maisons et
de jouir du libre exercice de leur religion ; de plus, il était
stipulé «que nul ne soit autorisé à les molester ou à les maltraiter
jusqu’à ce qu’ils puissent être transportés en France». |
|
Deuxièmement,
que tous les tous les officiers de la garnison et les habitants
de la ville puissent demeurer dans leurs maisons avec leurs
familles et pratiquer librement leur religion et que nul ne soit
autorisé à les molester ou à les maltraiter jusqu’à ce qu’ils
puissent être transportés en France. |
Le 28 juin, les
troupes de la Nouvelle-Angleterre prirent possession de la ville. Afin
d'inciter les colons britanniques à s'enrôler dans la milice pour la
campagne contre Louisbourg, les autorités leur avaient promis une part
du butin après la victoire. Or, les Français avaient obtenu le droit de conserver leurs biens et de ne pas être molestés. Les
miliciens se sentirent trahis par leurs chefs et en réaction ils
harcelèrent et humilièrent les habitants français. Puis la milice
coloniale fut remplacée peu après par des troupes de Sa Majesté
britannique. Le commandant de l'escadron britannique, Peter Warren, fut
nommé gouverneur de l'île Royale et promu au rang de contre-amiral.
À la nouvelle de la prise
de Louisbourg, le 3 juillet 1745, les cloches de Boston carillonnèrent à toute volée, suivies
de réjouissances générales dans toute la ville. La prise de Louisbourg
signifiait la ruine du Canada et de sa pêche, laquelle représentait l'entreprise
la plus rentable de la Nouvelle-France pour Versailles.
La garnison française fut
rapatriée en France au mois d'août 1745, tandis que la plupart des pêcheurs
étaient déportés soit en France soit au Canada. Seuls quelques centaines
d'Acadiens demeurèrent sur l'île Royale, redevenue "Cape Breton Island"
('île du Cap-Breton). La forteresse
s'appela durant quatre ans Louisburg (sans le -o de la seconde syllabe).
Après la chute de
Louisbourg, les Abénaquis voulurent quitter l'île. Une délégation vint
trouver le gouverneur à Québec,
le marquis de Beauharnois, afin de venir vivre auprès de leurs «amis
français», loin de leurs «ennemis anglais». Le gouverneur réussit fort
habilement à les persuader de retourer sur leurs terres de sorte qu'ils
puissent plus utilement harceler les Anglais.
En France, le ministre de la Marine,
le comte de Maurepas, ordonna une enquête sur la mutinerie du mois de
décembre précédent à Louisbourg. Quelques soldats du régiment suisse
furent pendus, voire décapités ou condamnés aux galères du roi.
L'ex-gouverneur du Chambon tenta de justifier la défaite française en
disant que les 1200 habitants de Louisbourg ne pouvaient que se rendre
devant plus de «13 000» Anglais. En fait, la forteresse comptait moins
de 700 soldats et une population civile de 2500 à 3000 personnes; quant
aux Britanniques, ils étaient 4200. Du Chambon avait donc dû mentir. Les
captures de guerre rapportèrent à l'amiral Peter Warren au moins 126 000
livres anglaises, dont pas moins de 53 000 lui venaient du butin
rapporté de Louisbourg. Ce fut sans doute l'un des butins de guerre les
plus considérables qui ait été accumulés avant la guerre de Sept Ans.
Warren put investir ses capitaux en propriétés foncières et en prêts
dans différentes colonies d’Amérique, particulièrement à New York, mais
également en Angleterre et en Irlande.
- Une occupation
meurtrière
La
prise de Louisbourg, une initiative
des colons de la Nouvelle-Angleterre, visait à réduire à néant les
concurrents français dans l'industrie de la pêche, mais elle fut aussi interprétée comme une victoire du protestantisme sur le papisme. Pour
beaucoup de militants protestants, les différences doctrinales
justifiaient à elles seules une croisade contre la ville.
Durant trois ans, la forteresse resta sous le contrôle des Britanniques,
mais son occupation se révéla meurtrière pour les occupants: plus de 1500 soldats
de la Nouvelle-Angleterre périrent en 1749 en raison des mauvaises conditions sanitaires et des
difficultés de ravitaillement, soit 12 fois plus que pendant le siège. Quant aux
autres, leur état de santé laissait grandement à désirer. Le scorbut, la
dysenterie et la fièvre emportèrent une grande partie de la garnison. Dans la
forteresse régnèrent le mécontentement, la frustration et l'indiscipline.
De son côté, le gouverneur Warren se
méfiait des Acadiens demeurés dans l'île. Il estimait qu'ils ne deviendraient
jamais de «fidèles sujets de Sa Majesté» britannique. Il suggéra à l'Amirauté de
considérer un déplacement des Acadiens dans les colonies du Sud plus peuplées.
Il comptait aussi envahir l'île Saint-Jean et d'en déporter les habitants. Pour
lui, la prise de Louisbourg ne constituait que la première étape de la conquête
du Canada et par la suite de toute la Nouvelle-France.
- La tentative
avortée des Français
Humiliés, les Français tentèrent un grand coup
pour reprendre Louisbourg et la Nouvelle-Écosse. Le roi
Louis XV chargea le duc d'Anville
du commandement d'une flotte de 65 à 72 navires, dont 40 vaisseaux de guerre, et d'environ 11 000 hommes, soit la
plus grande flotte jamais nolisée en France «pour les affaires du Canada», même
s'il s'agissait de la colonie de l'Île-Royale qui ne faisait pas partie de la
colonie du Canada. En plus de reprendre Louisbourg et l'Acadie des mains des
Anglais, d'Anville avait reçu l'ordre de bombarder Boston et d'attaquer les
Antilles anglaises. Toutefois, les malheurs devaient
s'abattre sur la flotte française. D'abord, d'Anville avait mis trois mois au lieu de six
semaines pour traverser l'Atlantique, puis des maladies apparurent à bord des
navires, notamment le typhus et le scorbut, terrassant des centaines de soldats
et de marins. Des pêcheurs anglais avertirent Boston qu'ils avaient vu la plus
grande flotte de leur vie, une flotte française. Cette annonce causa en 1746 la consternation dans toute
la Nouvelle-Angleterre. Le gouverneur Shirley aux ministres protestants de
demander la protection du Tout-Puissant contre les Français qui allaient envahir
le pays. Un ouragan s'abattit sur Boston, mais empoigna en même temps les
navires français devant l'île de Grand-Maman dans la baie de Fundy avec comme
résultat que la flotte française fut décimée
par les violentes tempêtes qui firent disparaître la moitié des effectifs. De la
formidable flotte de d'Anville il ne restait plus qu'une
poignée de bâtiments en piteux état.
Six jours après son arrivée en
Nouvelle-Écosse (Chibouctou), l'amiral Jean-Baptiste Louis Frédéric de La
Rochefoucauld, duc d'Anville, se donna la mort. Les habitants de la
Nouvelle-Angleterre crurent que Dieu les avait défendus et qu'il avait puni les
Français pour leurs péchés. À partir de ce moment, les colonies britanniques se crurent en danger devant une éventuelle menace
française. Elles coururent aux armes et rassemblèrent plus de 8000 miliciens au
secours de Boston.
- Une
perte trop importante
On connaît le point de vue
de Voltaire sur la Canada qu'il se représentait comme «quelques arpents de neige»,
mais il s'était par contre fait une toute autre opinion de Louisbourg et de l'île Royale. Voici ce
qu'écrivait le grand pamphlétaire à propos de la prise de Louisbourg de 1745 par les Britanniques :
|
Je veux parler du siége de Louisbourg ; ce ne fut point une
opération du cabinet des ministres de Londres, ce fut le fruit de
la hardiesse des marchands de la nouvelle Angleterre. Cette colonie,
l'une des plus florissantes de la nation anglaise, est éloignée
d'environ quatre-vingts lieues de l'île de Louisbourg ou du
Cap-Breton, île alors importante pour les Français, située vers
l'embouchure du fleuve St Laurent, la
clef de leurs possessions dans le nord de l'Amérique. Ce territoire
avait été confirmé à la France par la paix d'Utrecht. La pêche de la
morue qui se fait dans ces parages était l'objet d'un commerce
utile, qui employait par an plus de cinq cents petits vaisseaux de
Bayonne, de St Jean-de-Luz , du Havre-de-Grace & d'autres villes ;
on en rapportait au moins trois mille tonneaux d'huile, nécessaires
pour les manufactures de toute espèce. C'était une école de matelots
; et ce commerce, joint à celui de la morue, faisait travailler dix
mille hommes et circuler dix millions [de livres]. |
Dans le camp britannique, beaucoup
d'observateurs de l'époque partageaient l'avis des Français sur
l'importance cruciale de Louisbourg, mais c'était pour exprimer une menace qu'il
fallait éliminer. Or, les troupes de la Nouvelle-Angleterre, des miliciens sans
expérience, avaient réussi à
s'emparer de la ville fortifiée réputée pourtant «invincible».
 |
Aujourd'hui, en souvenir
de la prise de Louisbourg par les Bostonnais, il existe dans le chic
quartier de Beacon Hill de la ville de Boston un parc appelé "Louisburg
Square" (voir la photo de gauche), à l'angle de Mount Vernon Street, où l'on trouve de
nombreuses maisons construites en briques au cours des années 1826
et 1840. C'est un square résidentiel hérité de l'architecture
anglaise londonienne. |
4.2 Le
traité d'Aix-la-Chapelle de 1748
La guerre de Succession
d'Autriche avait coûté
cher à l'Europe occidentale, surtout à la France dont les finances avaient été
durement éprouvées par cette guerre inutile. Les grandes puissances finirent par accepter un
retour au statu quo ante bellum, c'est-à-dire le retour à la
situation préexistante. La France et la Grande-Bretagne durent donc remettre
les places prises durant les hostilités. Le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748 rendait
l'île Royale à la France, ainsi que l'île Saint-Jean.
Mais le climat en
Amérique du Nord continuait d'être très tendu et inquiétait le gouvernement
français, car l'immigration française, trop limitée, ne permettait pas à la
France d'assurer un contrôle réel et une défense efficace de son empire
colonial. Pour les colons de la Nouvelle-Angleterre, la restitution de Louisbourg n'était qu'un «prêt»
temporaire aux Français. En décembre 1754, Pierre-Jérôme
Lartigue, garde-magasin du roi, écrivit au colonel Michel Le Courtois de Surlaville,
commandant des troupes à Louisbourg: «Je puis vous assurer que je leur ay souvent entendu dire qu'en nous
rendant Louisbourg, ils ne nous avoient fait qu'un prest.» Le sieur de
Surlaville avait bien compris lors d'un séjour à Halifax que, pour les
Britanniques, la rétrocession de Louisbourg n'était que provisoire.
Évidemment, le traité
d'Aix-la-Chapelle mécontenta grandement les colons de la Nouvelle-Angleterre qui avaient
conquis Louisbourg, notamment le gouverneur William Shirley et l'amiral Peter Warren.
En Grande-Bretagne, l'opinion publique se révolta et critiqua sévèrement la teneur du traité,
rédigé en français, ainsi que les concessions faites par les
plénipotentiaires de la Grande-Bretagne.
L'opinion française, de son côté, était
toute aussi mécontente contre son gouvernement; elle lui reprochait de n'avoir
pas su exploiter les succès de ses armées et ses victoires. De fait, lors des négociations de
paix à Aix-la-Chapelle, Alphonse-Marie-Louis,
comte de Saint-Séverin d'Aragon,
ministre représentant du roi de France, n'avait rien exigé pour son pays. Il
avait annoncé aux plénipotentiaires : «Sa Majesté
très chrétienne a le souci de faire la paix, non en marchand mais en roi.» Les
Britanniques étaient restés stupéfaits!
Quant aux Canadiens, ils reprochaient à
Louis XV de ne pas en avoir profité pour reprendre l'Acadie. Bref, personne n'était
satisfait, car rien n'était réglé. C'est
d'ailleurs depuis le traité de paix de 1748 qu'est entrée dans l'usage l'expression
populaire «bête comme la paix».
De plus, les Français savaient dorénavant qu'ils pouvaient perdre toute la
Nouvelle-France, en commençant pour Louisbourg, alors que les Britanniques s'étaient mis à craindre pour leurs
colonies et à convoiter de nouveaux territoires.
Le plan des Britanniques
consistait à confiner le Canada au nord des Grands Lacs et du Saint-Laurent
afin de permettre l'expansion de la Nouvelle-Angleterre, ce qui en même
temps aurait l'avantage de porter un coup terrible au prestige de la France,
qui verrait le Canada coupé de la Louisiane et de Louisbourg.
Dans ces conditions, la paix ne pouvait être que très provisoire. Prévenir les
conflits exigeait de la perspicacité et une forte autorité, des atouts dont
ne disposait
manifestement pas Louis XV.
4.3
La paix provisoire
Dans
les circonstances, l'attitude tant de la France
que de la Grande-Bretagne resta belliqueuse dans les années qui suivirent. En
juillet 1749, pendant que les Français revenaient occuper Louisbourg, les Anglais fondaient
la ville d'Halifax en l'honneur de George Dunk, comte de Halifax, qui en dirigeait la
colonisation. C'est toutefois le général Edward Cornwallis qui avait fondé la ville, le 9
juillet 1749, sur le lieux de Chebucto, appelé auparavant Chibouctou en
français, d'un nom micmac. La fondation d'Halifax était destinée à
concurrencer le port français de Louisbourg et à devenir le centre névralgique de
la Nouvelle-Écosse.
- La
rétrocession de Louisbourg
Le 23 juillet suivant, le nouveau gouverneur français de Louisbourg, Charles des Herbiers de La Ralière (1700-1752),
recevait en grande pompe les clefs de la ville des mains du gouverneur
britannique Peregrine Hopson, ce qui consacrait la rétrocession de Louisbourg et
de l'île Royale à la France. Mais les Français reprenaient possession
de la forteresse dans un état lamentable. La politique française exigeait
dorénavant une forteresse nouvelle et plus forte à Louisbourg et, par
conséquent, des troupes plus nombreuses pour sa reconstruction et sa défense. Il
fallait aussi rétablir la pêche à la morue. Sur l'île Royale, il ne restait
plus que 700 habitants, presque tous des Acadiens. Le successeur de Charles des
Herbiers, Augustin Boschenry, chevalier de Drucourt,
accéda à son poste de nouveau
gouverneur de Louisbourg, le 15 août 1754; il était accompagné de son épouse,
Marie-Anne Aubert de Courserac, et de plusieurs domestiques. Il était plutôt
rare à l'époque qu'un gouverneur de haut rang soit accompagné de sa famille dans
les colonies, ce qui pouvait témoigner de l'importance de ses fonctions à Louisbourg.
Évidemment, les actions
jumelées de 1749 survenaient dans une atmosphère de guerre anticipée entre les
deux empires. Personne ne croyait que le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748 allait
assurer une paix durable.
Seuls les Micmacs de la
région ne se sentirent pas concernés; ils n'avaient jamais pris part aux
négociations ni au traité. Cependant, ils n'apprécièrent guère la fondation de
la ville d'Halifax par les Britanniques. Ils firent parvenir une lettre, en
versions française et micmac (sans doute avec l'aide d'un missionnaire français),
au gouverneur Edward Cornwallis, qui commençait pas ces mots:
|
Seigneur,
L’endroit où tu es, où tu fais des habitations, où tu bâtis un fort,
où tu veux maintenant t’introniser, cette terre dont tu veux
présentement te rendre maître absolu, cette terre m’appartient ;
j’en suis certes sorti comme l’herbe, c’est le propre lieu de ma
naissance et de ma résidence, c’est ma terre à moi, sauvage; oui, je
le jure, c'est Dieu qui me l'adonnée pour être mon pais à perpétuité
[...] un ver de terre sçait regimber quand on l'attaque. Moy,
sauvage, il ne se peut que je ne croye valoir au moins un tant soit
peu plus qu'un ver de terre, à plus forte raison sçaurai-je me
défendre si on m'attaque. Ta résidence au Port-Royal ne me fait pas
ombrage. Car tu vois que depuis long temps je t'y laisse tranquille,
mais présentement tu me forces d'ouvrir la bouche par le vol
considérable que tu me fais. |
Les
fonctionnaires britanniques qui reçurent cette lettre ne manifestèrent, il va
sans dire, qu'une
totale indifférence aux doléances des «Sauvages». La fondation d'Halifax
constituait
une priorité impériale pour contrebalancer Louisbourg. Aucune lettre de
protestation n'aurait pu convaincre les Britanniques de reculer sur cette
question fondamentale. D'ailleurs, Halifax allait immédiatement affaiblir les
présences acadienne et micmac dans cette région de la Nouvelle-Écosse, tout en
apportant un contrepoids à la forteresse de Louisbourg.
- La
recolonisation de l'île Royale
De son côté, lorsque la
France sut que la colonie de l'Île-Royale allait lui revenir, elle entreprit une
campagne de ratissage dans les différents ports français afin d'engager le
processus de recolonisation de l'île Royale. Les anciens colons déportés
s'étaient réfugiés dans les régions côtières de l'ouest de la France:
Saint-Malo
(Bretagne), Rochefort (Poitou), Bordeaux (Guyenne), Bayonne (Pays basque) et
Saint-Jean-de-Luz (Pays basque). Nous ignorons si les fonctionnaires ont exercé
des pressions pour garder les colons «disponibles», afin de pouvoir les
retrouver au moment voulu. Nous savons cependant qu'il n'était pas question de
renvoyer dans l'île Royale toutes les personnes qui s'y trouvaient avant sa
chute en 1745; il fallut éliminer les infirmes, les vieux et les indigents. À
l'été de 1749, près de 2000 civils, hommes, femmes et enfants, étaient de retour
à la forteresse. Quelque 45 personnes n'avaient pas fait la traversée en 1745 et
étaient restées sur l'île, malgré la présence britannique. En 1752, on dénombrera
2490 civils à Louisbourg, dont 1969 à l'intérieur de la forteresse et 521 à
l'extérieur des murs.
En ce qui concerne les militaires,
l'administration renvoya à Louisbourg les soldats des Compagnies franches de la
Marine, stationnés à Rochefort ou à l'île de Ré, mais cette fois-là sans le
régiment allemand de Karrer. La perte de l'île Royale avait convaincu le
ministre Maurepas qu'il fallait une
plus forte garnison à Louisbourg. Il dépêcha le double de soldats: de 500 en
1745, on passa à plus de 1000, puis à 3500 l'année suivante. Mais, ayant
contrarié Mme de Pompadour, la maîtresse du roi, Maurepas fut limogé et remplacé
par Antoine-Louis Rouillé, comte de Jouy,
comme secrétaire d'État de la Marine et des Colonies. C'est lui qui dirigera
pour un temps les destinées de l'île Royale.
-
L'expansion française envisagée
En mai 1747, Roland-Michel Barrin,
marquis de La Galissonnière, fut désigné
gouverneur général de
la Nouvelle-France. Il élabora pour les colonies françaises une politique active
d'expansion territoriale et de lutte contre l'influence anglaise, notamment pour
la vallée de l'Ohio en direction de la Louisiane, vers les Grands Lacs, l'Acadie
et Louisbourg. Il rédigea un «Mémoire sur les colonies de la France dans
l'Amérique septentrionale», dans lequel il montra une lucidité remarquable sur la
politique anglaise en Amérique du Nord. En 1750, il signalait ainsi l'inquiétude
que provoquaient les Britanniques en Amérique du Nord :
|
Tandis que la paix paroit avoir comme assoupi la jalousie des
Anglais en Europe, elle éclate dans toute sa force en Amérique ; et
si on n'y oppose dès a present des barrières capables d'en arrêter
les effets, cette Nation se mettra en état d'envahir entièrement les
Colonies françoises au commencement de la premiere guerre. |
Ce mémoire de décembre
1750 présentait les «raisons essentielles et capitales» de veiller avec soin à
la conservation, à la
consolidation et à l'expansion de la colonie. La Galissonnière dut envoyer des
troupes pour stopper l'expansion anglaise en Acadie continentale qui avait été la première
région contestée de la Nouvelle-France; il s'agissait du territoire constituant
aujourd'hui le Nouveau-Brunswick. À la signature du traité d'Utrecht en 1713, l'article 12
du texte était demeuré ambigu, de sorte que les limites de
l'Acadie furent contestées de part et d'autre... durant quarante ans.
|
Article 12
Le Roy T.C. fera
remettre à la Reine de la G.B. le jour de l'échange des
ratifications du présent traité de paix, des lettres et actes
authentiques qui feront foi de la cession faite à perpétuité à la
Reine et à la couronne de la G.B. de l'isle de Saint-Christophe que
les sujets de Sa Majesté B. désormais posséderont seuls, de la
nouvelle Ecosse autrement dite Acadie, en son entier conformément à
ses anciennes limites, comme aussi de la ville de Port-Royal,
maintenant appelée Annapolis-Royale, et généralement de tout ce qui
dépend desdites terres et isles de ce païs là, avec la souveraineté,
propriété, possession et tous droits acquis par traitez ou autrement
que le Roi T.C., la couronne de France ou ses sujets quelconques ont
eus jusqu'à présent sur lesdits isles, terres, lieux et leurs
habitants, ainsi que le Roi T.C. cède et transporte le tout à ladite
Reine et à la couronne de la G.B., et cela d'une manière et d'une
forme si ample qu'il ne sera pas permis à l'avenir aux sujets du Roy
T.C. d'exercer la pêche dans lesdites mers, bayes, et autres
endroits à trente lieues près des costes de la nouvelle Ecosse, au
Sud-Est en commençant par l'isle appelée vulgairement de Sable
inclusivement et en tirant au Sud-Ouest. |
Pour la France, l'Acadie
anglaise se limitait à la Nouvelle-Écosse; pour la Grande-Bretagne, elle
incluait aussi une partie de ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Brunswick et
l'île du Prince-Édouard.
- Les
frontières de l'Acadie
La France
et la Grande-Bretagne avaient formé en 1750 une commission mixte pour fixer les
frontières de l'Acadie. Le marquis de La Galissonnière et Étienne de Silhouette
(personnage qui allait donner à la langue française le mot «silhouette») faisaient
partie de la délégation française; William Shirley et le diplomate anglais William Mildmay
représentaient la délégation anglaise. Pour les Anglais, toute la région de la
rivière Saint-Jean comprise entre Canseau (Canso) et Gaspé était territoire anglais,
une prétention que les Français trouvaient nettement exagérée. C'était couper toute
communication par terre avec le Canada et l'île Royale (Louisbourg). Les négociations
perdurèrent délibérément sans grands résultats jusqu'en 1755 à Paris. La Galissonnière,
à bout de patience, décida unilatéralement que la
France possédait tout l'isthme de
Chignectou (près de la Nouvelle-Écosse), ainsi
que toute la baie Française (baie de Fundy). Par la suite, le gouverneur de
La Jonquière, successeur de Galissonnière, allait ériger sur la
frontière ainsi tracée les forts Beauséjour et Gaspéreau.
Entre-temps, la
situation des Acadiens se compliquait, car ils étaient pris entre deux feux.
Leur neutralité ne pouvait plus durer indéfiniment en Nouvelle-Écosse. Depuis la
signature du traité d'Aix-la-Chapelle (1848), plus de 3000 d'entre eux,
fortement encouragés par l'administration française, avaient
émigré en «Acadie française», donc au «Nouveau-Brunswick», mais aussi en Gaspésie, à l'île
d'Anticosti, à l'île Royale et à l'île
Saint-Jean.
- La déportation des
Acadiens
L'arrivée en Nouvelle-Écosse d'environ
2000 colons britanniques et d'un fort contingent militaire avait changé de façon
irréversible le visage de cette colonie anglaise peuplée majoritairement
jusqu'alors d'Acadiens, lesquels
devenaient dorénavant moins utiles à l'agriculture. La même année, le gouverneur
Edward Cornwallis (1713-1776) demanda à la population
acadienne de prêter inconditionnellement un serment d'allégeance à la Couronne
britannique sous peine d'être expulsée. Les Acadiens refusèrent et Cornwallis dut
reculer. C'est alors que Charles Lawrence, nommé lieutenant-gouverneur en 1753,
envisagea d'expulser tous les Acadiens du territoire de la Nouvelle-Écosse afin de
faciliter le développement d'une colonie anglaise et protestante, fidèle au roi
d'Angleterre. Il s'agissait
d'une opération de
nettoyage ethnique de grande envergure, car elle
allait durer sept années, soit de 1755 à 1762.
L'opération
consistait à exiler presque toute la population, en principe de 12 000 à 15 000
personnes.
Si la plupart des Acadiens furent envoyés en Nouvelle-Angleterre, d'autres
furent déportés jusqu'en Angleterre, alors que plusieurs se réfugiaient dans les bois situés en
«Acadie française», qui est aujourd'hui le Nouveau-Brunswick. Après
avoir transité par l'Angleterre et la France, des milliers d'Acadiens
allaient s'exiler en Guyane française et dans les îles Malouines, mais
surtout en Louisiane devenue espagnole.
Des centaines
d'Acadiens fuyant la Nouvelle-Écosse s'établirent sur l'île Royale; la colonie
comptera plus de 4000 habitants en 1755.
Pendant ce temps, la
guerre de Sept Ans avait commencé en 1756. Le 18 mai de cette année-là, la
Grande-Bretagne avait déclaré formellement la guerre à la France à la suite de
l'attaque prussienne contre la Saxe. Tandis que la France se concentrait d'abord
sur sa stratégie européenne, la Grande-Bretagne chercha à profiter de ce conflit
pour régler définitivement les problèmes en Amérique et affirmer sa mainmise sur
tout le continent, de la baie d'Hudson jusqu'aux Antilles.
Pour le premier ministre
de la Grande-Bretagne, William Pitt (1708-1778) dit "William Pitt l'Ancien", Louisbourg était la clé pour attaquer le
Canada et anéantir la Nouvelle-France. Le pari de Pitt était le suivant: gagner
un conflit européen en obtenant des victoires en Amérique du Nord. L'objectif
final était de mettre fin à l'empire français en Amérique du Nord. L'Angleterre pouvait
alors aligner quatre fois plus de vaisseaux et cinq fois plus
d'hommes que la France. Ajoutons que William Pitt avait obtenu du
Parlement des crédits vingt fois supérieurs à ceux de la France pour
entreprendre une guerre offensive. Il fallut donc emprunter des sommes
considérables à l'étranger, probablement plusieurs centaines de millions. Quant aux colons de la
Nouvelle-Angleterre, ils n'avaient
pas oublié la concurrence féroce de Louisbourg dans l'industrie de la pêche et les
dispositions du traité d'Aix-la-Chapelle de
1748, qui avait redonné Louisbourg aux Français, privant ainsi les colonies
britanniques de leur victoire.
C'est pourquoi les autorités de la
Nouvelle-Angleterre et de la Grande-Bretagne entreprirent une nouvelle expédition en 1757 dans le but de reprendre
la forteresse. Ils firent cependant halte à Halifax parce qu'ils n'étaient pas
suffisamment prêts à affronter la présence d'une importante flotte française. La France avait
en effet envoyé trois escadres composée de 18 vaisseaux de guerre
et de cinq frégates armés au total de 1400 canons. Le port de Louisbourg n'avait
jamais accueilli de flotte aussi imposante; ce fut d'ailleurs la dernière fois. Les
Britanniques n'osèrent pas engager le combat naval.
L'année suivante, les Britanniques
allaient se reprendre en utilisant davantage de moyens, notamment en organisant
un formidable blocus non seulement autour de Louisbourg afin de supprimer tout
ravitaillement français en Nouvelle-France (provisions, troupes, navires de
guerre), mais également autour des ports français de Rochefort dans l'Atlantique
et de Toulon en Méditerranée, ce qui devait empêcher tout ravitaillement vers les
colonies. C'est ainsi que trois importantes escadres françaises furent
bloquées tout l'été de 1758, alors que cet apport de troupes aurait pu changer
l'issue du conflit. Au milieu de l'année 1758, il y eut davantage de soldats
britanniques en Amérique du Nord que dans toutes les garnisons et les armées
britanniques en Europe continentale. Alors que la France peinait à dépêcher
quelque 6800 soldats pour la colonie de l'Île-Royale, le premier ministre anglais
William Pitt y expédiait 32 000 «habits rouges», sans compter les 20 000 miliciens
de la Nouvelle-Angleterre.
5.1
L'attaque finale
Au
début du mois de juin 1758, une flotte de 40 navires de guerre équipés de 1842
canons, sous les ordres de l'amiral
Edward Boscawen, escortée de 127 vaisseaux transportant plus de 14 000
hommes de troupes et 12 000 marins, se présenta au large de l'île Royale, devant Louisbourg.
C'était la plus imposante force armée jamais rassemblée par la
Grande-Bretagne en Amérique du Nord. Quant à la forteresse
de Louisbourg, elle comptait
alors 400 canons, 3500 soldats, 3500 marins et un certain nombre d'Indiens;
le port abritait 13 vaisseaux français de bonne taille. Grosso
modo, en incluant les civils, on comptait peut-être jusqu'à 30 000 personnes
dans le camp des Britanniques et 10 000 dans le camp des Français. Aux 40
vaisseaux de guerre britanniques, les Français ne pouvaient en opposer que six.
 |
France
Grande-Bretagne
Forces en présence |
3500 soldats
3500 marins
6 navires de guerre
10 vaisseaux de transport
10 frégates |
14 000 soldats
12 000 marins
40 navires de guerre
127 vaisseaux de transport |
|
Pertes |
102 morts
303 blessés
6600 prisonniers
4 navires brûlés
1 navire capturé |
172 morts
355 blessés |
|
Augustin de Drucourt
était le gouverneur de Louisbourg, l'amiral Jean-Antoine Charry
de
Desgouttes, assisté de l'officier de marine Louis-Joseph Beaussier
de Lisle, avait la responsabilité de la flotte française. Or,
l'harmonie était loin de régner au sein des forces françaises
unifiées, notamment entre les officiers de terre et les officiers de
mer. Le
commandant en chef de l'armée britannique était le colonel
Jeffrey Amherst, pendant que le brigadier-général
James Wolfe,
sous les ordres de l'amiral Edward Boscawen, assurait la
responsabilité du débarquement, lequel devint le plus grand
débarquement naval n'ayant jamais eu lieu en Amérique du Nord.
Le siège commença le 8 juin
avec le débarquement sur les plages de Louisbourg; il
allait se
terminer le 27 juillet 1758 par la capitulation des Français. Dès
le débarquement des Britanniques, l'issue du
combat était dans les faits prévisible, étant donné les forces inégales
engagées dans les deux camps. Après les bombardements incessants, après
l'élimination de la flotte française dans le port et après la destruction de
toute la ville, malgré les efforts des soldats français, malgré le courage
de Mme Aubert de Courserac, la femme du gouverneur, qui n'hésita pas à tirer
du canon, la chute de la forteresse était inéluctable. Français et
Britanniques le savaient depuis le premier siège de 1745: la France était
incapable de déployer des forces équivalentes à celles de la Grande-Bretagne.
Le colonel
Amherst et l'amiral Boscawen refusèrent de négocier la capitulation avec le
gouverneur Drucourt; ils l'imposèrent simplement. Lorsque Drucourt ouvrit la lettre rédigée en français —
la langue de la diplomatie à l'époque —
envoyée par Amherst et Boscawen, il apprit que la Royal Navy devait entrer
dans la rade le lendemain et qu'une «attaque générale» suivrait. Afin
d'éviter un «effusion de sang», il faudrait que tous les militaires se
rendent comme «prisonniers de guerre», et ce, sans conditions. Les
commandants britanniques terminaient leur lettre en informant le gouverneur
qu'il avait une heure pour donner sa réponse:
|

Jeffrey Amherst, 1758 |
En réponse du billet que je vient d' avoir l'honneur de
recevoir de votre excellence par les mains du sieur Loppinot.
Je n'ai à répondre à votre excellence qu'il a été
décidé par son excellence l'amiral Boscawen et moi que
ses vaisseaux devaient entrer demain pour faire une
attaque générale sur la ville.
Votre excellence sait
fort bien la situation de l'armée et de la flotte, et
comme son excellence Monsieur l' Amiral ainsi que moi
désirons forts d'éviter l'effusion du sang, nous donnons
une heure après le reçu de celle ci que votre excellence
peut se déterminer de capituler comme prisonnier de
guerre ou prendre toutes les mauvaises conséquences
d'une défense contre cette flotte et l' armée.
Nous avons
l'honneur d'être avec des très parfaites considérations,
Boscawen, Jeff Amherst |
|
Évidemment, les Français
furent stupéfiés, sinon scandalisés, d'une proposition aussi humiliante, alors
qu'ils avaient combattu vaillamment durant des semaines. Le conseil de guerre
français décida qu'il fallait «se defendre jusqu'à la derniere extremité». Le
conseil soumit une proposition de capitulation de seize articles prévoyant,
entre autres, les «honneurs de la guerre». Mais Amherst et Boscawen demeurèrent
intraitables et refusèrent toute discussion à ce sujet:
Monsieur,
Nous venons de recevoir la réponse qu'il a plu à votre excellence de
faire sur les conditions de la capitulation qui vous ont été
offerts.
Nous ne changerons point dans nos sentiments là-dessus, il dépend de
votre excellence de les accepter oui ou non et vous aurez la bonté
de donner réponse là dessus dans demi-heure de temps
Nous avons l'honneur d'être signé Boscawen, Amherst |
Le gouverneur Drucourt
et le conseil estimèrent qu'ils n'avaient plus le choix. Ils décidèrent de
subir l'«attaque finale»:
|
Messieurs,
Pour répondre à
vos excellences en aussi peu de mots qu'il est possible, j'aurai
l'honneur de leur réiterer que mon party est le même et que je
persiste dans la volonté deprouver les suittes de l'attaque générale
que vous m'annoncés.
J'ai l'honneur
d'être signé le chevalier de Drucourt |
Toutefois, l'intervention
du commissaire-ordonnateur de Louisbourg, Jacques
Prévost de La Croix, au cours de la séance du conseil de guerre qui eut lieu à
15 heures le 26 juin, persuada les officiers d'accepter la reddition sans
condition proposée par Amherst. Prévost, qui s'était
sûrement bien préparé, leur fit représenter les risques, voire le carnage
appréhendé,
pour les civils français, alléguant qu'ils avaient suffisamment souffert de la
guerre. Les représentants de la société civile eurent finalement gain de cause
auprès du gouverneur: il lui fallut choisir entre l'honneur
militaire et le pragmatisme des civils. Finalement,
Augustin de Drucourt
décida tout compte fait de se rendre sans condition, comme l'exigeaient les
Britanniques. Puis Français et Britanniques se mirent d'accord sur les six
articles suivants de la capitulation:
|
Articles de la
capitulation
Datée du camp
devant Louisbourg le 26 Juillet 1758 entre son excellence l'amiral
Boscawen et son excellence le major général Amherst, d'une part, et
son excellence monsieur le chevalier de Drucourt, gouverneur de
l'Isle Royale et de Louisbourg, Isle St Jean et de leurs
dépendances:
1º La garnison de Louisbourg sera
prisonnière de guerre et sera transportée en Angleterre dans des
vaisseaux de sa Majesté Britannique;
2º
Toute l'artillerie, les munitions de guerre et de bouche aussi bien
que les armes de toutes espèces qui sont à présent dans la ville de
Louisbourg, Isle Royale, de St Jean et leurs dépendances, seront
livrées sans le moindre dégât aux commissaires qui seront appointés
pour les recevoir à l'usage de Sa Majesté Britannique;
3º
Le gouverneur donnera ses ordres, que les troupes qui sont
dans l'Isle St Jean et ses dépendances, se rendront a bord des
vaisseaux de guerre de l'amiral Boscawen enverra pour les recevoir;
4º
La Porte Dauphine sera livrée aux troupes de Sa Majesté Britannique
demain à huit heures du matin, et la garnison y compris tous ceux
qui ont porté les armes, se rangera à midi sur l'esplanade, posera
les armes, drapeaux, instruments et armements de guerre, et la
garnison sera embarquée pour être transportée en Angleterre dans un
temps convenable;
5º
L'on aura le même soin des malades et blessés qui sont dans les
hôpitaux, que de ceux de Sa Majesté Britannique;
6º
Les négociants et leurs commis qui n'ont pas porté les armes seront
transportés en France de telle façon que l'amiral jugera à propos.
Ont signé: Boscawen, Jeff Amherst
|
Le gouverneur français
signa la capitulation au nom du roi de France. Le siège de Louisbourg était
terminé, mais la rétrocession officielle n'eut lieu que le lendemain à midi
entre le gouverneur Augustin de Drucourt et le brigadier général Edward Whitmore,
le plus âgé des trois officiers supérieurs de Jeffrey Amherst. Puis la garnison
française remit ses armes et ses drapeaux aux Britanniques, sauf les soldats du régiment
de Cambis qui, en guise de protestation, préférèrent les brûler plutôt que de
les remettre aux vainqueurs. Le pavillon anglais fut hissé au
mât de la forteresse à la place du drapeau fleurdelisé français. Au cours de cette même
journée, certains soldats britanniques se livrèrent à des actes de pillage.
Quelques semaines plus
tard, aussitôt la victoire
britannique connue en Angleterre, les cloches de la ville de Londres, comme à
Boston, se mirent à sonner à toute volées au milieu des réjouissances générales
dans tout le pays.
5.2
L'expulsion forcée des habitants
Après la capitulation du
27 juillet 1758, les troupes françaises ainsi que le gouverneur et les officiers
furent considérés comme des prisonniers de guerre.
Mais il restait encore au moins 4000
civils résidant à l'île Royale,
dont le tiers dans la seule ville de Louisbourg. Le général
Amherst voulait faire
disparaître toute trace des Français et des Acadiens sur l'île parce qu'elle était située dans
une zone stratégique du golfe Saint-Laurent; il ordonna donc à
l'amiral Edward Boscawen d'organiser
une
déportation massive, évidemment sur des
navires insalubres pour une question d'économie. Après la déportation des
Acadiens de la Nouvelle-Écosse en 1755, il s'agissait pour les Britanniques
d'une seconde
vague de déportation, qui allait se dérouler, à la suite de la chute de Louisbourg.
Le premier navire à partir le 9 août embarqua l'ex-gouverneur
Drucourt et sa femme pour l'Angleterre. Le 15 août, les Britanniques
embarquèrent 3031 soldats et officiers de terre, ainsi que 2606 marins et
officiers de marine sur des navires de transport de Sa Majesté; ils furent
placés dans des prisons en Angleterre, mais 400 soldats périrent en mer avant
d'arriver. Peu de temps après leur arrivée, les militaires furent rapatriés en France.
Un mois après le siège, le
28 août, Amherst écrivit à William Pitt: «L'amiral Boscawen expédie les
habitants le plus rapidement possible; j'en ignore le nombre; il me semble qu'il
y en avait environ 3000 dans cette île.» Le 13 septembre, Boscawen répondit:
«J'espère pouvoir vider cette ville de ses habitants dans quatorze jours
environ.»
Quelque 3100 Acadiens furent ainsi déportés dès l'été 1758, mais plus
de 1750 allaient périr par noyade ou par maladie au cours du transport, ce qui représente
un fort taux de mortalité de 56 %. Certains navires accusaient un tel état de
décrépitude qu'ils coulèrent en eaux calmes, avec tous leurs passagers, avant
même d'avoir pris la haute mer. L'année suivante, il ne restait plus qu'environ
500 habitants dans l'île du Cap-Breton, mais
l'ancien gouverneur Augustin de Drucourt affirmait qu'il pouvait y
en avoir encore 1500. Selon un recensement qui eut lieu en 1768, il ne restait
plus que 200 Acadiens sur l'île. Un groupe de dix familles acadiennes habitant
Port-Toulouse
réussirent à fuir vers l'île Madame où leurs
descendants vivent encore aujourd'hui. Les anciens habitants (non les soldats)
de Louisbourg qui survécurent à la déportation purent débarquer dans le port de
Rochefort, de La Rochelle et de Saint-Malo. Beaucoup d'anciens habitants
français de l'île Royale (Cap-Breton) et de l'île Saint-Jean (île du
Prince-Édouard) se retrouvèrent à Saint-Malo et dans les paroisses avoisinantes.
La chute de Louisbourg
avait en même temps scellé le sort de l'île Saint-Jean. Trois semaines après la
prise de Louisbourg, une troupe de 500 soldats britanniques, sous le
commandement du lieutenant-colonel Andrew Rollo
(1703-1765), quittèrent la forteresse à destination de
Port-la-Joy pour
prendre possession de l'île Saint-Jean. Le commandant de Port-la-Joy,
le major Gabriel Rousseau de Villejouin, n'avait plus guère le choix. Une lettre
d'Augustin de Drucourt en date du 8
septembre 1758 lui enjoignait de remettre l'île aux mains des Britanniques. De
toute façon, il ne disposait plus d'aucun moyen pour subvenir aux besoins de la
population, laquelle vivait dans la misère. Il fit la constatation suivante: «Je
me voyais cet automne en scituation avec peu de secours de faire subsister
toutte l'Isle.» De Villejouin se rendit avec toute la garnison des Compagnies
franches de la Marine. Les soldats français furent expédiés en Angleterre et
enfermés dans des prisons anglaises; ils retournèrent à Saint-Malo en janvier
1759.
Dès le début du
mois d'août, Andrew Rollo s'empressa de
rassembler tous les Français et Acadiens de l'île. Au lieu
des 400 à 500 personnes prévues, il se rendit compte que leur nombre était
presque dix fois supérieur et qu'il atteignait plus de 4000 personnes,
dispersées
surtout dans les cinq villages de Port-la-Joy,
de Saint-Paul-de-la-Pointe-Prime, de Saint-Louis-du-Nord-Est, de Saint-Pierre-du-Nord et
de Malpèque (voir
la carte). Comme il
n'avait que quatre navires à sa disposition, Andrew Rollo en fit venir d'autres. En
tout, 13 navires furent dépêchés à l'île pour ramener en France les habitants
déportés. Pendant ce temps, beaucoup d'Acadiens réussirent à se cacher dans
l'île.
Lorsque les efforts de rassemblement des Britanniques prirent fin en octobre 1758, les navires
purent repartir avec plus de 3000 Acadiens à leur bord, à l'exception de 200
d'entre eux, isolés sur la côte ouest dans le village de Malpèque,
lequel fut
épargné, car l'hiver approchant le lieutenant-colonel Rollo avait jugé que le village
était trop éloigné. Un gros navire partit le 4 novembre à destination de
Saint-Malo, et onze autres le 25 novembre; les tempêtes dispersèrent les bateaux
et huit seulement atteindront la France, les Acadiens étant abandonnés sur les
côtes de la Manche, notamment à Saint-Malo, à Cherbourg, au Havre et à Boulogne. La moitié des passagers moururent en mer,
décimés par une épidémie de variole ou par suite de noyade. Finalement, environ 1000
Acadiens échappèrent à la déportation: ils se réfugièrent en Gaspésie, à Ristigouche et dans les environs.
Les Micmacs avaient offert une assistance efficace à l'évasion des Acadiens.
Lorsque des bateaux
revinrent à l'île Saint-Jean au printemps de 1759 pour prendre le reste des
habitants, le responsable du territoire, le colonel William Johnson, déclara
qu'ils étaient tous partis «pour le Canada». Les quelques milliers
d'Acadiens qui habitent aujourd'hui l'Île-du-Prince-Édouard sont les descendants
des familles qui y sont revenues après 1764.
À la fin du mois d'octobre
1758, les fonctionnaires français constatèrent que 20 % des passagers en
provenance de Louisbourg avaient péri lors de la traversée. Ils en attribuèrent la
cause à la mauvaise qualité de la nourriture fournie pour le voyage.
Plutôt que d'expédier les aliments prévus dans les entrepôts du roi, les
Britanniques auraient préféré fournir «du biscuit pourri et du bœuf salé remplis
de vers».
Une fois en France, les
habitants de l'île Royale et de l'île Saint-Jean reçurent des subsides de façon
à ce que les déportés ne meurent pas de faim après une pénible traversée. Quant
aux officiers, aux fonctionnaires, aux soldats et aux missionnaires, ils furent
traités différemment des «habitants», car ils purent généralement percevoir leur
salaire comme à l'accoutumée.
5.3
Épilogue
Le 7 octobre 1758, le roi
George II émit une proclamation qui annexait l'île du Cap-Breton à la
Nouvelle-Écosse (Nova Scotia), un statut qui cessera en 1784, alors que l'île
deviendra une colonie distincte. L'île redevint la Cape Breton Island et l'île Saint-Jean, la Island of
Saint John, avant de changer de nom en 1798 pour Prince Edward Island. Tous les toponymes français
de l'ancienne île Saint-Jean et de l'ancienne
île Royale disparurent, sauf quelques-uns. La ville de Louisbourg perdit son
second «o», en devenant officiellement Louisburg, mais est aussi appelée
Lewisburg par les habitants du village anglophone moderne.
Le premier ministre
britannique, William Pitt, récompensera Edward Whitmore,
celui qui avait repris l'île Royale lors de la rétrocession, en le nommant
gouverneur de l'île du Cap-Breton et de l'île Saint-Jean (Saint John). Amherst
et Boscawen furent considérés comme des héros et des conquérants lorsqu'ils
retournèrent dans leur pays. Devenu maréchal, Jeffrey
Amherst décéda en 1797 à l'âge de 80 ans dans sa résidence appelée "Montreal"
à Sevenoaks, dans le sud de l'Angleterre; sa réputation fut cependant remise en
cause à la
fin du XXe
siècle, quand les historiens révélèrent que Amherst s'était servi, comme arme de
guerre, de couvertures contaminées par la variole, qui avaient été distribuées à des
autochtones du Canada et de la Nouvelle-Angleterre, causant la mort de 90 % de
certaines communautés. Quant à l'amiral Edward Boscawen,
il fut accusé par la France d'avoir organisé en 1758 la déportation des Français
et des Acadiens de la colonie de l'Île-Royale et d'avoir violé l'année suivante
la neutralité du Portugal en coulant dans la baie de Lagos sept navires français
avec son escadre de 14 vaisseaux. Il décéda trois ans plus tard de la fièvre à
l'âge de 50 ans, à Hatchlands, dans le comté de Surrey.
James Wolfe mourut à Québec le 13 septembre 1759 au cours de la bataille des Plaines-d'Abraham; il avait 34 ans. William Pitt
perdit son poste de premier ministre en 1760, lorsque décéda le roi George II.
L'ancien gouverneur français de Louisbourg, Augustin de
Drucourt, rentra en France criblé de dettes pour avoir maintenu son train
de vie de gouverneur; il décéda au Havre
en 1762. Jacques Prévost de La Croix, l'ancien
commissaire-ordonnateur de Louisbourg, poursuivit une carrière fructueuse en
France en devenant intendant du prestigieux
port de Toulon et en 1782
conseiller du roi Louis XVI; la Révolution française mit fin à sa carrière et il
décéda en 1791 à l'âge de 76 ans.
 |
La forteresse de Louisbourg
fut complètement rasée en 1761,
pour sombrer ensuite dans l'oubli durant deux siècles. Ainsi, Louisbourg passa
du statut de «Gibraltar de l'Amérique du Nord» à celui de la «Carthage de
l'Amérique du Nord», l'ancienne cité punique détruite en 146 avant notre ère, puis
reconstruite par les Romains. Seul le village moderne
de Louisburg (sans le second «o») survécut jusqu'à ce que, le 6 avril 1966, le
gouvernement provincial de la Nouvelle-Écosse adopte une loi pour rétablir
l'appellation française de la Ville de Louisbourg : "An Act to Change the Name
of the Town of Louisburg".
En 1961, le gouvernement du Canada, pour sa part, entreprenait la
reconstruction d'une partie de la ville historique de Louisbourg, soit le
cinquième de la ville elle-même et le quart des fortifications, afin d'en
faire un haut lieu d'attraction touristique dans l'île du Cap-Breton.
|
La guerre
franco-britannique, qui a entraîné la chute de Louisbourg, est une illustration
éloquente des conséquences néfastes des conflits armés entre des États. Ainsi, la
guerre autorise non seulement les bombardements et les destructions des biens
mobiliers et immobiliers, mais aussi les exécutions en masse des civils, puis
les famines, la torture, l'épuration ethnique, la déportation ou l'immigration
forcée, les violences physiques, psychologiques ou sexuelles. La guerre,
généralement décidée en haut lieu, ne constitue qu'un jeu d'échecs pour les
décideurs, sans égard aux populations concernées. Pourtant, ce sont elles qui
font les frais de la guerre, ne serait-ce qu'en pertes de vies humaines. Si près
de 300 soldats français et britanniques moururent au combat en 1758, plus de 3000
civils (français, canadiens et acadiens) périrent à l'occasion de la déportation. Au
XVIIe siècle, les
déportations massives se pratiquaient à grande échelle et la vie humaine n'avait
apparemment guère d'importance.

La perte de la colonie
française de l'Île-Royale, la seule vraiment rentable au point de vue économique, allait rendre vulnérable le reste
de la Nouvelle-France dès l'année suivante, y compris la Louisiane qui serait
cédée à l'Espagne, le 3 novembre 1762, une année avant le traité de Paris (1763).
La prise de Louisbourg isolait complètement le Canada en lui coupant tout
accès à la mer. Dorénavant, les Britanniques disposaient de toutes les cartes pour se lancer à l'assaut de Québec,
la capitale de la Nouvelle-France. Après la chute de Louisbourg, les Français
avaient perdu la seule autre place fortifiée dont ils disposaient en
Nouvelle-France, avec Québec. Seule Louisbourg pouvait servir d'escale à l'armée
française pour une opération d'envergure permettant de reprendre Québec. À
l'opposé, pour les Britanniques, la chute de Louisbourg libérait les armées
d'Amherst pour les rediriger vers Québec. De fait, à l'été 1759, James Wolfe allait recevoir
l'ordre du général Amherst de mobiliser trois régiments et des navires,
pour aller détruire tous les établissements français situés sur les deux rives du
Saint-Laurent.
La colonie de l'Île-Royale
avait vécu quarante-cinq ans, de 1713 à 1758, avec une éclipse de quatre ans en 1745
et 1749, ce qui est très peu, si l'on tient compte du fait que la vie d'un être humain est
généralement plus longue, et ce constat s'applique même au XVIIIe
siècle. La chute de Louisbourg allait changer le sort de dizaines de milliers de
Français, de Canadiens, d'Acadiens, de Louisianais et d'autochtones, et entraîner la disparition
de la Nouvelle-France au traité de Paris en 1763. Seule la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon rappelle encore aujourd'hui la présence française
dans cette partie septentrionale de l'Amérique.
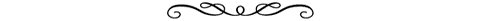
Dernière mise à jour: le
15 octobre, 2023
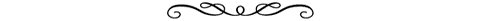
Bibliographie portant sur la
Nouvelle-France
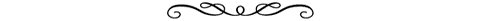
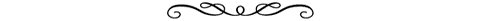
Nouvelle-France
Saint-Pierre-et-Miquelon