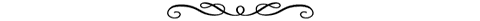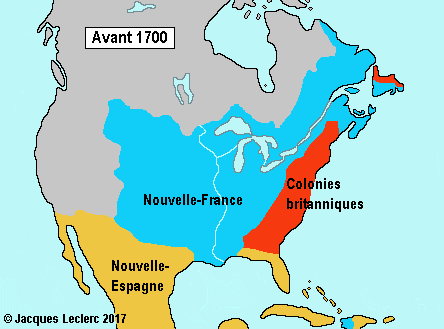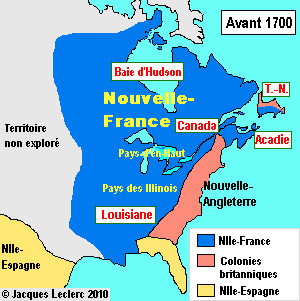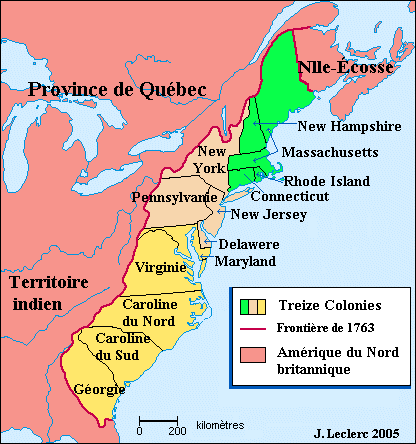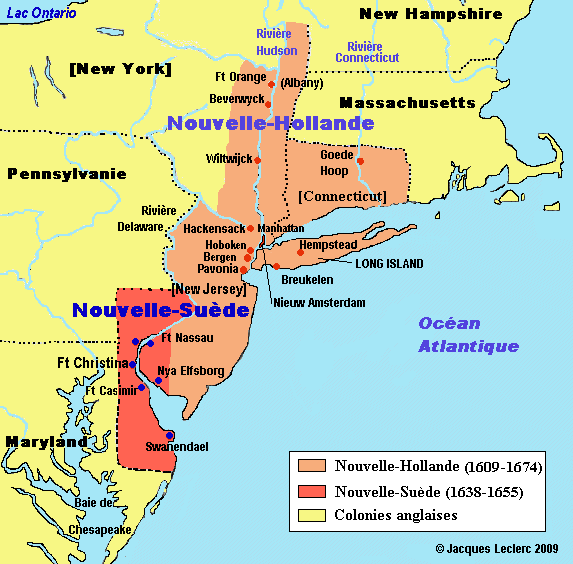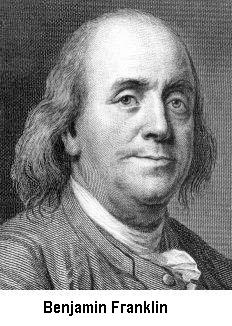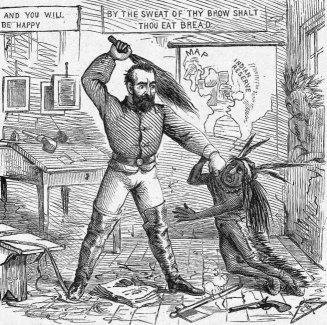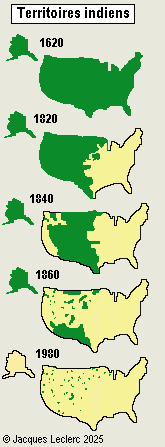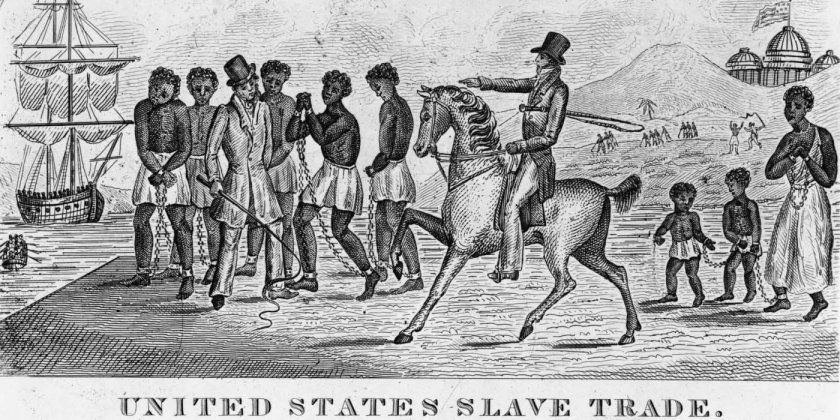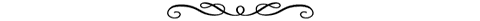
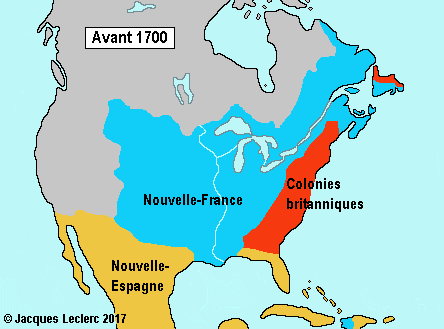 |
Les premiers navigateurs européens qui abordèrent les côtes du continent nord-américain
furent les Italiens Jean Cabot et Sébastien Cabot (1497). Voyageant au service de Henry VII d’Angleterre, ils
découvrirent Terre-Neuve et explorèrent les côtes du Labrador et de la
Nouvelle-Angleterre. L’Espagnol Juan Ponce de León découvrit la Floride en 1513.
L’Italien Jean de Verrazano (1524), voyageant pour le compte de François Ier,
explora les côtes atlantiques de la Caroline du Sud jusqu'au Maine; puis le Français
Jacques Cartier (1534) découvrit l’estuaire du Saint-Laurent. Tous ces
navigateurs étaient à la
recherche d’une route maritime par le nord vers les Indes et la Chine.
La colonisation de l’Amérique du Nord par les Européens commença dès la fin du
XVIe siècle. Au cours des XVIIe
et XVIIIe siècles, elle
était menée essentiellement par trois pays, l’Espagne, la
France et l’Angleterre,
mais également, dans une moindre mesure, par la Hollande et la Suède.
L'Espagne allait coloniser la partie sud de l'Amérique du Nord,
ainsi que l'Amérique centrale, les Antilles et une grande partie de
l'Amérique du Sud. La France allait occuper durant plus de deux
siècles l'Acadie, le Canada et la Louisiane, pendant que les
Britanniques contrôlaient la Nouvelle-Angleterre et la partie
septentrionale
de l'île de Terre-Neuve.
|
Dès la première moitié du XVIe
siècle, les Espagnols pénétrèrent sur le territoire actuel des États-Unis, mais
sans s'implanter de façon durable. Le navigateur Ponce de León explora la
Floride en 1513. En 1526, l'Espagnol Lucas Vallez de Ayllon fonda un
établissement en Caroline du Sud, lequel fut abandonné quelques mois plus tard.
Le second établissement européen permanent sur le sol des États-Unis fut la
colonie de San Agustin (aujourd'hui Saint Augustine), en Floride en 1565. Dès
1580, le roi d'Espagne créa la Floride occidentale (l'Alabama actuel) et la
Floride orientale (la Floride actuelle). Santa Fe fut également fondée au début
du XVIIe siècle (1610)
dans l'actuel État du Nouveau-Mexique. Les Espagnols étendirent ainsi leur
domination sur les territoires qu'on appelle aujourd'hui la Floride, le Texas, la
Californie, puis sur une grande partie de l’ouest des États-Unis.
Après le
traité de Paris de 1763, les Espagnols acquirent en plus toute la
Louisiane française. Ainsi, les
Espagnols ont occupé, durant longtemps, une grande partie du territoire
américain actuel. Ils ont laissé généralement les autochtones parler leurs langues
ancestrales et ne s'opposèrent jamais à ce que, en Louisiane, les Français,
les Canadiens et les Acadiens puissent continuer à parler le français; ils construisirent
même leurs
écoles et employèrent le français dans l'Administration de la Louisiane.
D'ailleurs, l'Espagne a toujours eu l'art d'envoyer des
gouverneurs très compétents (sauf le
premier : Antonio de Ulloa y de la Torre).
On se rend bien compte que toute
la toponymie du sud-ouest des États-Unis est héritière de cette
colonisation espagnole : Alamo: (< Los Alamos), Alcatraz Island (< Alcatraces),
Boca Raton (< «boca de ratónes»), California, Cape Canaveral (< cañaveral),
Colorado, El Paso, Florida, Fresno, La Brea,
Las Cruces, Las Vegas, Los Angeles,
Los Gatos, Miguel, Montana, Nevada, Palomar,
Puerto, San Antonio, San
Carlos, San Diego, San Francisco, Sangre de Cristo Mountains,
Santa Fe, Sierra Navada, etc. Une bonne partie de la population du
sud et de l'ouest des États-Unis provient de ces anciennes colonies espagnoles.
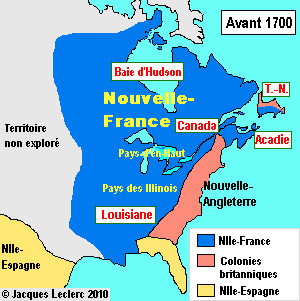 |
Délaissant les régions de la côte atlantique,
les Français pénétrèrent à l’intérieur du continent nord-américain en remontant le
fleuve Saint-Laurent. Depuis Québec, ils étendirent leur autorité sur un immense
territoire, de la baie d'Hudson jusqu'aux «Grandes Plaines centrales», qu’ils appelèrent
Louisiane en
l’honneur de Louis XIV. À cette époque, les
deux rives du Mississippi moyen formaient le «Pays
des Illinois», une région agricole, commerciale (traite des fourrures) et
minière prospère, quoique peu peuplée, située aux deux tiers du chemin entre la
colonie française du Saint-Laurent et celle de la
Louisiane
(voir la carte). Avant le traité d'Utrecht de 1713, la
Nouvelle-France comprenait la plus grande partie de l'Amérique du Nord, soit Terre-Neuve, l'Acadie, le Canada et la Louisiane.
Mais les rivalités coloniales franco-anglaises débouchèrent rapidement sur une succession de guerres. Contrairement à
la colonisation britannique, l’immigration française, trop limitée, ne permettait pas à
la France d’assurer un contrôle réel et une défense efficace de son empire
colonial. Après avoir perdu l’Acadie à l’issue du traité d’Utrecht (1713), la
France abandonna toutes ses possessions américaines lors du traité de Paris
(1763), qui mit fin à la guerre de Sept Ans (1754-1763). La Louisiane
occidentale, à l’ouest du Mississippi, fut cédée, en compensation, à l’Espagne,
alliée de la France (qui la récupéra en 1800); la Louisiane orientale, à l’est
du Mississippi, ainsi que toutes les possessions françaises canadiennes
revinrent à la Grande-Bretagne.
|
2.1 Les alliés amérindiens
 |
Pour maintenir son empire en Amérique du Nord,
la France devait s'appuyer sur des alliances avec les autochtones. De fait, le
nombre des nations amérindiennes alliées des Français était assez étonnant.
Les Français pouvaient compter sur presque tous les Algonquiens du Canada, de
l'Acadie et du sud des Grands Lacs (aujourd'hui en territoire américain),
c'est-à-dire les Abénaquis, les Micmacs, les Montagnais, les Malécites, les
Algonquins, les Hurons, les Outaouais, les Saulteux (Ojibwés), les Cris, les
Ériés, les Pieds-Noirs, les Illinois, les Miamis, les Poutéouatamis, etc.
En Louisiane, les Français avaient obtenu des
alliances avec un grand nombre de nations, dont les Chactas, les Crics, les
Natchez, les Oumas, les Nakotas, les Lakotas, etc. Ayant consolidé leurs
alliances avec les autochtones, les Français contrôlaient non seulement
l'Acadie, la vallée du Saint-Laurent, mais aussi la vallée de l'Ohio, qui
s'étendait du fort Détroit jusqu'en Louisiane et à l'embouchure du Mississipi.
On peut ainsi affirmer que, dans l'ensemble, les Français ont établi des relations plutôt
cordiales (bien que paternalistes) avec les populations autochtones, sauf avec
les Iroquois avec lesquels ils furent souvent en guerre, du moins jusqu'à la
Grande Paix de Montréal de 1701.
|
Les Français ont bien tenté d'assimiler les Amérindiens. Le puissant ministre Colbert tenta de lancer un «programme de
francisation» en 1668, mais il rêvait! Mère Marie de l'Incarnation finira par
dire: «C'est pourtant une chose très difficile pour ne pas dire impossible de
les franciser ou civiliser.» Elle précisera également: «On fait plus facilement un
Sauvage avec un Français qu'un Français avec un Sauvage.» En juillet 1673, le
gouverneur Louis de Buade de Frontenac (1622-1698), qui n'avait pas oublié la préoccupation des autorités
royales à propos de l'assimilation des Amérindiens, s'adressait ainsi aux
représentants des Cinq Nations iroquoises à Cataracoui, dans le style habituel
paternaliste des Français:
| Mes
enfants, je suis consolé de vous voir arriver ici où j'ai fait allumer un
feu pour vous voir pétuner et vous parler. Ô que c'est bien fait, les
enfants, d'avoir suivi les ordres et les commandements de votre père.
Prenez donc courage, mes enfants, vous y entendrez sa parole qui vous est
toute pleine de douceur et de paix. [...]. Je vous conjure avec toutes
sortes d'instances de faire apprendre à vos enfants la langue française
que les Robes-Noires peuvent leur enseigner, cela nous unirait davantage
et nous aurions la satisfaction de nous entendre les uns les autres sans
interprète. |
Même les plus hautes autorités de la colonie, les
gouverneurs en tête, durent s'adapter aux coutumes et valeurs des
autochtones.
2.2 L'apprentissage des langues indiennes
Les Français se rendirent compte
très tôt du caractère inutile de leur entreprise, car les «Sauvages» se sont montrés très réfractaires à
toute francisation. «Ils ne se soucient guère d'apprendre nos langues», lit-on dans
les Relations des jésuites. Ce sont donc les
Français qui durent «se mettre à l'école des sauvages» et apprendre leurs
langues. Les missionnaires français, les coureurs des bois et beaucoup
d'officiers canadiens s'exprimaient couramment en une ou plusieurs langues
amérindiennes. À cette époque, plusieurs jeunes Français n'hésitaient pas à
séjourner, généralement une année, chez les Amérindiens afin de devenir interprètes. La plupart des
gouverneurs de la Nouvelle-France appréciaient d'avoir près d'eux des
officiers bilingues ou polyglottes, car ils se méfiaient des services des
coureurs des bois accusés de trahir les
«harangues» des chefs indiens.
Bref, de Jacques Cartier (1534) jusqu'au traité de Paris de 1763, les relations
franco-indiennes demeurèrent rarement difficiles, ce qui contrastait avec les
relations anglo-indiennes et américano-indiennes. Ce n'est pas pour rien que les
Américains ont toujours appelé la guerre de Sept Ans la
French and Indian War («guerre contre les Français et les
Indiens»). Quant aux Britanniques, ils l'appelèrent
War of the Conquest (guerre de la Conquête),
British Conquest («Conquête
britannique»), War for Empire
(«guerre pour l'Empire») ou moins fréquemment Seven Years’ War
(guerre de Sept Ans). Mais de tous les noms, c'est celui en anglais de
French and Indian War, qui semble le
plus significatif, car il illustre l'imbrication des alliances franco-indiennes
dans cette guerre finale.
La fondation de Jamestown, en Virginie, inaugura en 1607 la colonisation
britannique en Amérique du Nord. Il s'agissait d'une colonisation de peuplement, menée par des émigrants
persécutés dans leur pays pour leurs convictions religieuses ou politiques,
notamment des «séparatistes anglais», une secte dissidente de l’Église anglicane. En 1619, les premiers Noirs arrivèrent en sol américain; débarqués d’un navire
hollandais, ils venaient travailler dans les plantations de Virginie aux côtés
de serviteurs blancs venus d’Europe. En
1620, les Pilgrims Fathers («Pères pèlerins»), des dissidents religieux adeptes du puritanisme, arrivèrent
à bord du Mayflower dans la baie de Plymouth et fondèrent la colonie de Plymouth
(future colonie de la Baie-du-Massachusetts). Du fait que les
Anglais formaient le groupe ethnique majoritaire parmi les premiers colons venus
s'installer sur le territoire, l'anglais fut la langue qui s'imposa
naturellement. Par rapport à la Nouvelle-France et à la Nouvelle-Espagne, la
Nouvelle-Angleterre occupait un espace beaucoup plus restreint sur le littoral
atlantique.
3.1 Les colonies de la Nouvelle-Angleterre
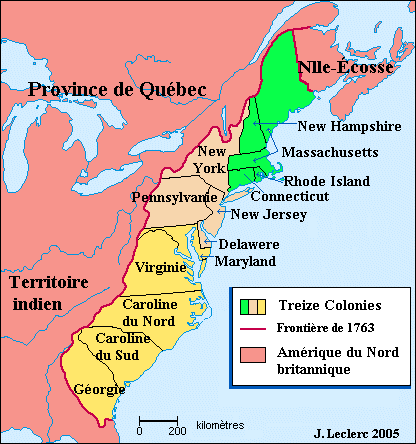 |
L’émigration puritaine continua jusqu’en 1642, entraînant la création des autres
colonies de la Nouvelle-Angleterre (colonies septentrionales) : le New Hampshire
(1629), le Rhode Island (1644) et le Connecticut (1662). Ces colonies développèrent
une société souvent théocratique et intolérante, reposant cependant sur une vie
spirituelle très riche (fondation de l’université Harvard, en 1636).
Situées plus au sud, les colonies méridionales, constituées de la Virginie
(1607), du Maryland (1632), de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud
(1663), ainsi que de la Géorgie (1732), établirent une structure
politico-religieuse et socio-économique très différente de celle des colonies du Nord.
Essentiellement agricoles, elles reposaient sur une économie de plantation (tabac,
coton) qui exigeait une main-d’œuvre abondante. Le commerce triangulaire commença
dès 1620 et se poursuivit durant tout le XVIIe
siècle. Une société esclavagiste se
constitua ainsi, au profit des seuls grands propriétaires, restés fidèles à
l’anglicanisme. Les deux groupes de colonies anglaises restèrent longtemps
étrangers l’un à l’autre.Les autres colonies
proviennent de l'annexion des colonies hollandaises qui, en 1664,
passèrent sous domination britannique. De cette annexion naquirent les
colonies de New
York, du New Jersey et du Delaware (1664). La Pennsylvanie fut fondée un peu
plus tard, en 1681, par le quaker William Penn. Elle devint la
principale porte d'accès au Nouveau Monde pour les immigrants irlandais
d'origine écossaise. |
3.2 La diversité des immigrants
Les Écossais de Pennsylvanie, qui étaient considérés par les autorités
britanniques comme des «étrangers hardis et indigents»,
détestaient les Anglais et se méfiaient de toute forme de gouvernement.
C'est pourquoi ils s'établirent généralement dans l'arrière-pays où ils
défrichaient la terre. D'ailleurs, les immigrants allemands et irlandais
faisaient exactement la même chose.
La majorité des colons venus en Amérique au cours de cette époque étaient
des Anglais, mais il y avait aussi des Hollandais, des Suédois
et des Allemands au centre du pays, quelques Huguenots français en Caroline
du Nord et ailleurs, des esclaves africains, principalement dans le Sud, et
quelques Espagnols, Italiens et Portugais dispersés dans toutes les
colonies.
Après 1680, l'Angleterre cessa de constituer la principale source
d'immigration. Des milliers de réfugiés fuirent l'Europe pour échapper à la
guerre; d'autres quittèrent leur patrie pour s'arracher à la pauvreté à
laquelle les contraignaient des régimes politiques tyranniques et des
propriétaires absentéistes. En 1690, la Nouvelle-Angleterre comptait 250 000 âmes. Par la suite, ce chiffre doubla
approximativement tous les vingt-cinq ans; en 1760, dénombrait plus d'un million six cent
mille habitants, puis en 1775 plus de deux millions et
demi. Dès leur fondation, les Treize Colonies
de la Nouvelle-Angleterre avaient bénéficié d’une grande autonomie
administrative par rapport à la Métropole. Chacune des colonies disposait
d'un gouvernement local et d'une assemble législative. Il s’y institua très
tôt des pratiques démocratiques, mais également une certaine méfiance
vis-à-vis de la Métropole.
Au XVIIe siècle, les colonies
anglaises connurent deux grandes vagues migratoires avec des Allemands (paysans et
artisans), des Irlandais et des Écossais («Scotch-Irish»). Les
Irlando-Écossais étaient davantage écossais qu'irlandais puisqu'ils
constituaient les descendants des presbytériens ayant immigré en Ulster lors de
la colonisation de l’Irlande par l’Angleterre. Tous ces gens se sont intégrés à
la société nord-américaine en parlant une langue anglaise déjà différenciée de celle de la Métropole.
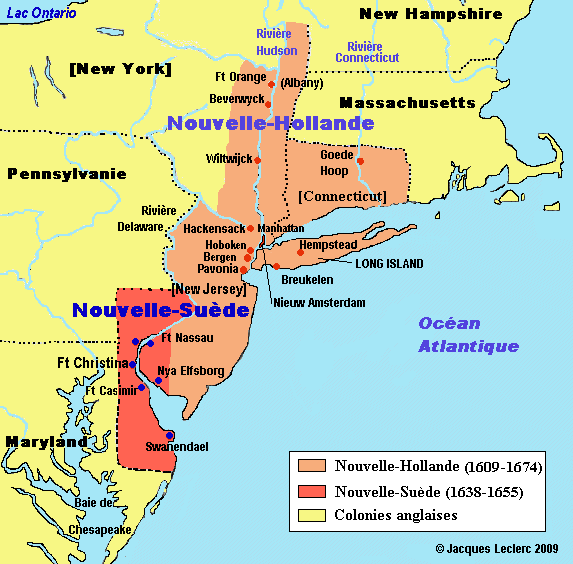 |
Il ne faudrait pas passer sous silence la colonisation
hollandaise en Amérique. C'est en 1609 que
Henry Hudson, au service des Hollandais, remonta le fleuve qui portera désormais
son nom. En
1614, la Compagnie hollandaise des Indes orientales installa des comptoirs dans toute
la région, rebaptisée la Nouvelle-Hollande ou Nouvelle-Belgique (Nieuw Nederland
ou Novium Belgium).
En mai 1624, le Nieu Nederlandt, un navire affrété par la Compagnie
hollandaise des Indes occidentales, arriva en vue de l'île de Manhattan. Le
vaisseau transportait une trentaine de colons, la plupart des Wallons, des
Flamands et quelques Hollandais. L'année suivante, la petite colonie fonda la Nouvelle-Amsterdam
(Nieuw Amsterdam) sur
l'île de Manhattan (du nom de Manhattes donné par les Amérindiens) avec un fort et
une trentaine de maisons. Quelque 200
protestants d'origine française (des huguenots) s'y installèrent pour le commerce des peaux de
castors, de loutres et de visons. Le premier gouverneur de la Nouvelle-Hollande
(aussi appelée Nouvelle-Belgique), Peter Minuit
(un Wallon), acheta
l'île de Manhattan
aux autochtones pour l'équivalent de 60 florins (ou 20 $ - 25 $).
Avec le temps, les Hollandais voulurent prendre les terres des
Amérindiens. Ceux-ci ripostèrent par des représailles et un quasi-état de guerre
permanent s'installa jusqu’au milieu des années 1640.
En 1647, Peter Stuyvesant fut nommé directeur général de la Nouvelle-Hollande. Il résolut
de «régler»
la question indienne en capturant les autochtones pour les vendre comme esclaves dans les
Antilles. Mais l'autoritarisme de Peter
Stuyvesant et son intolérance religieuse pour les communautés
n’appartenant pas à l’Église hollandaise réformée le rendirent fort impopulaire.
|
|
4.1 Annexion de la Nouvelle-Suède
En 1655, les Hollandais annexèrent la petite colonie suédoise du Delaware
(fondée en 1638), appelée la
Nouvelle-Suède
(Nya Sverige).
Cette colonie devait son nom au premier gouverneur suédois, Thomas West,
baron de La Warr (d'où Delaware). À cette époque, le territoire de
la Nouvelle-Hollande comprenait une partie de l'actuel État de New York, le
Connecticut, le Delaware et le New Jersey. En 1647, la population de la
Nouvelle-Hollande comptait entre 1500 et 2000 habitants, mais en 1664 la population
de la colonie hollandaise avait déjà atteint 10 000 habitants, alors que la
ville de la Nouvelle-Amsterdam en comptait 1600. Quant à l'île de Manhattan
(appelée Lange Eylandt devenue Long Island), elle abritait une
douzaine de villages dans lesquels vivaient des familles hollandaises,
flamandes, wallonnes et anglaises (la moitié de la population). Bien que la
langue officielle fût le néerlandais, une bonne partie de la population parlait
l'anglais, le français, l'allemand, le suédois, etc. Bref, la Nouvelle-Hollande
était multilingue et multiculturelle.
4.2 La reddition de la colonie hollandaise
 |
La petite colonie
hollandaise suscita la convoitise des Britanniques qui s'emparèrent de la
Nouvelle-Amsterdam en 1664. En réalité, sous la pression des
colons et des Anglais, le gouverneur Pieter Stuyvesant avait fini par signer le
document livrant la colonie aux Anglais, sans avoir vraiment combattu. Les termes de la reddition furent assez
généreux, car les colons hollandais conservèrent leurs droits de propriété et leur
liberté de religion. Le roi d'Angleterre, Charles II, donna
alors la nouvelle colonie à son frère James, duc d'York, héritier du trône d'Angleterre,
qui deviendra roi sous le nom de Jacques II; la Nouvelle-Amsterdam devint New
York. Le territoire du New Jersey fut concédé à
sir George Carteret et John Berkeley; le nom tire son origine de l'île de
Jersey, située dans la Manche, où était né sir George Carteret.
Dès lors, les Hollandais et les Anglais furent bientôt rejoints par des huguenots français après la
révocation de l'édit de
Nantes en 1685, puis des protestants allemands, de quelques juifs venus du Brésil
et d'un certain nombre de Noirs.
La paix de Breda (1667) marqua la fin de la guerre
anglo-hollandaise. En contrepartie de la cession de la
Nouvelle-Amsterdam (aujourd'hui New York) aux Britanniques, le
traité permit aux Hollandais d'acquérir le Surinam en Amérique du
Sud. |
En
1673, les Hollandais reprirent New York qu'il rebaptisèrent la
Nouvelle-Orange (Nieuw
Oranje).
L'année suivante, le traité de Westminster restituait définitivement New York aux
Britanniques. L'anglais
remplaça définitivement le néerlandais comme langue officielle. Néanmoins, les Hollandais continuèrent à exercer une influence considérable sur la vie
économique et sociale de la région, et ce, longtemps après la conquête de la Nouvelle-Hollande.
C'est dans cette région de New York que le caractère multilingue de
l'Amérique apparut davantage. Alors qu'elle constituait une colonie
hollandaise, on y trouvait, outre des Hollandais, également des Français, des Danois, des
Norvégiens, des Suédois, des Anglais, des Écossais, des Irlandais, des
Allemands, des Polonais, des Tchèques, des Portugais et des Italiens
établis le long de l'Hudson. Malgré leur défaite en Amérique du Nord, les Hollandais continuèrent à
exercer une grande influence considérable sur la vie économique et sociale de la
région, sauf au point de vue linguistique où l'anglais prit toute la place.
Ainsi, la diversité du peuplement de ces colonies laisse déjà présager que
l'immigration restera une constante des l'histoire des États-Unis.
L'idéal linguistique du colon en Amérique du Nord était de parler le «bon
anglais» et de lire les auteurs britanniques. Lorsqu'il évoquait
l'Angleterre, il disait simplement «at home» («chez nous»). S'intégrer à la
société coloniale, c'était accepter le modèle culturel britannique et
oublier la langue de ses parents, si celle-ci n'était pas l'anglais. C'est
pourquoi les immigrants français, allemands, irlandais, écossais,
hollandais, etc., perdirent rapidement leur langue d'origine.
5.1 L'adaptation linguistique
Ainsi,
le colon se construisait une identité qui ne pouvait être que l'anglaise. S'il lui
arrivait d'ajouter des mots indiens dans son vocabulaire (toboggan,
mocassin, squaw, etc.), des mots français (prairie,
bureau, etc.) ou des mots néerlandais (boss, yankee,
etc.), s'il se vantait de moderniser l'anglais, il admettait en même temps
qu'il valait mieux ne pas employer des américanismes (le mot
americanism apparaîtra en 1781) perçus encore comme une «
exaggeration».
De cette façon, le colon ne serait pas un «sauvage» et saurait repousser
l'influence de l'Espagne et de la France. Au milieu du XVIIIe
siècle, près de 90 % de la population blanche masculine était
alphabétisée en anglais, mais seulement 40 % des femmes pouvaient lire et écrire
cette langue. Les
Noirs et les Amérindiens étaient tous analphabètes; dans la vie quotidienne,
les premiers parlaient anglais, les seconds, leur langue ancestrale.
Les premiers américanismes
apparurent vers 1735 et certains spécialistes britanniques publiaient des
listes de «mots interdits» (forbidden words).
En général, les Britanniques trouvaient que l'«American English» faisait
provincial. Certains n'hésitaient pas à parler de misused words
(«mots employés improprement»), de spurious words («faux mots»:
impropriétés de terme) et de
words that are not words («mots qui ne sont pas des mots»:
impropriétés).
Après la guerre de Sécession, très peu d'Américains vont poursuivre ce genre
de pratique. Mentionnons tout de même un journaliste du nom d'Alfred Ayres (un pseudonyme), rédacteur au Verbalist, qui fut l'un de ceux qui
publièrent des listes de mots par ordre alphabétique,
créant ainsi une sorte de dictionnaire d'usage de l'«anglais incorrect».
Puis apparurent de nouveaux «commentateurs» linguistiques américains,
tels que Fitzedward Hall qui, dans son Recent Exemplifications of False
Philology de 1872, modifia l'approche lexicologique en apportant des
explications philologiques sur les termes locaux. Paradoxalement, la
collection des exemples de Hall servira de base à l’édification du Oxford
English Dictionary, commencé en 1884 et achevé en
1928. On sait que ce célèbre dictionnaire anglais compilera tous les
mots, incluant les mots de l'«anglais non
britannique», qu'ils soient «politiquement corrects» ou «incorrects».
5.2 Les variétés d'anglais
Cependant, l'anglais parlé à l'époque variait selon les classes sociales
et l'éducation. L'anglais parlé par l'élite coloniale et les gens fortunés
ou instruits était semblable à celui des mêmes classes à Londres. Les
classes rurales parlaient un anglais un peu différent, plus archaïsant, et
déjà soumis aux influences des autres langues. Les classes ouvrières
des villes parlaient l'anglais des classes populaires urbaines de
l'Angleterre. Dans les colonies du Sud, les propriétaires des plantations
parlaient le même anglais londonien, avec le même accent aristocratique.
Quant aux esclaves, ils parlaient un anglais assez similaire à celui des
populations blanches, populaires et rurales.
En général, les colons savaient lire l'anglais, mais ils se
contentaient de lire et relire la Bible ou de parcourir les almanachs, les
périodiques et les journaux. Seule une minorité achetait des livres et seuls
les riches possédaient une bibliothèque. Les philosophes, les historiens,
les grammairiens, les savants, etc., n'étaient pas américains, mais
massivement britanniques ou français. Le savant le plus célèbre de l'époque était
Benjamin Franklin, un riche imprimeur qui n'était pas un universitaire et
n'avait pas reçu de formation théorique. Il connaissait le français et était
passionné de la «science populaire». La plupart des colons se considéraient
encore comme des Anglais, davantage des «Anglais d'Amérique», mais pas encore des
«Américains». Cela viendra lorsque la société coloniale ne ressemblera plus à
la société anglaise!
5.3 L'école et les langues d'enseignement
À cette époque, de nombreuses écoles communautaires ou privées virent le
jour. En général, les écoles privées étaient sans appartenance religieuse et
s'adressaient surtout aux plus aisés; les écoles communautaires, souvent
destinées aux plus démunis, restaient tributaires d'une confession
religieuse ou d'un groupe linguistique. Par exemple, les Irlandais, qui
détestaient généralement les Britanniques, préféraient se regrouper dans
l'arrière-pays avec d'autres catholiques ou avec des Écossais et des
Allemands.
La plupart des écoles primaires enseignaient l'écriture, la
lecture et le calcul dans l'une ou l'autre des langues parlées par les
communautés locales. Les langues les plus enseignées, selon les communautés, étaient
l'anglais, le néerlandais, l'allemand et le français. Dans certaines écoles,
on donnait une formation plus poussée en grec et
en latin, puis en histoire et en littérature.
En Pennsylvanie, les immigrants allemands étaient tellement nombreux que
l'allemand constituait la langue d'enseignement la plus courante dans le
écoles privées et communautaires. Les autorités incitèrent les immigrants
germanophones à fréquenter les écoles publiques afin qu'ils s'intègrent plus
rapidement. Là où ils étaient concentrés, les germanophones réussirent à
fonder des écoles publiques de langue allemande. Cette question
d'intégration inquiétera longtemps les autorités .
5.4 Déjà l'assimilation linguistique
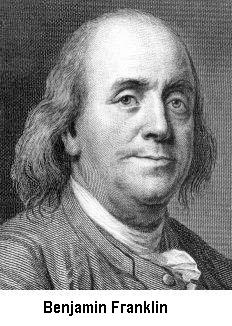 |
En 1753, Benjamin Franklin
(qui parlait
l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et l'italien, et un peu de
gallois et de latin), soulignait encore la propension des
germanophones à continuer à parler et à écrire l'allemand, ce qui les
rendait imperméables à l'anglicisation. Afin de mieux intégrer cette
population immigrante, il suggéra de disperser ses membres sur l'ensemble du
territoire et de tout faire pour les «anglifier» (ou «angliciser»). Benjamin Franklin écrivit
aussi ce passage bien connu (1753):
|
Pourquoi devrions-nous laisser les rustres palatins déferler sur nos
colonies et, en s'y concentrant, y établir leurs langues et leurs
coutumes au détriment des nôtres?
Pourquoi la Pennsylvanie, fondée par les Anglais,
devrait-elle se changer en colonie d'étrangers, lesquels seront bientôt
assez nombreux
pour nous germaniser au lieu d'être par nous anglifiés, sans jamais
être plus en mesure d'adopter notre langue et nos coutumes qu'ils ne
sauraient acquérir la couleur de notre peau? |
Bref, l'un des fondateurs des futurs États-Unis était déjà convaincu en
1753 que les colonies, alors britanniques, devaient rester anglaises et
angliciser les nouveaux venus. Il savait aussi qu'une trop forte
concentration d'immigrants de même origine et sur un même territoire nuisait
nécessairement à leur «anglifying» («anglicisation»).
|
Néanmoins, dans la version française de son autobiographie (Vie de
Benjamin Franklin, écrite par lui-même, suivie de ses
Œuvres morales, politiques et
littéraires), publiée à Paris en 1791, Benjamin Franklin
constatait avec
résignation la prééminence du français comme langue internationale:
| La
langue latine, qui a longtemps servi à répandre les connoissances
[sic] parmi les différentes nations de l'Europe, est chaque jour plus
négligée; et une des langue modernes, la langue française, est devenue
presque universelle. On la parle dans toutes les cours de l'Europe; et
la plupart des gens de lettres, de tous les pays, ceux mêmes qui ne
savent pas la parler, l'entendent assez bien pour pouvoir lire
aisément des livres français. Cela donne un avantage considérable à la
nation française. Ses écrivains peuvent répandre leurs sentiments,
leurs opinions, sur les points importans
[sic]
qui ont rapport aux intérêts de la
France, ou qui peuvent servir à sa gloire, et contribuer au bine
général de l'humanité. |
Il n'en demeure pas moins que Franklin conservait l'espoir que la langue
anglaise allait bientôt gagner la «seconde place»:
|
L'immense collection d'excellens
[sic]
sermons imprimés dans cette langue et
la liberté de nos écrits politiques sont cause qu'un grand nombre
d'ecclésiastiques de différentes sectes et de différentes nations,
ainsi que beaucoup de personnes qui s'occupent des affaires publiques,
étudient l'anglais et l'apprennent au moins assez bien pour le lire;
et si nous nous efforcions de faciliter leur progrès, notre langue
pourroit
[sic]
devenir d'un usage beaucoup plus général. |
Benjamin Franklin avait bien raison de croire à l'expansion de l'anglais,
mais il s'est lourdement trompé sur les causes de son expansion. Ce ne sont
pas les «sermons» ni les «écrits politiques» qui ont placé l'anglais au
premier rang des langues du monde, mais le poids économique de la Grande-Bretagne, puis des États-Unis.
Dans ces colonies britanniques, les filles n'étaient pas
ignorées, mais elles recevaient généralement une formation limitée aux activités
quotidiennes de leur vie. Toutefois, les familles aisées ou riches
embauchaient des précepteurs qui apprenaient aux jeunes filles le français
(la langue seconde normale de l'époque), la musique, la danse, la peinture, le chant, etc. En 1647, la colonie de la Baie-du-Massachusetts adopta une loi qui obligeait toute ville peuplée de plus de cinquante familles
à se doter
d'un établissement d'enseignement préparant les élèves aux études
supérieures. Par la suite, toutes les colonies de la
Nouvelle-Angleterre, à l'exception du Rhode Island, firent de même. Mais les colons les plus
riches envoyaient leurs enfants poursuivre leurs
études en Grande-Bretagne.
Si les premiers contacts avec les autochtones furent relativement
pacifiques, il n'en fut pas ainsi par la suite. À de rares exceptions près,
les relations se détériorèrent rapidement. Contrairement aux Français, les
premiers immigrants britanniques étaient «avides de terres» et les
autochtones furent perçus comme des concurrents, les colons anglais
convoitant
constamment les «territoires indiens». Par ailleurs, la plupart des
Amérindiens étaient alliés aux Français, ce qui en faisait doublement des
ennemis.
6.1 Les «créatures infernales»
Si l'on fait exception d'une partie des Iroquois alliés, les colons
anglais entrèrent très vite en conflit avec les Powhatans des Appalaches,
puis avec les Nagaransetts, les Pecots et les Wampanaogs, qui disparurent
tous de la Nouvelle-Angleterre. Lorsque les colons massacraient les
Amérindiens et gagnaient les guerres, on disait que la «civilisation» avait
progressé «pour la plus grande gloire de Dieu»; quand c'était les Amérindiens
qui tuaient des colons,
on parlait de «massacres» ou de «tueries» de la part des «sauvages». En
général, on décrivait les autochtones comme des «créatures infernales»
assoiffées de sang.
Dès
1609, soit quelques années avant le débarquement du Mayflower à
Plymouth en 1620, le révérend Wiiliam Symonds, dans son «Sermon sur la Virginie»
("Sermon Preached at White-Chapel", 1609),
décrivait ainsi les Indiens: «Ce sont des créatures infernales, ignorant les
règles de la pudeur, et ne connaissant d'autre Dieu que le Diable.» Les
colons anglais furent vite convaincus qu'il leur fallait assumer une
«mission sacrée»: celle de conquérir les territoires du «Malin».
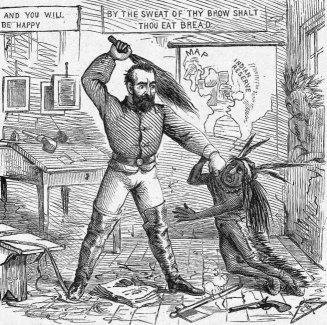 |
Pour sa
part, l'un des Pères Pèlerins (en anglais: Pilgrim Fathers, ces
calvinistes anglais, puritains et séparés de l'Église anglicane, qui
fondèrent en 1620 la colonie de Plymouth en Nouvelle-Angleterre) a même
laissé ce témoignage éloquent : «Dieu a voulu qu'une peste emporte la
plupart des sauvages pour nous faire place.» Les colons estimèrent bien
rapidement que le territoire sur lequel il s'étaient installés leur avait
été assigné par la Providence elle-même et qu'il n'y avait guère de place
pour ces Sauvages. Le qualificatif qui revient souvent, c'est "poor
creatures".
L'afflux régulier de colons dans les régions forestières des colonies de
l'Est eut un effet néfaste sur la vie des autochtones. Ces derniers étaient
résistants, pleins de ressources, méfiants et, contrairement aux Anglais,
parfaitement à l'aise dans leur environnement. Les autochtones comprendront
vite que les serments les plus solennels seraient violés aussitôt que les
intérêts des Blancs entreraient en conflit avec leurs promesses, que les Européens
seraient impitoyables et sans scrupule à la guerre, que les armes indiennes
ne seraient d'aucune utilité face aux armes européennes.
Lors de la guerre de l'Indépendance, les Amérindiens allaient être
provisoirement «récupérés» par les Britanniques. En effet, beaucoup d'autochtones,
ainsi que des milliers de
Noirs, se rangèrent avec les loyalistes aux côtés des soldats britanniques.
|
6.2 L'entreprise d'éviction et de génocide
Avec la disparition
progressive du gibier, les tribus amérindiennes furent confrontées à un choix difficile :
ou bien elles mourraient de faim, ou bien elles partaient en guerre, ou
bien elles quittaient leurs territoires
ancestraux pour aller
vers l'ouest où elles entreraient en conflit avec d'autres tribus. Incapables
de réduire les autochtones en esclavage ou de vivre en bonne entente avec
eux, les Britanniques décidèrent rapidement de les exterminer;
Une fois les Britanniques
évacués, par vengeance et par cupidité, les Américains allaient poursuivre leur
œuvre d'éviction des autochtones jusqu'à leur
quasi-génocide. En
1835, Alexis de Tocqueville (1805-1859) décrivait ainsi dans De la
démocratie en Amérique la situation des Indiens aux États-Unis:
| Les
Espagnols, à l'aide de monstruosités sans exemple, en se couvrant
d'une honte ineffaçable, n'ont pu parvenir à exterminer la race
indienne. Les Américains des États-Unis ont atteint ce résultat avec
une merveilleuse facilité, tranquillement, légalement,
philanthropiquement, sans violer un seul des grands principes de la
morale aux yeux du monde. On ne saurait détruire les hommes en
respectant mieux les lois de l'humanité. |
Les survivants des différents peuples amérindiens furent intégrés au système
des «réserves» géré par le Bureau des affaires indiennes (Bureau of
Indian Affairs) qui, en en 1824, fut mis sous la responsabilité du
ministère de la Guerre (le War Departement). Les déportations systématiques
des Indiens commencèrent dès 1806. C'est sous la présidence d'Andrew Jackson (1829-1837)
que le Congrès des États-Unis autorisa
officiellement ces déportations par l'adoption, le 28 mai 1830, de l'Indian
Removal Act («Loi sur le déplacement indien»); notons l'usage du
mot removal («déplacement») au lieu de deportation
(«déportation»).
 |
Les Indiens
durent donc évacuer tous les territoires à l'est du Mississippi et se
regrouper dans des réserves à l'ouest. La loi prévoyait le déplacement des
tribus indiennes et la redistribution de leurs terres à ceux qui s'en
porteraient acquéreurs.
En 1831, un
juge fédéral, John Marshall, dans son arrêt de l'affaire Nation cherokee c. la Géorgie,
déclara:
|
Il serait peut-être préférable de désigner les
tribus indiennes par le vocable de «nations indigènes dépendantes», car elles possèdent
des terres que nous (les États-Unis) revendiquons sans tenir compte de
leur volonté, et nous ne pourrons entrer en possession de ces terres
que lorsqu'elles n'en seront plus propriétaires. Les Indiens sont
aujourd'hui sous tutelle. Leurs relations avec les États-Unis
ressemblent à celles qui existent entre un pupille et son tuteur. |
Seulement cinq ans après ces déclarations pour le moins officielles, le
président Andrew Jackson (1829-1837)
pouvait constater avec satisfaction que les Indiens avaient disparu de l'est des
États-Unis, à part quelques rares exceptions. Jackson avait donc eu une "Big
Idea" («grande idée»).
|
À partir des années 1860, le major-général Philip Henry Sheridan
(1831-1888) entreprit ses «guerres indiennes» de façon si brutale que
plusieurs historiens l'ont accusé de racisme et surtout de génocide, en
raison de sa politique de traquer les femmes et les enfants autochtones, et
de détruire systématiquement les abris, les réserves de nourriture et les
troupeaux de chevaux.
 |
Sheridan prit l'habitude de mener ses actions
dévastatrices au cœur de l’hiver, au moment où les Indiens étaient le plus
vulnérable, et d’entreprendre la construction de forts qui quadrillaient
tout le pays. En janvier 1869, Sheridan, qui était à Fort Cobb dans le
Territoire indien, reçut une délégation de plusieurs chefs cheyennes et
comanches venus faire leur reddition. L’un d’eux, le chef comanche Tosawi
(en français : «Broche d'argent» ou «Couteau blanc») lui dit en anglais dans
le but de manifester sa bonne volonté: «Tosawi, good Indian.» Sheridan lui
aurait répondu: «Il n’y a pas de bons Indiens. Les seuls bons Indiens que
j’aie jamais vus étaient morts.» Avec le temps, cette réplique se transforma
en une formule plus courte : «Un bon Indien est un Indien mort». Les
historiens semblent divisés sur la paternité de cette phrase : «Un bon
Indien est un Indien mort» (en anglais: "The only good Indian is a dead
Indian"). Sheridan encouragea systématiquement les chasseurs blancs à
poursuivre la destruction systématique des bisons, la principale ressource
de ravitaillement des Indiens des Plaines. |
Le général Sheridan est aujourd'hui considéré comme un héros par la plupart
des Américains, sauf dans le Sud où il est détesté; il est enterré au cimetière
national d'Arlington avec un monument funéraire digne de ses victoires!
6.3 L'appropriation des terres indiennes
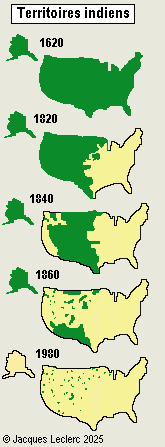 |
En 1862, la Homestead
Act («Loi sur le fermage») permettait de concéder gratuitement un carré de un demi-mile,
soit 160 acres (64,7 ha) de terres agricoles, à toute famille
non indienne qui s'engageait à s'établir et à mettre en valeur le terrain
qu'elle avait en fermage, pour une période d'au moins cinq ans.
En 1871, l'Indian Appropriations Act («Loi
sur les appropriations indiennes»)
était adoptée par le Congrès des États-Unis
afin de supprimer l'ancienne politique des traités avec les Indiens. Dès
lors, la loi ne reconnaissait plus les nations indiennes, mais seulement les individus.
En abolissant unilatéralement le
statut de souveraineté des tribus indiennes, les Américains purent ainsi
interpréter les réglementations qui suivirent en fonction de leurs intérêts
et considérèrent que les traités étaient abolis. Or, la loi de 1871
confirmait clairement la validité de tous les traités conclus avec les
Indiens avant le 3 mars 1871. La Dawes Severalty Act («Loi sur
l'allotissement général») de 1887 accorda à chaque Amérindien un
certain nombre
d'acres de terre et mit le restant des réserves à la disposition des colons
américains. Ce lotissement sera amplifié par la Burke Act de 1906,
qui sera destinée à supprimer la propriété collective des terres et à
transformer les Indiens en fermiers. Bref, l'histoire américaine témoigne
que le droit peut être mis au service du colonialisme.
Entre l'arrivée des «Pères pèlerins» en 1620 à bord du Mayflower dans
la baie de Plymouth et 1860, les Indiens des États-Unis avaient perdu la
quasi-totalité de leurs terres ancestrales. Ils perdront le reste au cours
du siècle qui suivra. Ne subsisteront que quelques minuscules réserves
indiennes.
En 1881,
l'écrivaine Helen Hunt Jackson (1830-1885), perçue à l'époque comme une activiste pour
les droits des Native Americans, publiait un violent réquisitoire
contre cette politique dans un volume au titre évocateur: A Century of
Dishonor : A Sketch of the United States Government's Dealings With Some
of the Indian Tribes («Un siècle de déshonneur : une ébauche des ententes du
gouvernement des États-Unis avec certaines tribus indiennes»).
|
En se basant sur les statistiques disponibles des Indian Office Reports,
Mme Jackson révèle qu'il existait sur le territoire des États-Unis entre 250
000 et 300 000 Indiens en excluant ceux de l'Alaska, le tout réparti en près
de 300 tribus. On comptait à cette époque environ 32 500 Indiens dans les
États du
Minnesota et du Mississippi, 70 650 au
Nebraska, au Kansas et dans le Territoire indien, 65 000 au Dakota, au Montana,
dans le Wyoming et l'Idaho, 84 000 au Nevada, au Colorado, au Nouveau-Mexique,
dans l'Utah et l'Arizona,
48 000 sur la côte du Pacifique. Parmi ces quelque 300 000 Indiens,
130 000 étaient financièrement indépendants dans leurs propres réserves. On
comptait aussi 84 000 Indiens partiellement soutenus par le gouvernement
américain, 31 000 entièrement entretenus par le gouvernement et quelque 55
000 dont on ignorait les moyens de subsistance. Helen Hunt Jackson
condamnait
ouvertement ses contemporains pour les injustices dont les Indiens
étaient victimes:
The history of the Government connections with the Indians is a
shameful record of broken treaties and unfulfilled promises. The
history of the border white man's connection with the Indians is a
sickening record of murder, outrage, robbery, and wrongs committed by
the former, as the rule, and occasional savage outbreaks and
unspeakably barbarous deeds of retaliation by the latter, as the
exception.
Taught by the Government that they had rights entitled to respect,
when those rights have been assailed by the rapacity of the white man,
the arm which should have been raised to protect them has ever been
ready to sustain the aggressor.
The testimony of some of the highest military officers of the United
States is on record to the effect that, in our Indian wars, almost
without exception, the first aggressions have been made by the white
man. . . . Every crime committed by a white man against an Indian is
concealed and palliated. Every offense committed by an Indian against
a white man is borne on the wings of the post or the telegraph to the
remotest corner of the land, clothed with all the horrors which the
reality or imagination can throw around it. Against such influences as
these are the people of the United States need to be warned.
_________
Helen Hunt Jackson. A Century of Dishonor, 1881 |
L'histoire des rapports
entre le
gouvernement et les Indiens
est un relevé honteux de traités violés et de
promesses non tenues. L'histoire des rapports entre les Blancs et les Indiens est un relevé dégoûtant de
meurtres, d'atrocités, de vols et de crimes commis habituellement par les colons
et de violents accès de révoltes et d'exactions barbares de
représailles inouïes commis exceptionnellement par les Indiens.
Informés par le gouvernement que leurs droits devient être respectés,
les Indiens ont vu ces droits
bafoués par la rapacité des Blancs;
le bras qui devait servir à les protéger a toujours été prêt à
favoriser l'agresseur.
Le témoignage de certains des officiers militaires les plus hauts
gradés des
États-Unis révèle que, dans nos
guerres indiennes, presque sans exception, les premières agressions
ont été commises par les Blancs.... Chaque crime commis par un
Blanc contre un Indien est caché et minimisé. Chaque affront commis par un Indien contre un Blanc
est transmis par voie postale ou télégraphique dans les coins les plus reculés de la terre, maquillé
de
toutes les horreurs dont la réalité ou l'imagination peut l'entourer.
Les citoyens des États-Unis doivent être mis au courant de ce genre de
manipulations.
_________
Helen Hunt Jackson. Un siècle de déshonneur, 1881 |
Dans
son livre American Slavery American Freedom, («Esclave américain et
liberté américaine», 1975), l'auteur américain Edmund S. Morgan fait
également allusion aux
autochtones et parle de la «supériorité» des Blancs au XIXe
siècle:
|
En tant que colon, vous saviez que votre technologie
était supérieure à celle des Indiens. Vous saviez que vous étiez
civilisés quand, eux, n'étaient que des sauvages. [...] Mais votre
supériorité dans le domaine technologique se révélait inapte à
produire quoi que ce soit. Les Indiens, de leur côté, se moquaient de
vos méthodes prétendues supérieures et tiraient de leur environnement
de quoi vivre dans l'abondance tout en travaillant moins que vous.
[...] Enfin, lorsque vos propres concitoyens commencèrent à fuir pour
aller vivre avec eux, c'en fut trop. [...] Alors, il vous fallut tuer
les Indiens, les torturer, incendier leurs villages, saccager leurs
champs de maïs, afin de prouver votre supériorité, quels que fussent
vos échecs dans d'autres domaines. En outre, il vous fallut infliger
le même traitement à ceux de vos concitoyens
qui s'abandonnaient au mode de
vie des sauvages, mais le maïs ne poussait pas mieux pour autant.
|
Au cours de leur histoire, la plupart des Américains furent acquis aux bienfaits
de l'assimilation et souhaitaient en toute bonne foi que les Indiens
abandonnent leurs coutumes, qu'ils se convertissent au christianisme, se
sédentarisent et, surtout, reçoivent leur éducation en anglais. Mais les
Amérindiens demeurèrent toujours réfractaires à l'assimilation et au travail
forcé. C'est pourquoi les Américains opteront rapidement pour l 'esclavage des Noirs.
Les Européens importeront en Amérique plus de 11 millions d'esclaves. Les
historiens estiment que 523 000 Noirs sont arrivés dans les colonies
britanniques, puis aux États-Unis, ce qui correspondrait à 4,6 % du
total de la population. Autrement dit, comparativement aux autres colonies européennes, le
territoire de ce qui deviendra les États-Unis reçut relativement peu
d'esclaves.
Importation d'esclaves africains
en Amérique et en Europe
(de 1451 à 1870)
|
Brésil (Portugal) |
4
190 000 |
36,93
% |
|
Antilles anglaises |
2
443 000 |
21,53
% |
|
Amérique espagnole |
1
687 000 |
14,87
% |
|
Amérique française |
1
655 000 |
14,59
% |
|
Colonies
britanniques (Nlle-Angleterre) |
523 000 |
4,61 % |
|
Antilles néerlandaises |
500 000 |
4,41 % |
|
Europe |
297 000 |
2,62 % |
|
Antilles danoises |
50 000 |
0,44 % |
|
Total |
11 345
000 |
100,00
% |
|
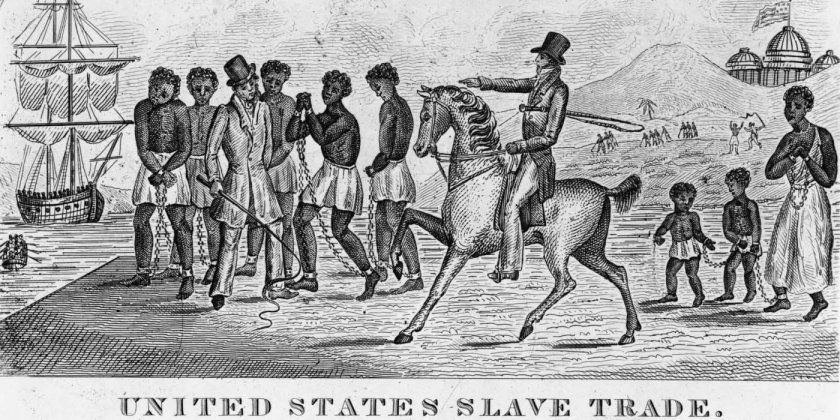 |
La première cargaison de 20 esclaves fut débarquée à Jamestown en 1619 d'un
navire hollandais. Dans les trois premières décennies du XVIIIe
siècle, l'importation annuelle s'élevait à environ un millier de Noirs. Par la
suite, un certaine accélération se produisit: 40 400 de 1731 à 1740, 58 500 de
1741 à 1750, 41 900 de 1751 à 1760, 85 800 de 1761 à 1780, 91 600 de 1781 à
1810. En 1780, les États-Unis compteront 575 420 Noirs, soit un cinquième de
leur population totale. De ce nombre, 90 % vivront au sud de la Pennsylvanie.
La majorité de ces esclaves
provenait des rivages du golfe de Guinée, soit le Ghana, le Sénégal, la Gambie
et le Biafra. Mais d'autres seront originaires du Congo, de l'Angola et du
Mozambique. Très peu d'esclaves furent importés des Antilles, car les colons
considéraient ces Noirs comme des mauvais travailleurs et de fortes têtes. Ils
préféraient les Noirs transplantés directement d'Afrique. Les esclaves importés dans les colonies
nord-américaines ne développèrent pas de créole (sauf en Louisiane française ou
en Louisiane espagnole). Ils apprirent l'anglais des colons, c'est-à-dire un
anglais déjà différent de celui parlé en Angleterre.
|

À la fin de la période coloniale, les Anglo-Saxons avaient dominé tous les
autres peuples: les Hollandais sur les rives de l'Hudson; les Suédois dans le
Delaware; les Français dans le Missouri, le Michigan, l'Arkansas, la Louisiane,
l'Indiana, l'Illinois, le Wisconsin et l'Alabama; les Espagnols en Floride, en
Californie et au Nouveau-Mexique. Les Anglo-Saxons étaient en voie d'absorber
tous les variétés de la race blanche. Pour ce qui est des Indiens, ils étaient
sur la voie de la liquidation. Quant aux Noirs, ils étaient réduits à
l'esclavage. En revanche, le rejet des
Indiens et des Noirs allait permettre d'accepter les immigrants européens comme des
égaux.
Tel est le contexte dans lequel s'amorcera la guerre de l'Indépendance.
De là à croire que les Anglo-Saxons seraient le peuple choisi par Dieu pour
coloniser l'Amérique du Nord et mener le monde vers la liberté, il n'y a qu'un
pas que beaucoup franchiront. Encore aujourd'hui, des millions d'Américains
croient non seulement qu'ils sont une nation choisie par Dieu, mais que
Dieu lui-même est américain.
Dernière mise à jour:
11 mars 2025