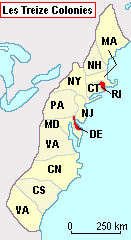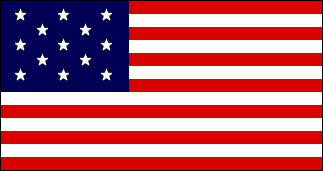|
|
Histoire sociolinguistique
des États-Unis
(3) La
révolution
américaine
(1776-1783)
|
|
Avis: cette
page a été révisée par Lionel Jean, linguiste-grammairien. |
Plan de l'article
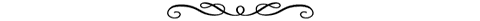
La révolution américaine fut un conflit armé qui
dura huit longues années. Elle constitua également une guerre civile entre sujets
britanniques et Américains, ainsi qu'une rébellion contre les autorités
coloniales et une insurrection contre le roi d'Angleterre (George III) et le
régime monarchique. Ce fut enfin une guerre de «libération nationale», la
première de l'histoire moderne. Si la révolution américaine a eu des
conséquences considérables sur le continent nord-américain, on a pu nettement en
déterminer les causes. En ce qui concerne la question linguistique, elle ne
semble pas avoir constitué une préoccupation majeure, car les hommes politiques américains associaient
l'interventionnisme linguistique à une pratique monarchiste qui avait cours en
Europe. Or, toutes les pratiques qui rappelaient la monarchie et ses excès
étaient bannies. C'est donc la non-intervention linguistique qui
caractérise cette époque de l'histoire américaine.
Avec le traité de Paris de 1763 qui mettait officiellement fin à la guerre de Sept Ans
(1756-1763) entre la France et la Grande-Bretagne, toute la Nouvelle-France, à
l'exception de la Louisiane cédée à l'Espagne, devint officiellement une possession britannique.
De son immense empire en Amérique du Nord, la France ne conservait plus que les
minuscules îles de Saint-Pierre-et-Miquelon au sud de Terre-Neuve. Pendant ce temps, la guerre
en Amérique du Nord britannique avait apporté la gloire aux généraux anglais, la mort aux simples soldats, la
fortune aux négociants, le chômage aux pauvres et l'effondrement économique des
peuples amérindiens.
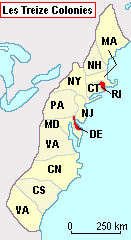 |
Cependant, afin de vaincre les Français au Canada et en Acadie, la Grande-Bretagne avait dû emprunter d'énormes
sommes d'argent en vue de payer ses coûteuses opérations militaires. Les seuls intérêts de la dette coûtaient au trésor britannique plus de
quatre millions de livres par an. Le gouvernement britannique eut
alors la fausse bonne idée de faire rembourser une partie de ces lourdes dépenses par les
Treize Colonies (les
seules qui pouvaient payer),
grâce à des taxes directes sur des produits tels que le thé, le vin, le sucre, la
mélasse, les journaux, etc. Il paraissait normal pour le
gouvernement britannique de faire défrayer par les colons de la
Nouvelle-Angleterre une partie des
dépenses encourues pour leurs bénéfices.
En revanche, les représentants des
Treize Colonies ne voyaient plus l'intérêt de maintenir cet onéreux dispositif
militaire britannique en raison de la
chute de la Nouvelle-France. De plus, les colons de la Nouvelle-Angleterre
n'avaient attendu que la victoire anglaise pour poursuivre enfin leur expansion
vers l'ouest. Or, le roi George III venait de commencer son
règne en 1760 et il avait bien l'intention de renforcer les prérogatives royales
sur ses colonies d'Amérique. Il considérait que ces colons étaient
des «sujets britanniques» qui avaient pour devoir premier de se plier à ses décisions.
|
Deux problèmes allaient surgir et réduire considérablement l'autorité royale. D'une part,
les
assemblées coloniales détenaient des pouvoirs importants, semblables à ceux
dont disposait le Parlement anglais, par exemple celui de voter les impôts et les
dépenses, sans oublier celui de s'assurer de l'initiative des lois. D'autre
part, l'éloignement géographique et l'obstacle que constituait un vaste océan rendaient
plus aléatoire toute tentative de domination sur les
Treize Colonies.
1.1 Les «lois intolérables» ("Coercive Acts") dans
les Treize Colonies
Les colons des Treize Colonies connurent leur première déception au moment où la
Grande-Bretagne, par la Proclamation royale de 1763, décida de réserver le «Territoire indien» à l'ouest de la
Nouvelle-Angleterre aux autochtones et interdit même aux colons de s'y
installer. Voici deux extraits de cette Proclamation (en traduction française):
|
Royal Proclamation of
1763
Fourthly
[...] We do hereby strictly
forbid, on Pain of Our Displeasure, all Our loving Subjects from making
any Purchases or Settlements whatever, or taking Possession of any of the
Lands above reserved, without Our especial Leave and Licence for that
Purpose first obtained.
And
We do further strictly enjoin and require all Persons whatever, who have
either wilfully or inadvertently seated themselves upon any Lands within
the Countries above described, or upon any other Lands, which, not having
been ceded to, or purchased by Us, are still reserved to the said Indians
as aforesaid, forthwith to remove themselves from such Settlements. [...] |
Proclamation royale de 1763
Article 4
[...] Nous défendons aussi strictement par
la présente à tous Nos sujets, sous peine de s'attirer Notre déplaisir,
d'acheter ou posséder aucune terre ci-dessus réservée, ou d'y former aucun
établissement, sans avoir au préalable obtenu Notre permission spéciale et
une licence à ce sujet.
Et Nous enjoignons et ordonnons strictement
à tous ceux qui, en connaissance de cause ou par inadvertance, se sont
établis sur des terres situées dans les limites des contrées décrites
ci-dessus ou sur toutes autres terres qui n'ayant pas été cédées ou achetées
par Nous se trouvent également réservées pour lesdits sauvages, de quitter
immédiatement leurs établissements. [...] |
Par la Proclamation royale, la Grande-Bretagne manifestait ainsi son opposition au désir
d'expansion de ses colons vers l'ouest du continent.
La seconde déception concernait la Loi sur le cantonnement (Quartering
Act) du 24 mars 1765, qui ordonnait aux autorités coloniales d'assurer le
logement des soldats de la Couronne britannique. Or, le maintien de l'armée
anglaise en temps de paix, soit près de 10 000 hommes, sur les territoires
coloniaux provoqua de nombreuses récriminations, d'autant plus que la Loi sur le
cantonnement permettait de réquisitionner des maisons pour loger les
soldats. Puis le parlement de Londres adopta la Loi sur la monnaie (Money
Act), la Loi sur le timbre (Stamp Act), la Loi sur le sucre
(Sugar Act), etc., le tout destiné à acquitter l'énorme dette accumulée
durant la guerre de Sept Ans. Comme si ce n'était pas assez, le gouvernement
britannique envoya ses propres douaniers, protégés par son armée, avec des
pouvoirs spéciaux tels que l'autorisation de pénétrer dans n'importe quel lieu privé ou public pour vérifier les marchandises et saisir toutes celles qui
seraient jugées illégales. Enfin, la Currency Act (Loi sur la monnaie) du
1er septembre 1763 interdit formellement l'émission de papier-monnaie
dans les colonies et privait celles-ci de liquidités. Comme on le constate, les «lois
intolérables» n'avaient aucun rapport avec la situation linguistique dans les
Treize Colonies. L'anglais
était la langue commune et la langue d'usage dans ces colonies, comme
dans la mère patrie.
1.2 L'Acte de Québec de 1774
 |
Devant les difficultés et le climat qui se détériorait dans les colonies
de la Nouvelle-Angleterre, le gouvernement britannique dut
prendre des mesures pour contrer les tendances autonomistes de ses
colonies d'Amérique du Nord. Le 20 mai 1774, le gouvernement fit adopter par le Parlement britannique l'Acte de Québec
(traduction traditionnelle de Quebec Act), une loi
constitutionnelle destinée à modifier le statut de la «province de
Québec». La Grande-Bretagne redonnait à la "province of Quebec" un
territoire (voir la carte de gauche) qui rappelait celui de la Nouvelle-France (sans la Louisiane)
et rétablissait les lois civiles françaises tout en reconnaissant
officiellement la religion catholique. C'était énorme!
L'Acte de Québec mit littéralement le feu aux poudres dans les
Treize Colonies.
Les colons anglais n'acceptaient pas que Londres puisse accorder des
droits territoriaux à leurs ex-ennemis de la Nouvelle-France contre
lesquels ils avaient combattu une quinzaine d'années plus tôt, sans parler
de la reconnaissance «en terre britannique» des «papistes canadiens». Les
marchands de New York et d'Albany furent indignés de voir limiter leur
expansion vers l'ouest et le commerce des fourrures
des Grands Lacs passer au profit de Montréal, comme avant la conquête de 1760. |
 |
Il parut inadmissible aux colons
anglais que l'Acte de Québec semblait non seulement mettre de côté tout
projet d'assimilation des Canadiens français, mais affirmait
juridiquement l'existence d'une civilisation française en Amérique. Ils
dénoncèrent aussitôt la «collusion anglo-canadienne» qui se liguait contre les
colons de la Nouvelle-Angleterre. Un avocat bostonnais
écrivit alors: «Eh quoi! Nous, les Américains, avons-nous dépensé autant de sang
et de richesses au service de la Grande-Bretagne dans la conquête du Canada,
pour que les Britanniques et les Canadiens puissent maintenant nous subjuguer?»
C'est pourquoi l'Acte de Québec, comme les autres lois appelées «lois
intolérables» ("Intolerable Acts"), «lois coercitives» ("Coercive Acts") ou
«lois punitives» ("Punitive Acts"), fut considéré comme tout à fait inacceptable pour les
Treize Colonies, qui le perçurent
comme une manœuvre dirigée expressément contre elles. |
En réalité, enfin débarrassés du rival français «qui ne laissait pas un
moment de repos» (selon les mots de Benjamin Franklin), les colons de la
Nouvelle-Angleterre refusaient l'intervention de la Métropole, qui les empêchait
de protéger leurs propres intérêts commerciaux et de jouir pleinement des
libertés qu'ils croyaient enfin acquises. Autrement dit, une autre colonie,
britannique celle-là, bloquait toujours l'expansion de la Nouvelle-Angleterre
vers l'ouest et
servait de base militaire à une mère patrie devenue «l'ennemie à abattre». Il
fallait donc éliminer le plus tôt possible cette menace!
Tous ces événements suscitèrent une grande colère dans les colonies de la
Nouvelle-Angleterre. Douze colonies sur treize (il ne manquait que la Géorgie)
se réunirent au sein du «Congrès contre la Loi sur le timbre» (Stamp
Act Congress ), tandis que
Benjamin Franklin défendait la cause des colons à Londres.
Aux yeux de ces derniers, ces lois violaient le droit des sujets britanniques de ne
pas être taxés sans consentement de leurs représentants en vertu du principe
No taxation without representation («Pas de taxation sans
représentation»), parce que les colonies n'étaient pas représentées au Parlement
britannique. Ces lois diminuaient ainsi
l'indépendance de leurs assemblées coloniales et constituaient la première étape
d'un «complot» visant à les priver de leurs libertés. Des sociétés secrètes de patriotes (appelés les «Fils de la liberté») se
constituèrent. Le mouvement de protestation colonial culmina, en octobre 1765,
lors du Congrès contre la Loi sur le timbre. Quant à
Benjamin Franklin,
il ne croyait
pas que l'imposition de ces taxes était suffisante pour déclencher la révolution:
|
Les
colonies auraient volontiers supporté l'insignifiante taxe sur le thé et
autres articles, sans la pauvreté causée par la mauvaise influence des
banquiers anglais sur le Parlement, ce qui a créé dans les colonies la
haine de l'Angleterre et causé la guerre de la Révolution. |
Les colons voulaient
bien être anglais, mais dans la mesure où l'Angleterre les laissait tranquilles.
En fait, ils acceptaient de s'enrichir «derrière les remparts de l'Empire», sans
«payer le prix de la sécurité».
Avec le recul, on dirait aujourd'hui que les colons britanniques
désiraient le beurre et l'argent du beurre!
L’unité des Treize Colonies américaines se réalisa dans leur opposition commune
à la politique du gouvernement britannique : en septembre 1774, sur l’initiative
de Benjamin Franklin, elles se réunirent à Philadelphie lors d'un premier Congrès
continental (5 septembre-26 octobre 1774). Deux colonies se mirent à la tête du
mouvement révolutionnaire: le Massachusetts et la Virginie. L'apport de ces deux
colonies, riches et peuplées, constituera pour l'avenir un avantage décisif. Juste
avant l'indépendance, la Virginie réunissait 21 % des colons américains, le
Massachusetts, 11 %, tout comme la Pennsylvanie. C'était presque la moitié de la
population des colonies.
2.1 La guerre de l'Indépendance (1775-1783)
La guerre de l’Indépendance américaine débuta le 17 juin 1775
(lors de la bataille de Bunker Hill) entre les Britanniques et les
Treize Colonies insurgées: Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode
Island, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie,
Caroline du Sud, Caroline du Nord et Géorgie. Toute
la Nouvelle-Angleterre abritait une population d'environ 2,5 millions
d'habitants. Les Britanniques pouvaient compter sur une armée de 30 000 soldats
de métier (disciplinés, expérimentés, bien armés et bien payés) et les meilleurs
généraux d'Europe, sans oublier 700 navires de guerre, 2000 navires de commerce
pour le transport des troupes et des munitions, ainsi que sur 150 000 marins.
Une force redoutable! Mais l'indépendance américaine n'allait être acquise qu'au
prix d'une longue guerre de sept ans, entraînant l'enlisement des Britanniques.
Quant aux insurgés américains, ils ne disposaient que de
18 000 à 20 000 hommes inexpérimentés — et leur nombre s'est même parfois réduit
jusqu'à 3000 hommes en état de combattre —, n'avaient pas de marine de guerre et
ne disposaient que de peu de généraux bien formés. Les insurgés ne
bénéficiaient par ailleurs que d'une armée de
miliciens volontaires mal équipés, à moitié soldats et à moitié cultivateurs. Dans plusieurs
colonies, on finira par imposer le service militaire pour tous les
hommes blancs âgés entre 16 et 60 ans. Cependant, demeurèrent généralement exemptés de
la conscription les membres de l'administration, les pasteurs, les étudiants et
les professeurs de Yale, les Noirs, les Indiens et les Mulâtres. C'était
beaucoup de monde! Il était aussi possible d'échapper à cette obligation en
payant la somme de cinq livres.
 |
De plus, les colons de la Nouvelle-Angleterre étaient
loin d’être tous solidaires et antiroyalistes. Ils
se divisèrent entre ceux qui
prônaient l'indépendance — les patriotes ou
républicains — et ceux qui voulaient rester
britanniques — les loyalistes (ou royalistes).
Plusieurs termes ont servi à désigner les antagonistes dans les colonies
américaines: Roundhead ou Puritans (pour leurs croyances
religieuses strictes) associés aux Whigs, contre Monarchists
associés aux Tories. On désigne aujourd'hui les monarchistes par
Loyalists aux États-Unis, mais au Canada on a longtemps utilisé l'expression
United Empire Loyalists (loyalistes de l'Empire uni). Comme
on le sait, les «loyalistes» fidèles à la Métropole se
rangèrent du côté des Britanniques avant de fuir au Canada, mais nombreux
sont ceux qui restèrent neutres. |
C'est à cette époque qu'apparut le mot
Yankee.
Selon une étymologie probable (Oxford English Dictionary), il s'agirait
d'un sobriquet employé par les soldats britanniques pour désigner leurs
adversaires. Yankee viendrait du mot néerlandais Yanke signifiant
«le petit Jan». Ce diminutif serait apparu parmi les troupes britanniques comme
un quolibet xénophobe destiné à renvoyer les insurgés à une origine étrangère et
à jeter le discrédit sur la vraie nature de leur rébellion. Les habitants des
colonies auraient pris ce terme péjoratif à leur compte selon un processus de bravade
sémantique. Après l'indépendance, les Anglais continueront d'utiliser le
terme Yankee pour désigner les Américains. On parlait des habitants de la
Nouvelle-Angleterre en disant «the New England or yankee country». Pour leur
part, les
Français ont eu une toute autre interprétation du mot Yankee. Selon ces
derniers, il s'agirait d'une déformation des Indiens du Massachusetts du mot
English en Yenghis, Yanghis et Yankies. Le Dictionnaire
Littré écrivait en 1877:
|
Yankee. N.m. Sobriquet par lequel les
Anglais désignent familièrement, et avec une espèce de dénigrement, les
habitants des États-Unis de l'Amérique du Nord. C'est le mot English,
anglais, défiguré par la prononciation des Peaux-Rouges. |
Littré ne cite aucune source à l'appui de sa description,
mais sa définition contredit certainement la tradition anglo-saxonne.
|
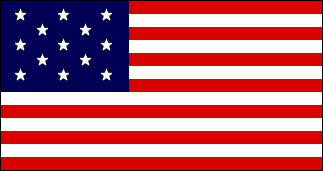
Drapeau de 1777 |
Le 4 juillet 1776, les colonies américaines adoptèrent en
anglais la
Déclaration d'Indépendance, rédigée par Thomas Jefferson,
un avocat très cultivé et francophile alors âgé de 33 ans, puis, le 15 novembre
1777, les Articles de la Confédération. Au moment où les Américains proclamaient leur indépendance,
ils formaient une population de 2,5 millions d'habitants, dont 1 950 000 Blancs,
520 000 Noirs et environ 100 000 Indiens. Benjamin Franklin notait alors que la
population doublait tous les vingt ans. C'est au cours de l'été 1782 que
Franklin rédigea les grandes lignes du traité réclamant l'indépendance totale,
l'accès aux zones de pêche des nouveaux territoires, l'évacuation par les forces
anglaises des zones occupées et l'établissement d'une frontière occidentale sur
les rives du Mississipi. |
Au même moment, Thomas Paine
(1737-1809), un intellectuel pamphlétaire et révolutionnaire d'origine
anglaise, publiait à Philadelphie, en
janvier 1776, un pamphlet intitulé en anglais Common Sense (Le sens
commun en français), ouvrage considéré aujourd'hui comme le premier
best-seller américain. Il s'agissait d'un vibrant plaidoyer en faveur de
la rupture avec la Grande-Bretagne et l'établissement d'une république en
Amérique du Nord. Paine défendait l'idée que les
assemblées coloniales étaient plus à même de gouverner les colonies que le
lointain Parlement de Westminster.
 |
Il pensait que la Révolution américaine devait
aboutir à «la naissance d’un monde nouveau»; il trouvait ridicule et contre
la loi naturelle «qu'une île règne sur un continent». Pour lui, l'Amérique
n'était plus «une nation britannique» : elle se composait d'influences de
tous les pays d'Europe. Il en tira
la conclusion que l'indépendance des colonies était devenue
inévitable et nécessaire. L'ouvrage de Paine aurait inspiré des personnalités
telles George Washington, Benjamin Rush et John Adams.
Le pamphlet
fut publié à plus de 150 000 exemplaires dans les colonies
britanniques (pour une population de 1,5 million d'habitants),
et il fut distribué en Europe. Aucun autre pamphlet
de cette époque ne souleva autant d’enthousiasme parmi les patriotes, mais
aussi une grande opposition de la part des loyalistes. Les écrits de Thomas
Paine, parmi lesquels figure les Rights of Man («Droits
de l'Homme» de 1791), exercèrent une grande influence sur la
Révolution française. Parlant bien le français, Paine fut même
élu député à l’Assemblée nationale française en 1792, mais il
fut incarcéré par Robespierre en 1793, puis libéré après dix
mois et réadmis comme comme député à la Convention en 1795. |
À l'invitation du président
Thomas Jefferson,
Paine quitta la France en 1802 pour les États-Unis, qualifiant alors Napoléon
Bonaparte, premier consul, de «charlatan le plus parfait qui eût jamais
existé». Après la vente de la Louisiane en
1803, Thomas Paine recommanda aux nouveaux Américains du territoire de
Louisiane l'apprentissage de la langue anglaise, mais aussi l'«adaptation»
de leurs pratiques religieuses catholiques. L’égalité des citoyens
américains étant le premier fondement de la République, les habitants de la
Louisiane devaient bénéficier des mêmes droits civils que les habitants des
États-Unis, mais ils ne devaient pas constituer une portion spécifique de la
population américaine, qui serait dotée de droits eux-mêmes particuliers.
C'est pourquoi Thomas Paine se prononça pour la suppression du nom même de
«Louisiane» à l’image de la suppression des noms des provinces françaises.
De même, il considérait que la poursuite de la traite des Noirs en Louisiane
serait non seulement une ignominie, mais aussi un obstacle à l’immigration
libre et donc à l’intégration républicaine.
2.2
La «revanche» de la France
L'insurrection américaine fut particulièrement bien
accueillie en France, surtout auprès de l'aristocratie et la bourgeoisie. Les
nouvelles étaient lues et commentés, et en général la rébellion était perçue
comme le combat de l'«esprit des Lumières» face à la «tyrannie britannique». C'est alors que la France, désireuse de prendre sa
revanche sur la Grande-Bretagne qui lui avait infligé la défaite de 1763, décida,
après de longues tergiversations et sous l'impulsion du ministre des Affaires
étrangères, le compte de Vergennes (1774-1781),
d'aider les insurgés. La France commença en 1776 par livrer clandestinement des armes,
mais l'aide
déterminante se concrétisa par l'envoi de soldats, de navires de guerre et
d'importantes sommes d'argent, sans compter les renforts navals (123 vaisseaux
de la Marine royale au total) et de quelque 35 000 hommes (au total), ce qui fera pencher la balance en faveur
des insurgés. En fait, si Louis XV avait dépensé autant d'argent
que Louis XVI en mit pour se venger, la France aurait conservé la Nouvelle-France.
En même temps, de Paris, le 25 mai 1777, Benjamin Franklin annonçait
au Congrès l'arrivée du marquis Gilbert de La Fayette en ces termes:
|
The Marquis de Lafayette, a young nobleman of great family
connections here and great wealth, is gone to America in a ship of
his own, accompanied by some officers of distinction, in order to
serve in our armies. He is exceedingly beloved, and everybody's good
wishes attend him. We cannot but hope he may meet with such a
reception as will make the country and his expedition agreeable to
him. |
[Le marquis de La Fayette, gentilhomme français de grands entourages
de famille et de grande fortune, est parti pour l'Amérique sur un
vaisseau à lui, afin de servir dans nos armées. Il est extrêmement
aimé, et les vœux de tout le monde l'accompagnent; nous ne pouvons
qu'espérer qu'il puisse recevoir un accueil qui lui rende le pays et
son entreprise agréables pour lui.] |
Mais les Américains n'avaient que faire d'un marquis,
au surplus républicain et déclaré hors-la-loi par la cour de France, et il
devint simplement «Lafayette». Celui-ci apprit l'anglais, bien qu'il ne réussit
jamais à le maîtriser parfaitement. Grâce à l'appui indéfectible de George
Washington, le jeune aristocrate français, alors âgé de 19 ans, obtiendra le
grade de «major-général dans l'armée des États-Unis» et il se couvrira de gloire.
Dans la foulée de la Révolution américaine, Versailles avait déclaré la guerre à
Londres et entraîné l'Espagne dans cette entreprise. En janvier 1778, le major-général Lafayette
et le maréchal de Rochambeau prirent le commandement d’un corps expéditionnaire français envoyé
en Amérique afin de soutenir militairement les révolutionnaires américains. Il
s'agissait là d'une étrange alliance, car une jeune république s'alliait à une
monarchie de droit divin, des protestants étaient devenus des amis d'un roi
catholique et d'anciens colons britanniques tendaient la main aux Français qu'ils
avaient longtemps combattus.
Au cours de l'hiver 1778, quelques officiers américains
élaborèrent un projet d'expédition au Canada afin de débarrasser le pays des
Anglais qui le possédaient depuis la fin de la guerre de Sept Ans. Ils voulurent
faire proposer par le Congrès le commandement en chef à Lafayette. Celui-ci
écrit à sa femme (3 février 1778):
|
Je ne vous ferai pas de longs
détails sur la marque de confiance dont l'Amérique m'honore. Il vous
suffira de savoir que le Canada est opprimé par les Anglais; tout cet
immense pays est en possession des ennemis; il y ont une flotte, des
troupes et des forts. Moi, je vais m'y rendre avec le titre de général de
l'Armée du Nord et à la tête de 3000 hommes, pour voir si l'on peut faire
quelque mal aux Anglais dans ces contrées. L'idée de rendre toute la
Nouvelle-France libre et de la délivrer d'un joug pesant est trop
brillante pour s'y arrêter. J'entreprends un terrible ouvrage, surtout
avec peu de moyens. |
Mais le général de l'Armée du Nord dut renoncer à son
projet de conquérir le Canada, justement faute de moyens. De toute façon, le
général Washington, qui n'appréciait pas revoir une ancienne puissance coloniale
au nord de la frontière, s'était organisé pour que La Fayette ne puisse pas
poursuivre ses objectifs militaires. Au lieu des 3000 hommes promis, La Fayette n'en
disposa même pas d'un millier; il n'eut pas les vêtements nécessaires, ni les
vivres, ni les raquettes et encore moins les traîneaux que le Bureau de la
guerre devait fournir pour assurer le succès de l'expédition. Washington
s'empressa d'excuser La Fayette (alors âgé de vint ans) en lui écrivant ces mots
:
|
Je suis persuadé que tout le
monde approuvera la prudence qui vous a fait renoncer à une entreprise
dont la poursuite vous eût engagé dans une lutte vaine contres des
impossibilités physiques. |
Cela étant dit, le roi de Prusse, Frédéric le Grand
(1712-1786), semble avoir vu juste sur les intentions de la France, comme en
témoigne cet extrait d'une lettre adressée à son ambassadeur à Paris:
|
On se trompe
fort en admettant qu'il est de la politique de la France de ne point se
mêler de la guerre des colonies. Son premier intérêt demande toujours
d'affaiblir la puissance britannique partout où elle peut, et rien n'y
saurait contribuer plus promptement que de lui faire perdre ses colonies en
Amérique. Peut-être même serait-ce le moment de reconquérir le Canada?
L'occasion est si favorable qu'elle n'a été et ne le sera peut-être dans
trois siècles. |
 |
La bataille de Yorktown (6-19 octobre
1781) fut décisive pour l'indépendance américaine. Les 6000 Britanniques et les
2000 Allemands de lord Cornwallis durent faire face aux 11 000 Français et aux
6000 hommes de Washington (incluant des Polonais, des Allemands, des Canadiens
français et
des Indiens cherokees). Au même moment, la flotte française de 28 vaisseaux de
l'amiral de Grasse assurait le blocus du port de Yorktown, empêchant ainsi tout
ravitaillement ou toute fuite des Britanniques par la mer. D'ailleurs, la
supériorité navale acquise par l’escadre de l'amiral français semble avoir été
la clé de la victoire franco-américaine. Ce fut la première
grande opération combinée (infanterie, cavalerie, artillerie et marine) de
l'histoire, réunissant trois grands militaires: Washington, Rochambeau et de
Grasse. Le général anglais Charles Cornwallis dut capituler.
Au lendemain de la victoire de Yorktown, Thomas Jefferson rendit hommage aux Français en déclarant
que «chaque homme a deux patries: son pays et la France». Cette victoire
franco-américaine valut à la France le surnom de «Nourrice d’Hercule». C'est
pourquoi le SAR Magazine pouvait déclarer:
|
Without the aid of France, on
land and sea, the rebellion of the thirteen colonies against Great Britain
would have failed. There would be no United States of America. |
[Sans l'aide de la France, sur
terre et sur mer, la rébellion des Treize Colonies contre la
Grande-Bretagne aurait échoué. Il n'y aurait pas d'États-Unis d'Amérique.] |
Cependant, le coût excessif de la guerre franco-américaine plongea la France
dans une situation financière délicate et accéléra la crise de la monarchie qui
paiera ainsi très cher sa revanche sur la «Perfide Albion». La guerre aura coûté
un milliard de livres tournois, soit l'équivalent de huit milliards d'euros
d'aujourd'hui (ou dix milliards de dollars US), creusant encore davantage le gouffre financier
de la France. |
L'espoir de
devenir le premier partenaire commercial des nouveaux États-Unis s'évanouit
rapidement, de
même que toute éventuelle restitution de la Nouvelle-France.
George Washington était déterminé à jeter hors de
l'Amérique toutes les puissances coloniales européennes, que ce soit la
Grande-Bretagne ou la France! Louis XVI dut
convoquer les états généraux pour réformer les impôts, ce qui entraînera la
Révolution française (1789) et plus tard sa décapitation et l'abolition de la
monarchie (1793).
Finalement, les
relations entre la France et les États-Unis se détériorèrent rapidement, surtout
après la mort de Louis XVI et les excès de la Révolution française sous la
Terreur. Puis les Américains, rappelons-le, firent peu
d'efforts pour rembourser les énormes dépenses encourues par la France pour
assurer leur indépendance tout en reprenant leurs liens commerciaux privilégiés
avec la Grande-Bretagne. Bref, si les Britanniques
avaient perdu la guerre, ils ont su ensuite gagner la paix. La France, elle,
n'était pas plus avancée avec comme seule récompense «la reconnaissance
éternelle» des États-Unis d'Amérique.
2.3 L'indépendance américaine
Cette indépendance fut officiellement reconnue
par la Grande-Bretagne à l’issue du traité de Paris et du
traité de Versailles (3
septembre 1783). Ce sont John Adams, John Jay et Benjamin Franklin (âgé de plus
de 70 ans) qui signèrent pour les États-Unis le traité de paix garantissant
l'indépendance. Selon les termes du traité, les États-Unis
obtenaient :
- l'indépendance sous le nom d'«États-Unis d'Amérique»;
- l'expansion de leur territoire vers l'ouest
jusqu'au Mississippi et l'absorption des «Territoires indiens»;
- la fixation des frontières avec le Canada et la division des Grands
Lacs en deux, sauf le lac Michigan, qui revenait entièrement aux Américains;
- l'obtention de droits de pêche sur les bancs de Terre-Neuve et au large de
la Nouvelle-Écosse.
De son côté, la Grande-Bretagne obtenait:
- la reconnaissance des dettes contractées
avant, pendant et après le conflit (remboursables en livres sterling);
- l'amnistie des loyalistes et la liberté pour eux de s'installer dans les
autres colonies britanniques (Québec, Nouvelle-Écosse, Bermudes, Antilles
britanniques, etc.).
 |
Au point de vue territorial, le traité de
Versailles traçait de nouvelles frontières entre les colonies britanniques au
nord et les États-Unis au sud (1783). Les États-Unis ont vu leur territoire doublé,
alors que celui de la «province de Québec» (alors le Canada) a été réduit du
tiers. De fait, le Canada voyait sa frontière
sud-ouest passer désormais au milieu des Grands Lacs, sauf pour le lac Michigan
qui allait entièrement aux États-Unis. Plus au sud, la Grande-Bretagne
perdait la Floride qui devenait espagnole. Les nouvelles frontières qui
régissaient la province de Québec faisaient en sorte que les Canadiens qui
habitaient la région au sud des Grands Lacs devenaient du jour au lendemain
citoyens américains. Or, la quasi-totalité des habitants étaient des
Amérindiens, des Métis francisés ou des francophones. Ils deviendront
anglophones au cours des décennies suivantes. |
Cela étant dit, le Canada demeurait une possession
britannique qui disposait de puissantes armées, parfaitement équipées, et
pouvait encore, sur ordre de Londres, envahir les États américains du Nord.
Bref, l'Amérique vivait dans une phase critique et rien n'était acquis de façon
définitive. Les traditions britanniques,
étant ce qu'elles étaient, si les Américains avaient perdu la guerre pour leur
indépendance, tous les révolutionnaires, dont George Washington, Benjamin
Franklin, Thomas Jefferson, James Madison,
John Adams, etc., auraient été pendus ou
fusillés sur la place publique, leurs biens confisqués, leurs familles
massacrées ou jetées dans la misère.
La nouvelle nation américaine se trouva rapidement dans une situation politique
et économique difficile. Le gouvernement fédéral ne détenait alors qu’une faible
autorité. La nécessité d’établir un gouvernement central s’imposa bientôt dans
les esprits. Une Convention constitutionnelle se réunit sous la présidence de
George Washington.
3.1 Une république fédérale
|
 |
Une nouvelle constitution des États-Unis, inspirée par
le colonel James Madison (futur 4e
président des États-Unis), Alexander
Hamilton, un autre militaire, et James Wilson, un spécialiste du droit, fut adoptée le 17 septembre 1787 (voir
le texte complet), soit quatre ans après l'indépendance effective du pays et
plus de dix ans après la proclamation unilatérale de l'indépendance. La
ratification de la Constitution par les élus des 13 États membres de la
Confédération s'est étalée sur deux ans et demi, de décembre 1787 à juin 1790. Ménageant le souci
d’indépendance des Treize États, la Constitution mit en place un pouvoir fédéral compétent
dans les domaines du commerce extérieur, de la défense et de la politique
extérieure, ainsi que dans le domaine des relations entre les États fédérés.
Afin que les grands États ne dominent pas les petits, il fut décidé d’une
représentation égale au Sénat (deux sièges par État) et proportionnelle à la
Chambre des représentants. La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire, fut instituée.
Dans une lettre de
1787 à Thomas Jefferson, James Madison, l'un des «pères de la Constitution»,
écrivait: «Diviser pour régner, cette règle corrompue propre à la tyrannie
est, sous certaines conditions, la seule politique qui permettra à une
république d’être administrée par de justes principes.» |
La nouvelle Constitution fut, dès 1788, signée par
onze États. La Caroline du Nord ne la ratifia qu’en novembre 1789 et le Rhode
Island en mai 1790. Le 4 mars 1789, le premier Congrès des États-Unis se réunit
à New York. Le 30 avril,
George Washington devint le
premier président des
États-Unis (1789-1797). En 1791 furent adoptés les
dix premiers amendements de
la Constitution des États-Unis.
 |
Par ailleurs, c'est en 1782 que le Congrès a adopté le
pygargue à tête blanche comme emblème national des États-Unis avec la devise
E Pluribus Unum («De plusieurs, un»). Cependant, Benjamin Franklin
lui avait préféré le dindon sauvage; il estimait que le pygargue était
un oiseau de mauvaise moralité ("a Bird of bad moral character"), et
trop paresseux pour pêcher lui-même ("too lazy to fish for himself"),
survivant seulement en dérobant les prises du balbuzard, un autre
rapace. Pour Franklin, le dindon sauvage était un oiseau bien plus
respectable ("a much more respectable Bird"), un peu vaniteux et
ridicule, mais courageux ("a little vain & silly [but] a Bird of
Courage"). Évidemment, malgré son statut de symbole du pays, cela n'a
pas empêché le pygargue d'être exterminé dans la plupart des États, sauf en
Floride et en Alaska, sous prétexte qu'il nuisait aux aires de reproduction des
saumons (ce qui s'est révélé complètement faux.
Aujourd'hui, il est l'un des symboles les plus
connus du pays et apparaît sur la plupart des sceaux officiels, y
compris sur celui du président américain. |
3.2 L'élite coloniale et le peuple
|
Préambule de la Constitution
Nous, Peuple des États-Unis,
en vue de former une Union plus parfaite, d'établir la justice, de faire
régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer
le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes
et à notre postérité, nous décrétons et établissons cette constitution
pour les États-Unis d'Amérique. |
|
Il convient de rappeler
que le fameux «peuple des États-Unis» ("We, the People of the United
States") dont il est question dans la
Constitution américaine de 1787
ne comprenait ni les Indiens, ni les Noirs, ni les femmes, ni même les
serviteurs blancs sous contrat. De plus, la liberté dont il est fait
mention excluait la liberté des esclaves et des autochtones, bien que la
lutte pour l'indépendance contre l’Angleterre ait été rapportée comme
une lutte pour la liberté; c’était la liberté pour les esclavagistes de
faire ce qu’ils voulaient, la liberté d'exploiter les plus vulnérables. |
En 1787, cette constitution apparut comme une «œuvre de génie»,
pensée par des hommes sages et remplis d'humanisme, qui auraient édifié un cadre
juridique élevé en hommage à la Démocratie et à l'Égalité. En fait, la nouvelle
Constitution a été rédigée par une petite élite coloniale, soit 55 hommes parmi
les plus riches de la Nouvelle-Angleterre. Ce nouveau pays permettait aux plus
riches de devenir encore plus riches en exploitant d'abord les esclaves, la
liberté d'exploiter signifiant moins de liberté pour les exploités.
Par exemple,
George Washington était l'homme le plus fortuné
d'Amérique (parmi les 400 Américains les plus riches); John Hancock, un négociant prospère de Boston;
Benjamin Franklin, un
riche imprimeur; Thomas Jefferson, un propriétaire terrien fortuné possédant
près de 200 esclaves; Alexander Hamilton, un riche banquier;
James Madison, un riche
planteur esclavagiste, John Adams, avocat ayant fait fortune à Boston, etc. La plupart des «Pères de la Constitution» étaient
des professionnels du droit et parlaient tous anglais, mais certains d'entre eux parlaient bien le français (Franklin,
Adams, Day, Jefferson, Livingston, etc.) ou l'allemand, voire le latin et/ou le
grec. Jefferson parlait l'anglais, le français, l'italien, le latin et le grec. Le plus polyglotte
fut
certainement Benjamin Franklin qui avait appris le français, l'allemand,
l'espagnol, l'italien, un peu de gallois, sans oublier le latin et le grec.
Ces
prospères propriétaires terriens
possédaient des esclaves, des manufactures, des compagnies maritimes et
plaçaient de l'argent rapportant de gros intérêts. Si l'on en croit les archives
du Département du Trésor, 40 des 55 Constituants (soit 72,7 %) possédaient des
titres gouvernementaux. N'oublions pas qu'à l'époque personne ne pouvait accéder
à un poste officiel sans posséder une fortune considérable. Pour la plupart
d'entre eux, l'esclavage apparaissait comme un mal nécessaire dans une colonie
qui manquait de main-d'œuvre et dont les traditions étaient celles d'un monde
colonial. Si Alexander Hamilton fut un riche financier, Thomas Paine fut l'un
des rares révolutionnaires à mourir dans la pauvreté.

Évidemment, ces quelques privilégiés ont fait en sorte de
protéger leurs intérêts en légalisant dans la Constitution la condition sociale
inférieure des Noirs, l'exclusion des Indiens et des femmes, la domination des
riches sur les pauvres, bref tout ce qui existait dans les colonies britanniques
avant l'indépendance.
La différence, c'est que l'élite fortunée américaine dut faire
quelques concessions en faveur des petits propriétaires, des artisans et des
fermiers aux revenus modestes afin de s'assurer un soutien politique plus large.
Ces gens modérément prospères formaient un rempart efficace contre les Indiens,
les Noirs et les Blancs pauvres. En ce qui a trait aux esclaves, un compromis fut trouvé
à l'époque pour établir la répartition des représentants entre les États. Il fut admis par
tous les États qu'un Noir équivalait aux trois cinquièmes d'un Blanc, ce qui
signifiait que l'esclave était ipso facto reconnu par la Constitution.
Les États esclavagistes durent accepter de verser une contribution qui tenait
compte de leur population servile.
D'ailleurs, John Adams aura de la difficulté à
devenir président des États-Unis (1797-1801),
car il n'était
pas particulièrement apprécié par ses concitoyens en raison de ses
idées sur «les riches, les bien-nés et les capables» ("the rich, the well-born,
and the able"), qui devaient jouer un rôle
particulier dans les assemblées législatives locales (A Defence of the
Constitutions of Government of the United States of America, 1787). Voici ce
qu'Adams écrivit sur ce sujet :
|
The rich, the well-born, and the able, acquire an influence among
the people that will soon be too much for simple honesty and plain
sense, in a house of representatives. The most illustrious of them
must, therefore, be separated from the mass, and placed by
themselves in a senate; this is, to all honest and useful intents,
an ostracism. A member of a senate, of immense wealth, the most
respected birth, and transcendent abilities, has no influence in the
nation, in comparison of what he would have in a single
representative assembly. When a senate exists, the most powerful man
in the state may be safely admitted into the house of
representatives, because the people have it in their power to remove
him into the senate as soon as his influence becomes dangerous. The
senate becomes the great object of ambition; and the richest and the
most sagacious wish to merit an advancement to it by services to the
public in the house. When he has obtained the object of his wishes,
you may still hope for the benefits of his exertions, without
dreading his passions; for the executive power being in other hands,
he has lost much of his influence with the people, and can govern
very few votes more than his own among the senators. |
Les riches, les bien-nés et les capables acquièrent une influence
parmi le peuple, qui sera bientôt trop grande pour leur simple
honnêteté et leur bon sens ordinaire à une Chambre des
représentants. Les plus illustres d'entre eux doivent donc être
séparés de la masse et placés par elle dans un sénat; c'est, de
toutes les intentions honnêtes et utiles, un ostracisme. Un membre
d'un sénat, immensément riche, de la naissance la plus respectée et
de capacités supérieures, n'a aucune influence dans la nation, par
comparaison à ce qu'il ferait dans une simple assemblée
représentative. Quand un sénat existe, l'homme le plus puissant de
l'État peut être sans risque admis à la Chambre des représentants,
parce que les gens ont le pouvoir de le retirer du Sénat aussitôt
que son influence devient dangereuse. Le Sénat devient le grand
objet de l'ambition; et le plus riche et le désir le plus avisé de
mériter un avancement grâce au service public dans la Chambre. Quand
il a obtenu l'objet de ses désirs, vous pouvez toujours espérer des
bénéfices de ses efforts sans redouter ses passions; lorsque le
pouvoir exécutif est en d'autres mains, il a perdu beaucoup de son
influence auprès du peuple et peut obtenir très peu de votes autre
le sien parmi les sénateurs. |
La Constitution de
1787 ne prévoyait aucun suffrage universel: les
sénateurs étaient désignés par les législatures des États, alors que le
président était choisi par un collège restreint d'électeurs (les «grands
électeurs»). Enfin, tout était
prévu pour empêcher un pouvoir de prendre le pas sur les autres et l'État
fédéral d'étouffer les droits des États. La Constitution devait rallier au moins
neuf États sur les treize. La plupart des constituants (signataires) étaient convaincus que la
monarchie restait la meilleure forme de gouvernement et rêvaient d'instaurer «une
monarchie sans monarque» tout en se méfiant du «peuple». Finalement, il en sortit
une sorte de «monocratie» dans laquelle le pouvoir exécutif est théoriquement
représenté par une seule personne: le président des États-Unis. Tout le monde
connaît sans doute le mot, strictement authentique, d'Abraham Lincoln. En pleine guerre de
Sécession, le président avait conclu une réunion de travail (sur l'émancipation
des esclaves), dont tous les membres avaient exprimé une position contraire à la
sienne, en lançant: «Messieurs, huit non, un oui. Le oui l'emporte.»
C'est pourquoi
également la
conduite des affaires publiques devait revenir à ceux qui possédaient la
richesse, l'éducation et qui jouissaient d'une tradition familiale — il
s'agissait alors d'une «démocratie terrienne» qui dura jusqu'en 1824. Ceux qui votaient
étaient ceux qui
détenaient une propriété, c'est-à-dire ceux qui avaient quelque chose à défendre et
étaient directement concernés par la gestion des affaires publiques. C'est ce
qui explique que le président devait être élu par des délégués sélectionnés, non directement par le
peuple dont il fallait se méfier. Par la suite, le recours au suffrage a évolué
en une multiplication de procédures démocratiques. Finalement, le citoyen
exercera son droit de vote
au XXe siècle pour les juges, les sénateurs, les
shérifs, voire les maîtres d'école.
N'allons pas croire que la démocratie américaine a
radicalement changé.
Elle demeure toujours une ploutocratie, qui sert encore et avant tout ceux qui
ont de l'argent pour faire élire des candidats, lesquels vont influer sur les
décisions publiques. Le système démocratique américain est financé depuis sa
création en 1787 par les riches. Rien n'a changé dans ce domaine. C'est pourquoi
aucun président des États-Unis, même parmi les plus progressistes, ne peut
combattre un système lubrifié à l'argent depuis si longtemps pour une raison
très simple: pour assurer son élection ou sa réélection, un candidat à la
présidence (de même qu'à un poste de sénateur ou de représentant) doit trouver des
dizaines de millions auprès des donateurs privés, des groupes
d'intérêt et des entreprises.
Il n'est pas dû au hasard que des milliards de
dollars en baisse d'impôt ont été accordés aux riches Américains sous
l'administration de George W. Bush (2001-2009).
Ce fut encore mieux lors de l'élection de Donald Trump
en novembre 2024, puisque les candidats aux élections américaines ont battu le
record de collecte de fonds, amassant au total 15,9 milliards de dollars, selon
l’organisation Open Secrets qui a compilé les données. Les États-Unis sont ainsi
passés d'une ploutocratie à une oligarchie, car ce sont les riches qui financent
les élections en fonction de leurs intérêts. Il s'agit d'une prise de pouvoir et
d'argent par les plus riches en ne laissant aux autres que des miettes. C'est un
gouvernement du 1 %, pour le 1 % et par le 1 %, En 2023, par exemple, 1 % des
ménages américains les plus riches possédaient 0,30 $ de chaque dollar.
3.3 La question linguistique
Le premier document juridique, les Articles de la Confédération
de 1777, avait été publié en anglais, en français et en allemand, ce qui
pouvait signifier une forme de reconnaissance du multilinguisme. De fait, durant
un certain temps, il y eut des tensions entre l'anglais, l'allemand, le français
et l'espagnol. Les trois dernières langues ont résisté longtemps à
l'anglicisation, mais les communautés qui utilisaient ces langues n'ont jamais
réclamé pour celles-ci un statut particulier. Il est vrai que, dans les
premières années de l'Union, le Congrès américain publia plusieurs documents en
français et en allemand dans le but de mieux les diffuser dans certaines
régions du pays. En réalité, les États-Unis ont appliqué, depuis le début de leur
histoire, une politique linguistique jacobine, c'est-à-dire une politique
d’imposition linguistique, sans recourir à des lois, avec des résultats qui feraient l’envie de nombreux
pays. La population américaine était issue de différents pays et parlait
de nombreuses langues. Le nouvel État se trouvait ainsi confronté à un problème de
plurilinguisme très semblable à celui que connaissent aujourd'hui nombre de
pays. Pour les dirigeants américains, il paraissait toutefois évident que l'anglais allait s'imposer sans
contrainte constitutionnelle.
Les nouveaux dirigeants américains n'ont jamais cru
nécessaire d'inclure dans la Constitution une quelconque disposition sur la
langue officielle. D'ailleurs, il n'y eut pas de discussion à ce sujet, car ce
n'était pas dans les coutumes de l'époque acquise au libéralisme. Les Américains
constataient que la Grande-Bretagne et la
France fonctionnaient très bien sans langue officielle proclamée, comme
d'ailleurs dans la plupart des autres pays. Pourtant, il existe bien
une certaine «légende» sur la question linguistique aux États-Unis. On raconte que le
Congrès devait se
prononcer sur le choix entre l'anglais et
l'allemand,
le 13 janvier 1795; l'anglais aurait été choisi par un seul vote de majorité. Or, aucun historien n'a pu trouver une trace quelconque d'un
vote semblable. On croit plutôt qu'aucun vote n'a été pris et qu'aucune décision
ne fut nécessaire. Il s'agit là d'une des légendes les mieux connues de
l'histoire de l'aménagement linguistique des États-Unis: c'est la légende dite
«de Muhlenberg». Les historiens croient plutôt qu'une demande a été faite par un
groupe d'Allemands de la Virginie afin d'obtenir que certaines lois soient
publiées en allemand comme en anglais. La proposition aurait été rejetée par un
vote de majorité, apparemment amenée par un ecclésiastique luthérien
germanophone du nom de Frederick Muhlenberg (1750-1801).
On raconte aussi que le très francophile
Thomas Jefferson
(1801-1809)
aurait proposé de choisir le français comme langue officielle de l'Union afin de
mieux marquer la rupture avec l'ancienne métropole. Encore là, aucun historien
n'a pu le confirmer par des textes! Il faut dire que la plupart des discussions sur le sujet
ont été tenues secrètes, et nous devons nous rabattre sur les notes informelles
de James Madison (président de
1809 à 1817).
En réalité, le futur président
John Adams (1797-1801)
semble être l'un des rares «Pères de la Constitution» américaine à
avoir porté un grand intérêt pour la question linguistique. Il était convaincu qu'une
langue commune était importante pour le nouvel État et, malgré le conflit avec
la Grande-Bretagne, cette langue devait être l'anglais. Adams a même proposé
de créer une Académie de la langue américaine destinée à épurer, améliorer et
préserver l'anglais ('' an American Academy for refining, improving, and
ascertaining the English Language"). Adams voulait vraiment «épurer, développer
et dicter l'emploi de l'anglais» (''to purify, develop, and dictate the usage of
English''). Il ne manquait pas d'argument, comme le laissent croire ces propos
rédigés le 5 septembre 1780 dans une lettre au président du Congrès :
|
English
is destined to be in the next and succeeding centuries more generally the
language of the world than Latin was in the last or French is in the
present age. The reason of this is obvious, because the increasing
population in America, and their universal connection and correspondence
with all nations will, aided by the influence of England in the world,
whether great or small, force their language into general use, in spite of
all the obstacles that may be thrown in their way, if any such there
should be. |
[L'anglais est destiné, au
cours du prochain siècles et des siècles suivants, à être plus
généralement la langue du monde que le latin l'était en dernier ou le
français à l'époque présente. La raison de cela est évidente, parce que la
population croissante en Amérique et ses relations et ses écrits
universels avec toutes les nations auront pour effet, en cela facilité par l'influence de
l'Angleterre dans le monde, qu'elle soit grande ou petite, d'imposer sa
langue comme emploi généralisé, malgré tous les obstacles qui peuvent être
jetés sur son chemin, s'il doit y en avoir.] |
On peut lire la «Lettre
au président du Congrès» que John Adams, alors ministre plénipotentiaire
pour négocier un traité de paix et de commerce avec la Grande-Bretagne,
expédia à partir d'Amsterdam, en cliquant
ICI, s.v.p. Toutefois, la proposition de John Adams fut aussitôt
rejetée par le Congrès qui jugea une telle intrusion comme non démocratique de
la part du gouvernement de l'Union parce qu'elle aurait constitué une menace aux
droits individuels des citoyens. Le consensus était établi sur le fait qu'un
gouvernement dit démocratique n'avait pas à dicter aux gens comment
parler et que le choix de la langue devait être laissé à chaque citoyen. De
plus, les Américains considéraient que les académies sur la langue constituaient
des institutions royalistes.
Au moment où, en 1780, Johan Adams faisait sa proposition
pour promouvoir une «langue américaine», un obscur professeur du Connecticut
allait devenir bientôt le fer de lance de la «langue américaine»: Noah Webster
(1758-1843).
Dans ses Dissertations on the English Language publiées en 1789, Webster
allait déclarer la guerre linguistique à l'«anglais du roi» (''the King's English'')
:
|
As an independent nation, our
honor requires us to have a system of our own, in language as well as
government. Great Britain, whose children we are, and whose language we
speak, should no longer be our standard; for the taste of her writers is
already corrupted, and her language on the decline. But if it were not so,
she is at too great a distance to be our model, and to instruct us in the
principles of our own tongue. |
[En tant que nation
indépendante, notre honneur exige que nous ayons notre propre système,
dans la langue aussi bien que dans le gouvernement. La Grande-Bretagne,
dont nous sommes les enfants dont nous parlons la langue, ne doit plus
être notre norme; le goût de ses auteurs est déjà corrompu et sa langue en
déclin. Mais si ce n'était pas ainsi, cette langue paraît à une trop
grande distance pour être notre modèle et nous instruire selon les
principes de notre propre langue.] |
Voici l'argumentation un autre extrait du texte de Webster
dans "An Essay on the Necessity, Advantages, and Practicality of Reforming the
Mode of Spelling and of Rendering the Orthography of Words Correspondent to
Pronunciation" ("Un essai sur la nécessité, les avantages et les aspects
pratiques de réformer le mode d'orthographe et de rendre correspondante
l'orthographe à la prononciation des mots"):
|
The question now occurs;
ought the Americans to retain these faults which produce innumerable
inconveniencies in the acquisition and use of the language, or ought
they at once to reform these abuses, and introduce order and
regularity into the orthography of the AMERICAN TONGUE? Let us
consider this subject with some attention.
Several attempts were
formerly made in England to rectify the orthography of the language.
But I apprehend their schemes failed to success, rather on account
of their intrinsic difficulties, than on account of any necessary
impracticability of a reform. It was proposed, in most of these
schemes, not merely to throw out superfluous and silent letters, but
to introduce a number of new characters. Any attempt on such a plan
must undoubtedly prove unsuccessful. It is not to be expected that
an orthography, perfectly regular and simple, such as would be
formed by a "Synod of Grammarians on principles of science," will
ever be substituted for that confused mode of spelling which is now
established. But it is apprehended that great improvements may be
made, and an orthography almost regular, or such as shall obviate
most of the present difficulties which occur in learning our
language, may be introduced and established with little trouble and
opposition. |
[La question qui survient maintenant; les Américains doivent-ils
conserver ces fautes qui produisent des inconvénients innombrables
dans l'acquisition et l'usage de la langue ou doivent-ils
immédiatement réformer ces abus et présenter un ordre et une
régularité dans l'orthographe de la LANGUE AMÉRICAINE ? Laissez-nous
considérer cette question avec une certaine considération.
Plusieurs tentatives ont
autrefois été tentées en Angleterre pour rectifier l'orthographe de
la langue. Mais je me rends compte que ces projets ont échoué plutôt
en raison de leurs difficultés intrinsèques qu'à cause d'une
quelconque impraticabilité nécessaire à une réforme. Il a été
proposé, dans la plupart de ces projets, de ne pas rejeter
simplement les lettres superflues et muettes, mais de présenter
quelques nouveaux caractères. Toute tentative à un tel plan doit
sans aucun doute se révéler infructueux. Il ne doit pas être attendu
qu'une orthographe, parfaitement régulière et simple, qui serait
formée par un «synode de grammairiens selon des principes
scientifiques», soit parfois remplacée par ce mode confondu
d'orthographe maintenant établie. Mais nous pouvons croire que
d'importantes améliorations peuvent être apportées avec une
orthographe presque régulière, de telle sorte qu'on doive éviter la
plupart des difficultés présentes qui se produisent dans
l'apprentissage de notre langue et qui peuvent être introduites et
implantées avec peu de difficulté et d'opposition.] |
 |
Noah Webster, appelé le «père de la
scolarité américaine et de l'éducation» (en anglais: "Father of
American Scholarship and Education"), défendit l'existence d'une
orthographe de l'anglais spécifiquement américaine, comme pour mieux
se distinguer des usages britanniques. À nouveau pays, une nouvelle
langue! C'est à Webster que les Américains doivent color au
lieu de colour, ainsi que honor (honour), humor
(humour), theater (theatre), center (centre),
etc.
À cette époque, beaucoup de citoyens
américains insistaient pour que l’on adopte un type d’anglais qui
serait uniquement américain. Or, le lexicographe Noah Webster était
à la tête de ce mouvement et proposa de plusieurs nouvelles règles
pour l’orthographe américaine, dont sept demeurent encore en
vigueur. Bien que les innovations de Webster ne connurent pas toutes
le succès, elles furent révélatrices d'une tendance qui consistait à
orthographier les mots plus phonétiquement. |
C'est seulement en 1813 que l'ancien président
Thomas Jefferson
(1801-1809) fera appel à Noah Webster,
car il croyait que la jeune nation aurait besoin de beaucoup de nouveaux mots :
|
Certainly so great
growing a population, spread over such an extent of country,
with such a variety of climates, of productions, of arts, must enlarge
their language, to make it answer its purpose of expressing all ideas... The new circumstances under which we are placed call for new words, new
phrases, and for the transfer of old words to new objects. An American
dialect will therefore be formed. |
[Assurément, une si grande
croissance de la population, un diffusion sur une si grande étendue de
pays, avec autant de variétés de climats, de productions et d'œuvres
d'art, doivent donner une extension à la langue, afin de faire répondre à
son objectif d'exprimer toutes les idées... Les nouvelles circonstances
dans lesquelles nous sommes placés exigent de nouveaux mots, de nouvelles
expressions et des transferts de vieux mots pour de nouvelles réalités. Un
dialecte américain sera par conséquent façonné.] |
Mais le lexicographe qu'allait devenir Noah Webster
demeurait encore un inconnu pour les «Pères de la Constitution» et il n'exerçait
aucune influence sur eux. Webster croyait même que la «langue anglo-américaine» allait
devenir aussi différente par rapport à l'anglais du roi d'Angleterre que
l'étaient entre eux le néerlandais, le danois, le suédois et l'allemand.
Évidemment, ses prédictions ne se sont pas réalisées, car l'anglais d'Amérique
et l'anglais d'Angleterre, malgré leurs particularismes respectifs, sont demeurés la même
langue. Le nom de Webster est néanmoins devenu synonyme de «dictionnaire», au
même titre que Pierre Larousse, Émile Littré ou Paul Robert en français.
Quoi qu'il en soit, c'est bel et bien en anglais standard que fut rédigée la
Constitution américaine de 1787,
un geste symbolique qui, en principe, paraissait très suffisant pour symboliser la place de cette
langue dans le nouvel État. Il ne s'agissait certainement pas d'un «oubli» de la part
des législateurs, mais bien d'une volonté délibérée de ne pas intervenir
politiquement dans ce domaine. En fait, la plupart des hommes politiques américains,
sauf le pro-interventionniste John Adams, associaient
l'interventionnisme linguistique à une pratique monarchiste qui avait cours en
Europe. Pour eux, les académies sur la langue, comme il en existait en France et
en Espagne ou en Italie, étaient perçues comme trop royalistes. Par ailleurs,
on ne connaissait pas de pays, à l'exception de la seule Confédération suisse qui, à
l'époque, avait légiféré sur le statut des langues.
Le premier recensement officiel américain date de 1790. Il nous
révèle que 60,9 % des Américains étaient d'origine anglaise, 8,3 % d'origine
écossaise, 9,7 % d'origine irlandaise et 8,7 % d'origine allemande. On comptait
au moins 55 000 Américains ayant des origines françaises, surtout des huguenots;
comme les Français étaient très disséminés sur le territoire, ils n'ont jamais formé une
communauté homogène: ils se sont assimilés et se sont intégrés par affinité à
l'Église anglicane. Ainsi, la grande majorité des citoyens américains vient des îles Britanniques, ce
qui explique que la langue anglaise était forcément prédominante. Seulement 15 %
des familles de la Nouvelle-Angleterre avaient moins de trois enfants, et une
famille de dix ou quinze enfants ne constituait pas une exception. Dans ces
conditions, la langue anglaise était appelée à se propager rapidement.
3.4 Le gouvernement fédéral et l'Union
La raison pour laquelle les États-Unis ont imposé dans
leur pays l’usage du terme gouvernement fédéral est d'ordre historique. Les
États et les «Pères de la Constitution» ne pouvaient accepter ce terme qui
donnait l’impression que le véritable gouvernement des États-Unis était au
centre et que les États lui étaient soumis. En pratique, c’est ce qui est advenu
dans un grand nombre de domaines, mais ce fut davantage le résultat de l’Histoire, que
la
rigueur juridique, qui imposa le terme gouvernement fédéral plutôt que
gouvernement central. De plus, la Constitution fut un compromis entre
les intérêts esclavagistes du Sud et ceux des affairistes du Nord. Le Sud
avait accepté une certaine réglementation commerciale en échange de la promesse qu'on
autoriserait la poursuite du commerce d'esclaves pendant «encore vingt ans»
avant de songer à l'interdire. Les constituants croyaient que l'esclavage
s'éteindrait avec le temps. Leur optimisme allait être déjoué, car au contraire
il prospéra dans les décennies suivantes.
Ainsi, parce qu’elle avait enveloppé l’esclavage de
garanties juridiques presque impossibles à défaire, la Constitution allait
également favoriser la guerre de Sécession de 1861-1865.
Deux partis politiques se développèrent durant la présidence de
George Washington :
les fédéralistes et les républicains. Les fédéralistes, représentés par
George Washington et Alexander Hamilton, étaient favorables au renforcement du
pouvoir fédéral. Soutenus par les industriels et les milieux d’affaires du Nord,
ils restèrent au pouvoir jusqu’en 1801, avec John Adams (1797-1801), successeur
de Washington.
Les républicains, avec Thomas Jefferson et
James Madison à leur tête, hostiles
à toute ingérence excessive du pouvoir central, étaient favorables à une limitation
stricte des pouvoirs fédéraux. Les républicains étaient alors appelés
«démocrates» par leurs adversaires fédéralistes, ce qui signifiait avec un
certain mépris «ami de la populace». Les républicains reçurent le soutien des petits
propriétaires terriens du Sud et de l’Ouest.
Le Parti républicain accéda au pouvoir avec Thomas Jefferson (1801-1809) et s’y
maintint sous les présidences de
James Madison (1809-1817) et de
James Monroe
(1817-1825). Ce dernier, en affirmant son opposition à toute intervention
européenne dans les affaires du continent américain («doctrine de Monroe» en 1823),
définit les principes de la politique étrangère des États-Unis jusqu’au
XXe siècle. Dans les
faits, l'évolution politique des États-Unis s'est faite simultanément dans le
sens d'un accroissement considérable des pouvoirs de l'État fédéral et d'une
démocratisation accentuée de la vie politique. Quant à la langue anglaise, elle
s'est imposée dès le début de la création du nouveau pays.
Dernière mise à jour:
10 mars 2025
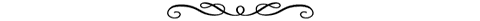
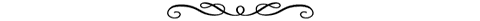
L'Amérique du Nord
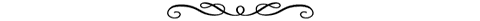
![]()