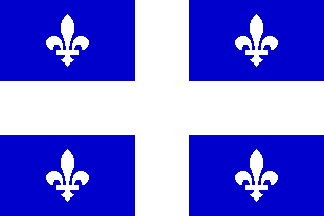 |
(4)
La modernisation du Québec
|
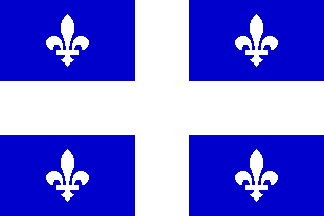 |
(4)
La modernisation du Québec
|
Plan de l'article
|
La modernisation du Québec constitue un phénomène
à la fois politique, économique, social, culturel et, comme
il se doit, linguistique. À partir de 1960, le Québec passa
du conservatisme clérico-politique et de l'immobilisme socioculturel
à l'ère du modernisme, du changement, de la revalorisation
politique, en fonction des intérêts économiques de
la nation. Ces changements n'avaient rien de révolutionnaire en
soi, mais ils permirent au Québec de rattraper son retard et de
prendre place au sein des sociétés industrialisées
et post-industrielles. L'État québécois mit ainsi
fin à une longue tradition de non-interventionnisme et devint, au
cours des deux décennies suivantes, le principal moteur du développement
collectif.
La langue française, quant à elle, se transforma en une arme de combat et en symbole de libération d'une société qui n'acceptait plus son statut de minorité plus ou moins aliénée. Cette nouvelle vision de la langue, passée du stade défensif au stade offensif, a engendré «l'époque des lois linguistiques», c'est-à-dire la loi 63 (Loi pour promouvoir la langue française au Québec, 1969), la loi 22 (Loi sur la langue officielle, 1974) et la loi 101 (Charte de la langue française, 1977). Du statut de langue nationale des Canadiens français, le français accéda au statut de langue étatique, aboutissement ultime d'un long processus de libération nationale.
En juillet 1965, le Parti libéral du Québec, dirigé alors par Jean Lesage, prit le pouvoir et entreprit la réalisation de son programme sous le thème «C'est le temps que ça change». Surnommé «le père de la Révolution tranquille», cet ancien député et ministre du Parti libéral du Canada voulut transformer les institutions et les mentalités québécoises au moyen d'un programme électoral qui allait bien au-delà de simples réformes économiques. C'est ainsi que commença la Révolution tranquille, une période exaltante de déblocage caractérisée notamment par l'avènement de l'État moderne et l'action socio-économique, l'affirmation de l'identité québécoise et la prise de conscience linguistique.
1.1 L'avènement de l'État moderne
 |
Avant d'aborder la question purement linguistique, il convient de rappeler les grandes lignes de force de cette période, lesquelles sont nécessaires pour comprendre la politique de la langue française que s'est donnée le Québec par la suite. Profitant d'une forte croissance économique, le gouvernement de Jean Lesage remodela profondément l'État québécois en investissant massivement dans des projets publics majeurs, notamment par la nationalisation des richesses naturelles et la création des sociétés d'État. Préoccupé par l'indépendance et la compétence de l'État québécois, Jean Lesage entreprit une vaste réforme de l'enseignement public dont l'apogée fut certainement la création du ministère de l'Éducation en 1964. La période Lesage vit également la création du ministère des Affaires culturelles, du ministère du Revenu et du ministère des Affaires fédérales-provinciales. De plus, la représentation du Québec à l'étranger fut développée, avec l'inauguration des Délégations générales du Québec à Paris en 1961 et à Londres en 1963. |
Le gouvernement réorganisa la fonction publique, qui vit grossir ses effectifs de 53 %, alors que le nombre des employés des secteurs parapublics (ou paragouvernementaux) s'accroissait de 93 %. L'État québécois put alors compter sur un corps de technocrates et de spécialistes pour effectuer l'entreprise de rattrapage.
Les priorités allèrent d'abord aux services sociaux et à l'éducation, lesquels se laïcisèrent au profit de l'État. Du côté des services sociaux, ce fut l'assurance-hospitalisation, le régime des rentes, l'aide sociale, le relèvement du salaire minimum, le nouveau régime d'assurance-chômage, etc. Du côté de l'éducation, ce fut la création du ministère de l'Éducation (1964) et l'institution des cégeps (1967), ce qui permit d'augmenter les effectifs scolaires de 101 % au secondaire, de 82 % au collégial et de 169 % à l'université.
L'État québécois intervint également dans l'économie. Pour stimuler la participation des francophones au développement économique, on créa des entreprises publiques telles que Hydro-Québec, la SGF (Société générale de financement), Sidbec-Dosco pour la sidérurgie, SOQUEM pour les mines, la Caisse de dépôt et de placement, etc. Ajoutons aussi la construction de l'infrastructure autoroutière et les grands projets hydro-électriques. Ces mesures témoignaient de la nouvelle conception capitaliste de l'État, devenu pourvoyeur de capitaux et créateur d'emplois pour les francophones.
Cet effort de modernisation accélérée exigea cependant de nouvelles sources de revenus. Après d'intenses négociations avec le gouvernement fédéral, le Québec obtint certains avantages fiscaux lui permettant de poursuivre ses objectifs sociaux et économiques.
1.2 L'affirmation de l'identité québécoise
L'affirmation de l'identité québécoise constitue l'un des traits caractéristiques de cette période. Les mots nation et Québec devinrent synonymes; les francophones de la province de Québec ne se définirent plus comme des Canadiens français, mais comme des Québécois. Secouant leur vieux complexe d'infériorité, ceux-ci passèrent du nationalisme défensif au nationalisme offensif et progressiste; ils devinrent ainsi conscients qu'ils pouvaient prendre en main leur propre destin. À l'instar de nombreuses autres minorités dans le monde, la fièvre autonomiste gagna le Québec, qui vit naître plusieurs mouvements indépendantistes dont le RIN (Rassemblement pour l'indépendance nationale), le RN (Ralliement national) et le MSA (Mouvement souveraineté-association) qui allait devenir le Parti québécois. Dans le même ordre d'idée, la province de Québec devint simplement le Québec. Les premiers ministres et ministres du gouvernement québécois utilisaient même l’expression l’État du Québec.
Parallèlement, le changement de nom de Canadiens français en Québécois eut pour effet d’entraîner de nouvelles dénominations aux autres Canadiens français – à l’exception des Acadiens – des provinces anglaises. Ainsi, apparurent les dénominations de Franco-Ontariens, de Franco-Manitobains, de Franco-Albertains, de Fransaskois, Franco-Colombiens, etc. Pour les Québécois, il s'agissait simplement des francophones hors-Québec. Vu sous cet angle, les francophones des autres provinces se trouvaient ainsi définis exclusivement par rapport au Québec.
Tout ce rattrapage institutionnel, économique, social et idéologique favorisa un essor sans précédent de la vie intellectuelle et de la production culturelle. Axés sur la spécificité québécoise, la chanson, la télévision, la littérature, le théâtre et le cinéma exprimèrent la nouvelle société urbaine et industrialisée, qui sortait d'une longue torpeur. Parallèlement, le Québec quitta son isolement et reprit contact avec la France: la Délégation générale du Québec à Paris, les ententes de coopération franco-québécoise, les visites officielles et les tapis rouges, etc. Cette politique d'ouverture sur le monde montrait que le Québec n'était pas seulement un État fédéré parmi les autres, mais se voulait aussi l'instrument politique d'un peuple distinct dans la grande Amérique du Nord.
1.3 La prise de conscience linguistique et la querelle du «joual»
Les événements de la Révolution tranquille projetèrent à l'avant-scène la question linguistique. Celle-ci cessa d'être une question de langue pour devenir à la fois une question idéologique, démographique, scolaire, économique et politique. Dans les faits, les gouvernements ne sont pas intervenus dans le domaine linguistique, mais toutes les idées-forces d'une politique de la langue sont apparues à ce moment et ont préparé «l'époque des lois linguistiques» qui allait suivre.
- Le purisme linguistique
La société québécoise traditionnelle avait pris du retard sur le reste du monde occidental et il lui fallait le rattraper. Au plan linguistique, cela s'est traduit par une recrudescence du purisme à l'égard du français, c'est-à-dire par un souci excessif de la pureté de la langue. Le français parlé au Québec paraissait tellement «arriéré», «dégradé» et «corrompu» par l'anglais qu'il était urgent de renouer le cordon ombilical avec la mère patrie (la France), seule force capable de faire échec à cette «contamination» endémique et de bloquer l'assimilation.
D'où le phénomène du
joual, dont
le célèbre Frère Untel se fit le champion en 1960 dans Les insolences du
Frère Untel. Le mot «joual» provient de la langue parlée populaire, alors
que «cheval» est prononcé «joual». Le dictionnaire Le Robert définit
ainsi «joual»:
Mot utilisé au Québec pour
désigner globalement les écarts (phonétiques, lexicaux, syntaxiques;
anglicismes) du français populaire canadien, soit pour les stigmatiser,
soit pour en faire un symbole d'identité (cf. Franco-canadien, québécois).
Des jouals. Parler joual
ou
JOUALISER
v. intr.
<conjug. : 1>.
Personne qui joualise
ou
JOUALISANT, ANTE
adj. et n.
— Adj.
JOUAL,
JOUALE
(parfois
inv. en genre)
« La langue jouale » (J.-P. Desbiens). « La grammaire
joual » (R. Ducharme).
Le joual était pour le Frère Untel une «décomposition» qu'il considérait comme le symbole de l'aliénation collective des Québécois: «Cette absence de langue qu'est le joual est un cas de notre inexistence, à nous, les Canadiens français.» On allait retrouver le même discours pendant plus d'une décennie, comme en fait foi cet éditorial paru dans La Presse (Montréal) en 1973:
Si l'on entend par là un mélange d'anglais et de français largement farci de jurons ou d'expressions ordurières... on ne peut hésiter un instant. Il faut l'empêcher de triompher, car il s'agit alors d'un jargon pour initiés, d'un dialecte tribal quelconque qui ne saurait prétendre véhiculer une réelle culture. C'est un langage plus près de l'animal que de l'homme.
Au début des années soixante, la conception dominante de la norme que se faisait la société à cette époque fut exposée dans l'une des premières publications de l'Office de la langue française intitulée Norme du français écrit et parlé au Québec. Il s'agissait d'une norme idéalisée qui n'admettait que peu de différences morphologiques, syntaxique et phonétique par rapport à la variété des classes instruites et bourgeoises de Paris:
L'Office estime que, pour résister aux pressions énormes qu'exerce sur le français du Québec le milieu nord-américain de langue anglaise, il est indispensable de s'appuyer sur le monde francophone: cela veut dire que l'usage doit s'aligner sur le français international, tout en faisant sa place à l'expression des réalités spécifiquement nord-américaines.
Dans le domaine du vocabulaire, l'Office de la langue française (aujourd'hui Office québécois de la langue française) n'admettait, toujours dans cette publication mentionnée, que les canadianismes «qui se rapportent à des réalités canadiennes pour lesquelles le français n'a pas d'équivalents» (maskinongé, sucre d'érable, banc de neige, ceinture fléchée, etc.), ou «les seuls anglicismes qui se justifient», c'est-à-dire «ceux qui comblent des lacunes».
- Le joual et le français «pouilleux»
 |
Cette conception de la norme «européanisante» ne pouvait faire l'unanimité à une époque centrée sur la québécité. D'autres croyaient au contraire à la légitimité d'une «langue québécoise». Au «joual-mépris», s'opposa le «joual-fierté» qui prenait ses racines dans la valorisation de la spécificité québécoise et exprimait à sa façon la contestation d'une société dépendante. Un courant littéraire important adopta même le joual comme instrument d'expression privilégié. Michel Tremblay, dramaturge et auteur des Belles-Soeurs (une pièce écrite en joual), justifiait ainsi sa position (dans La Presse, Montréal, 16 juin 1973) : |
On n'a plus besoin de défendre le joual, il se défend tout seul. Cela ne sert à rien de se battre ainsi. Laissons les détracteurs pour ce qu'ils sont: des complexés, des snob ou des colonisés culturels. Laissons-les brailler, leurs chiâlements n'empêcheront pas notre destin de s'accomplir. Le joual en tant que tel se porte à merveille; il est plus vivace que jamais... Quelqu'un qui a honte du joual, c'est quelqu'un qui a honte de ses origines, de sa race, qui a honte d'être québécois.
|
|
Enfin, un fait, apparemment anodin, mérite d’être
relevé. En 1968, le ministre fédéral de la Justice,
Pierre Elliot Trudeau (qui deviendra premier ministre du Canada), accusa
en anglais les Québécois de parler un Lousy French, c'est-à-dire un français
«pouilleux», ce qui a déclenché un tollé de protestations. Dans une allocution
prononcé le 28 janvier 1968, Trudeau précisa qu’il ne saurait être
question d’accorder des droits linguistiques à des gens qui parlaient
un si mauvais français.
|
Les Québécois furent profondément
choqués de cette accusation, surtout parce qu’elle liait leurs droits
linguistiques et politiques à la qualité de leur langue. Le linguiste
québécois Gilles-R. Lefèbre commentait ainsi l'attitude du Lousy French:
| Nous croyons pouvoir affirmer sans trop de risque d'erreur que l'attitude du Lousy French et le choix linguistique qu'elle entraîne recueillent la faveur d'une bonne partie de l'élite économique et politique des Canadiens français (fédéralistes), attitude qui se double assez paradoxalement d'une solide francophobie accompagnée d'une pratique du bilinguisme franco-anglais. Toutefois, il nous faut apporter ici des nuances quant au choix linguistique des tenants du Lousy French : il n'est pas assuré que tous soient capables ou même désireux d'aller jusqu'au bout de ce choix. |
La «crise» entre les tenants du français et ceux du joual a semblé prendre fin lorsque ces derniers ont fini par déposer les armes, mais elle témoignait éloquemment du sentiment d'aliénation collective propre à cette époque.
Il n’en demeure pas moins que cette controverse du joual ne semble jamais avoir été définitivement enterrée, parce que des ouvrages ont été publiés sur cette question jusqu’en 1996-1998, par exemple, les essais sur le langage québécois de l'auteur-compositeur-interprète Georges Dor, décédé en juillet 2001: (1996) Anna braillé ène shot (sous-titre: «Elle a beaucoup pleuré»), (1997) Ta mè tu là? (sous-titre: «Ta mère est-elle là?»), (1998) Les qui qui et les que que ou le français torturé à la télé (sous-titre: «Troisième et dernier essai sur le langage parlé des Québécois»). À coup sûr, tout francophone qui lit l'un de ces ouvrages y perd son latin! Cela étant dit, jamais un Québécois «normal» ne parlera comme un «Français»; rares sont les Québécois qui tiennent uniquement au «français de France» ou uniquement au joual. En général, on peut affirmer que la quasi-totalité des Québécois préconise cependant un «français québécois». Autrement dit, les Québécois francophones ont très largement perdu leur sentiment d'infériorité linguistique face au «français de France» et, pour la plupart, «bien parler» signifie parler un «français québécois correct».
1.4 L'évolution démographique des francophones
L'avenir démographique des francophones est une autre question qui souleva bien des inquiétudes au cours de la décennie 1960. Grâce à leur surfécondité (8,3 enfants par femme aux XVIIIe et XIXe siècles), les francophones avaient réussi à compenser le jeu des mouvements migratoires favorables aux anglophones; ils avaient ainsi toujours maintenu leur équilibre démographique, qui oscillait autour de 80 % au Québec. Or, le recensement de 1961 révéla que cet équilibre traditionnel se trouvait rompu avec la fin de la surnatalité des francophones. De plus, l'immigration canadienne favorisait une augmentation des anglophones dans une proportion de 23 % contre 1 % seulement en faveur des francophones.
Étant donné que l'immigration continuait de grossir le groupe anglophone au Québec, la question linguistique se présentait désormais sous un nouvel angle. En effet, quelque quinze ans plus tard, les démographes Charbonneau, Henripin et Légaré déclaraient qu'il était possible qu'en l'an 2000 le pourcentage de francophones puisse tomber à 71 % pour l'ensemble du Québec et à 53 % pour la région métropolitaine de Montréal. Montréal pourrait perdre ainsi sa majorité francophone!
En 1967, le Rapport du Comité interministériel sur l'enseignement des langues aux Néo-Canadiens révélait que «la communauté franco-québécoise n'avait pratiquement aucun pouvoir assimilateur» auprès des immigrants venant s'installer sur son territoire. Entre 1946 et 1966, le Québec avait accueilli environ 500 000 immigrants; de ce nombre, 50 000 étaient francophones. Or, les immigrants optaient dans une proportion de 90 % pour la langue dominante, l'anglais. Dans le rapport interministériel, on constatait également que les Néo-Québécois et les francophones constituaient environ 80 % des effectifs scolaires du secteur anglo-catholique de la CECM (à l’époque: la Commission des écoles catholiques de Montréal) et ceux du PSBGM (à l’époque: le Protestant School Board of the Greater Montreal). Les immigrants contribuaient ainsi à l'anglicisation du Québec et amorçaient même un processus de minorisation de la majorité francophone, d'après ce même rapport:
À moins d'attendre un hypothétique miracle, on doit bien convenir qu'une immigration nombreuse jouant à 90 % ou à 95 % en faveur de la minorité anglophone ne peut aboutir qu'à réduire constamment l'importance de la langue française au Québec et à amorcer un processus de «minorisation» de la communauté francophone au Québec.
Toute cette question relative au problème scolaire allait être à l'origine de la première loi linguistique votée à l'Assemblée nationale, en 1969. En attendant, la question alimentait les controverses et les revendications des francophones.
1.5 La domination socio-économique de l'anglais
La Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (Commission Laurendeau-Dunton), instituée par le gouvernement fédéral, publia un Rapport préliminaire en 1965, après avoir reçu au-delà de 400 mémoires; les autres tranches du rapport s'échelonnèrent jusqu'en 1970. Certaines révélations eurent l'effet d'une véritable douche froide sur les francophones. Tout le monde savait que l'anglais était la véritable langue du travail au Québec, de même que celle de la promotion sociale, du commerce, des affaires et de l'affichage: la Commission ne révéla rien de neuf à ce sujet. Mais on ignorait que:
- 83 % des administrateurs et cadres du Québec
étaient anglophones;
- les francophones du Québec avaient un revenu
moyen inférieur de 35 % à celui des anglophones;
- les francophones arrivaient au 12e
rang dans
l'échelle des revenus selon l'origine ethnique, avant les Italiens
et les Amérindiens;
- à instruction égale, les francophones
gagnaient moins que tous les autres groupes linguistiques;
- les anglophones unilingues gagnaient plus que les bilingues
anglophones ou francophones;
- même assimilé, un francophone ne réussissait
pas mieux;
- depuis 30 ans, la situation n'avait fait qu'empirer.
Ces faits étalés et révélés par une enquête fédérale furent considérés comme une véritable provocation chez les francophones, qui constataient que le Québec représentait, au point de vue du revenu, un «paradis» pour les anglophones. Même le bilinguisme tant exalté ne paraissait pas avoir une forte influence sur les revenus. La connaissance du français ne présentait aucun avantage économique pour les anglophones; la connaissance de l'anglais, pour un francophone, entraînait un très faible avantage financier, et celui-ci était dû au fait que les bilingues étaient plus instruits et exerçaient des professions mieux rémunérées.
Les termes bilinguisme et unilinguisme firent fureur au cours de la décennie 1960-1970. On considérait le bilinguisme pratiqué au Québec comme un suicide collectif parce qu'il était assumé par les seuls francophones et qu'il entraînait la contamination linguistique. La population revendiquait un «visage français» pour le Québec et certains n'hésitaient pas à parler d'unilinguisme, à exiger que le français devienne la langue du travail, de l'affichage, de la signalisation routière, des raisons sociales.
De plus en plus, l'idée d'adopter des mesures législatives à cet égard se répandait dans la population. Mais les politiciens de la Révolution tranquille n'osèrent pas intervenir, jugeant que la question était beaucoup trop explosive.
Dans les années soixante, les deux grandes communautés linguistiques, anglophones et francophones, n'étaient pas encore parvenus à s'entendre. Le Québec, de son côté, vivait une période d'effervescence — la Révolution tranquille —, qui en fut une de déblocage, caractérisée par l'avènement d'un État plus moderne et l'action socio-économique, l'affirmation de l'identité québécoise et la prise de conscience linguistique. Pour beaucoup de francophones du Québec, le nouveau nationalisme québécois rendait inacceptables plusieurs des pratiques du système politique canadien, par exemple, la sous-représentation des francophones et du français à Ottawa, ainsi que la non-reconnaissance des droits des francophones dans toutes les provinces anglaises. Au même moment, dans certaines provinces, les minorités francophones revendiquaient des changements substantiels autres que cosmétiques, notamment en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Ce vent de changement fut le déclencheur d'un processus chez les politiciens anglophones du Canada. Inquiet, le gouvernement fédéral de Lester B. Pearson savait qu'il lui fallait intervenir. Le système politique canadien devait être modifié afin de mieux refléter la dualité canadienne et la place centrale du Québec au sein du pays. Il fallait donc des changements majeurs dans la structure des institutions fédérales et une remise en question de la place du Québec dans le système fédéral. Il paraissait évident que le Canada devait mieux respecter ses minorités linguistiques francophones et qu'il lui fallait bien plus que des ajustements occasionnels pour assurer la paix sociale et permettre à tous ses citoyens de vivre en harmonie. Le pays était mûr pour un profond changement de cap, comme c'était d'ailleurs le cas dans plusieurs autres pays du monde. Ce fut l'avènement des droits linguistiques au Canada.
2.1 La Commission Laurendeau-Dunton
C'est l'arrivée au pouvoir du premier ministre canadien Lester B. Pearson (1963-1968), qui marqua la volonté de changement au gouvernement fédéral. Trois mois après son élection (avril 1963), le premier ministre canadien Lester B. Pearson créait une commission royale d’enquête dont le mandat était de faire le point sur le bilinguisme et le biculturalisme au Canada. Dans une lettre envoyée à tous les premiers ministres provinciaux en mai 1963, Lester B. Pearson écrivait ces propos:
| Dans un discours que je prononçais le 17 décembre 1962 à la Chambre des communes sur les difficultés et les avantages que présente dans notre pays la dualité de langue et de culture établie par la Confédération, je proposais la tenue d'une vaste enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme en consultation avec les gouvernements provinciaux. Cette proposition a été accueillie très favorablement au Parlement et aussi, je crois, dans le pays. |
L’idée d’une telle commission avait été lancée, l’année précédente, par le journaliste québécois André Laurendeau, rédacteur en chef du Devoir, très inquiété par la montée du discours sécessionniste au Québec et l’indifférence du Canada anglais. Le premier ministre Pearson fit appel à André Laurendeau pour diriger une vaste commission d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. À l'exemple de plusieurs commissions canadiennes, Pearson choisit également un coprésident de langue et de culture canadienne-anglaise : le journaliste Davidson Dunton. Ainsi, était créée la Commission Laurendeau-Dunton — aussi connue comme la «Commission BB» en français et «B and B Commission» en anglais (pour bilinguisme et biculturalisme). L'objectif fondamental du mandat de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme était le suivant:
|
Faire enquête et rapport sur l'état présent du bilinguisme et du biculturalisme au Canada et recommander les mesures à prendre pour que la Confédération canadienne se développe d'après le principe de l'égalité entre les deux peuples qui l'ont fondée, compte tenu de l'apport des autres groupes ethniques à l'enrichissement culturel du Canada, ainsi que les mesures à prendre pour sauvegarder cet apport. |
Entre 1964 et 1967, la Commission commanda au moins 165 études, dont 24 furent publiées. Plus de 400 mémoires furent présentés à la Commission, dont les travaux ont sensibilisé beaucoup de Canadiens à l'importance de préserver et de promouvoir tant la dualité que la diversité culturelle et linguistique. Cette intense activité scientifique a permis une meilleure connaissance de la réalité canadienne dans le domaine linguistique. En se basant sur des données démographiques, sociales, scolaires, économiques et juridiques liées à la langue et aux communautés minoritaires, le gouvernement canadien avait en mains ce qu'il fallait pour cerner certaines lacunes et agir en conséquence. Après deux ans de travaux et de rencontres à travers le pays, les commissaires étaient catégoriques sur les dangers que courait le pays:
|
Tout ce que nous avons vu et entendu nous a convaincus que le Canada traverse la période la plus critique de son histoire depuis la Confédération. Nous croyons qu'il y a crise […]. Nous ignorons si cette crise sera longue ou brève. Nous sommes toutefois convaincus qu'elle existe. Les signes de danger sont nombreux et sérieux. |
Si la crise persistait et continuait de s'accentuer, elle pouvait, selon les commissaires, conduire éventuellement à la destruction du Canada, mais si elle était surmontée elle contribuerait à la renaissance d'un Canada plus dynamique et plus riche. En avril 1966, le premier ministre Pearson annonça officiellement à la Chambre des communes une politique sur le bilinguisme dans la fonction publique:
|
Le gouvernement espère et compte que, dans une période de temps raisonnable, un état de choses se sera établi au sein de la fonction publique en vertu duquel: a) il sera de pratique courante que les communications orales ou écrites à l'intérieur de la fonction publique se fassent dans l'une ou l'autre langue officielle au choix de l'auteur [...]. b) les communications avec le public se feront normalement dans l'une ou l'autre langue officielle en égard au client. |
Le rapport de la Commission BB parut en 1967 et comptait quatre volumes (puis six en 1969), dont les plus importants portaient sur Les langues officielles (Livre I), L'éducation (Livre II), Le monde du travail (Livre III) et La capitale fédérale (Livre IV).
2.2 Les recommandations des commissaires
Le rapport de la Commission Laurendeau-Dunton recommandait que le Canada anglais accepte que des négociations soient entamées afin de recomposer le régime constitutionnel canadien de façon à ce que les francophones du pays puissent mieux s'épanouir. Pour les commissaires, les francophones constituent un groupe minoritaire au Canada, et ils sont surtout concentrés au Québec, ainsi qu'en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Il n'incombe pas à l'État fédéral de favoriser le bilinguisme individuel: «Si chacun devient complètement bilingue dans un pays bilingue, l'une des langues sera superflue.» Elle disparaîtra! Un État bilingue doit donc fournir des services aux citoyens dans leur langue et s'assurer que les membres des minorités linguistiques ne soient pas défavorisés pour des motifs linguistiques. Par conséquent, le groupe linguistique majoritaire doit «garantir la vie et l'égalité à la langue du groupe minoritaire».
Le Livre Ier du rapport abordait la question du statut des deux langues officielles. Les commissaires y faisaient une série de recommandations, dont la modification de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui débuterait par la disposition suivante: «L’anglais et le français sont les deux langues officielles du Canada.» La principale recommandation de la Commission était la suivante:
| Nous recommandons que l'anglais et le français soient formellement déclarés langues officielles du Parlement du Canada, des tribunaux fédéraux, du gouvernement fédéral et de l'administration fédérale. |
Les commissaires recommandaient également que le Nouveau-Brunswick et l’Ontario reconnaissent l’anglais et le français comme leurs langues officielles. La Commission recommandait que dans toutes les provinces soient créés des districts bilingues, ou dans les régions où un groupe linguistique, français ou anglais, atteindrait le seuil de 10 %. L'une des recommandations du livre premier prônait la création de postes de commissaire aux langues officielles dans les provinces qui se déclareraient bilingues.
Le Livre II de la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme traitait de la question de l’éducation. L'une des recommandations se lisait comme suit: «Nous recommandons que soit reconnu dans les systèmes scolaires le droit des parents canadiens de faire instruire leurs enfants dans la langue officielle de leur choix; l’application concrète de ce principe sera fonction de la concentration démographique de la minorité.» Le volumineux document était divisé en trois parties. La première concernait plus précisément l’instruction de la minorité linguistique, francophone ou anglophone, dans chacune des provinces. La seconde abordait l’enseignement d’une langue seconde, en l’occurrence le français ou l’anglais, alors que la troisième partie examinait l’image de l’autre groupe culturel véhiculée par l’enseignement, notamment sur l'enseignement de l'histoire au Canada. Cet enseignement de l’histoire semble comporter deux versions différentes. Dans les manuels de langue française, les commissaires remarquèrent que l'histoire accordaient une place prépondérante à la Nouvelle-France, la Conquête britannique y étant décrite comme une catastrophe. Dans les manuels anglophones, l’histoire semble commencer dans les années précédant la Conquête présentée non comme une fin mais comme un début où l’ère de l’Amérique du Nord britannique commence. D'autres recommandations concernent le fondement historique de l'appui fédéral à l'égard de l'enseignement dans la langue officielle de la minorité.
Certaines recommandations du Livre III (Le monde du travail) visaient l'équilibre linguistique au sein de la fonction publique fédérale. D'après la Commission, 21,5 % des fonctionnaires fédéraux étaient francophones en 1965. Des mesures devaient être prises pour favoriser une plus grande représentation francophone à tous les échelons de l'administration fédérale.
Dans le Livre IV, les commissaires faisaient des recommandations au sujet du bilinguisme de la capitale fédérale. L'objectif était de rendre la capitale fédérale (Ottawa) parfaitement bilingue.
Les commissaires demeuraient divisés sur les questions concernant les minorités linguistiques des provinces anglaise et la majorité francophone du Québec. Fallait-il répondre aux besoins spécifiques de cette majorité francophone et/ou aux besoins des minorités linguistiques? C'est le premier ministre Trudeau qui allait trancher en favorisant les minorités francophones du Canada anglais et la minorité anglophone du Québec. La majorité francophone du Québec n'avait pas besoin de protection. Pour le premier ministre Trudeau, seul un gouvernement fédéral bilingue, où l'anglais et le français seraient à égalité de statut, pouvait amener les francophones du Québec à accepter qu'il constituait le premier gouvernement au Canada.
2.3 Le bilinguisme officiel
La Commission BB fut mal perçue par les Anglo-Canadiens qui considéraient, d'une part, que le Québec constituait le problème, d'autre part, que les mesures en matière de langues officielles restaient l'affaire des minorités. La politique du bilinguisme officiel souleva de l'opposition dans certaines régions du pays, notamment dans l'Ouest; les Canadiens d'origine ukrainienne, allemande ou d'autres souches non anglophones ou non francophones voulaient savoir pourquoi le gouvernement fédéral accordait moins d'importance à leur culture qu'à celle des minorités francophones beaucoup plus faibles dans l'ouest du Canada. Entre-temps, la démission en 1968 du premier ministre Lester B. Pearson et l'avènement de son successeur Pierre Elliott Trudeau vinrent tempérer le projet de la commission sur le biculturalisme. Au début des années soixante-dix, Pierre Elliott Trudeau annonça à la Chambre des communes que son gouvernement allait adopter une «politique du multiculturalisme dans le cadre du bilinguisme». C'est que, pour faire accepter le bilinguisme officiel, le gouvernement Trudeau avait cru bon d'adopter également les recommandations de la Commission Laurendeau-Dunton visant à préserver les contributions d'autres groupes «ethniques» (à l'exclusion des peuples autochtones) à l'enrichissement culturel du Canada.
Cependant, il était clair pour les commissaires que la dualité linguistique ne pouvait se concrétiser au Canada que si la majorité acceptait son bien-fondé et y participait activement, les minorités ne pouvant l'imposer. La Commission Laurendeau-Dunton a constitué un tournant dans l'histoire du Canada, car elle a servi de guide en proposant des mesures concrètes. Depuis la publication du rapport de la Commission BB, le Canada a amorcé une réelle conversion vers le bilinguisme. L'une des mesures les plus importantes proposées par la Commission concernait l'adoption de la loi fédérale sur les langues officielles.
2.4 La Loi sur les langues officielles et les droits linguistiques individuels
Alors que Pierre Elliott Trudeau était premier ministre du Canada, la Chambre des communes adopta en 1969 la Loi sur les langues officielles. Cette loi fédérale conférait un statut co-officiel à l'anglais et au français, mais seulement dans le cas des organismes et institutions relevant de la juridiction fédérale. Cette loi constituait la première loi à caractère proprement linguistique adoptée par le Parlement fédéral. Mais, le Canada étant une fédération, la loi devait respecter la Constitution canadienne en ne modifiant pas les champs de juridiction entre les provinces et le gouvernement fédéral. Autrement dit, la loi ne pouvait pas intervenir dans les politiques linguistiques des provinces. Néanmoins, elle reléguait aux oubliettes le temps où le bilinguisme se limitait à quelques symboles (timbres, billets de banque, etc.) et à la traduction des lois et certains documents administratifs.
La législation fédérale accordait des droits personnels à tout citoyen canadien afin qu'il puisse communiquer dans la langue de son choix avec le gouvernement fédéral et faire instruire ses enfants dans sa langue maternelle si cette langue est l'une des deux langues officielles du Canada. La loi ne donnait pas de droits collectifs au sens où certaines législations l'entendaient, par exemple au Nouveau-Brunswick et au Québec, car il s'agissait de droits strictement individuels. Pour Pierre Elliot Trudeau, il n'était pas question d'accorder des droits collectifs aux francophones, ce qui aurait placé le Québec français au cœur de la politique linguistique canadienne. Or, en protégeant partout au Canada les droits linguistiques des francophones, le Québec restait «une province comme les autres». Pour Trudeau, le Québec ne devait plus être considéré comme le protecteur historique (depuis 1791 lors de la création du Bas-Canada et du Haut-Canada) du fait français au Canada, car le gouvernement canadien pouvait remplacer le Québec, et ce, dans tout le Canada. Le principe était le suivant: si tout le Canada, et non plus seulement le Québec, devenait la patrie du français, le nationalisme québécois n'avait plus sa raison d'être. Une fois que les droits linguistiques seraient insérés dans la Constitution canadienne, les conflits linguistiques au Canada seraient résolus.
Cependant, la plupart des Québécois n'étaient pas sans savoir que le français ne pouvait pas avoir au Canada anglais la force dont il bénéficiait au Québec. Dans l'Ouest canadien, les Ukrainiens et les Allemands, pour ne prendre que ces seules communautés, ne comprenaient pas pourquoi des francophones, en nombre encore plus limité qu'eux-mêmes, jouiraient de droits linguistiques particuliers. Pour leur part, les Canadiens anglais étaient prêts à appuyer toute loi qui favorisaient les droits de la personne, mais les droits linguistiques n'en faisaient manifestement pas partie. Enfin, le statut marginal du français dans les institutions fédérales et dans les provinces autres que le Québec n'avaient jamais préoccupé les Anglo-Canadiens. Bref, peu de Canadiens, autant francophones qu'anglophones, n'étaient prêts à entreprendre des croisades pour promouvoir le bilinguisme fédéral.
Devant le succès mitigé des mesures adoptées pour instaurer le bilinguisme dans la fonction publique, la Loi sur les langues officielles de 1969 sera abrogée en 1988 lors de l'adoption de la nouvelle Loi sur les langues officielles, alors que Brian Mulroney sera le premier ministre du Canada. Dans son rapport de 1990, le commissaire aux langues officielles du Canada déclarera: «Le français n'a toujours pas la place qui lui est due dans l'administration fédérale.» Dans son rapport de 1994, le commissaire devra encore déplorer le peu de progrès entrepris: «Les années passent, mais le dossier de la langue de travail dans l'administration fédérale reste au même point: c'est la langue au bois dormant.» Pendant qu'à Montréal les fonctionnaires travaillaient en français, à Ottawa ils travaillaient en anglais. En dépit d'énormes investissements dans la formation linguistique, les faits démontreront que le bilinguisme de la fonction publique restera un quasi-échec dans la politique linguistique. Par contre, si le bilinguisme sera un succès au Parlement, il le sera moins dans les services aux citoyens en Ontario et au Nouveau-Brunswick, de même dans certaines régions rurales du Québec, et dans la plupart des provinces anglaises de l'Ouest et des Maritimes.
Les efforts du gouvernement fédéral dans le domaine linguistique eut pour effet de renforcer le Québec dans son rôle historique de protéger la nation canadienne-française. L'«époque des lois linguistiques» au Québec commença avec la «crise de Saint-Léonard» en 1968. Conscients de l'adhésion massive des immigrants à la langue anglaise et du phénomène de dénatalité chez les francophones, les commissaires scolaires de la ville de Saint-Léonard (en banlieue de Montréal, aujourd'hui intégrée à Montréal) adoptèrent, le 27 juin 1968, une résolution rendant obligatoire l'inscription des nouveaux immigrants, c'est-à-dire les italophones, dans les écoles françaises de leur territoire.
La décision des commissaires de Saint-Léonard reçut immédiatement l'appui des milieux nationalistes, eux qui étaient déjà exaspérés par la domination socio-économique de la langue anglaise. Les commissaires venaient simplement combler un vide politique, mais, ce faisant, ils soulevaient un tollé de protestations chez les Anglo-Québécois qui, alimentés par leurs journaux, organisèrent un mouvement de boycottage et saisirent les tribunaux de l'affaire. Durant ces événements, l'Union nationale (qui dirigeait la province) perdit son chef, Daniel Johnson, qui mourut subitement; Jean-Jacques Bertrand devint premier ministre du Québec, tandis que Pierre-Elliot Trudeau prenait le pouvoir à Ottawa (Canada fédéral).
Le 20 novembre 1968, le nouveau premier ministre, Jean-Jacques Bertrand (Union nationale), déposa à l'Assemblée législative le projet de loi 90, abolissant le Conseil législatif. Il fut approuvé par une majorité de députés le 29 novembre, puis par le Conseil législatif, le 13 décembre. En vertu de cette loi, la législature de Québec devait être composée d'une seule Chambre, l'Assemblée législative (< "Legislative Assembly") qui prenait le nom de «Assemblée nationale». En même temps, l'orateur (<"speaker") devint le «président», l'orateur suppléant, le vice-président, et le greffier (<"clerk"), le «secrétaire général». L'abolition du Conseil législatif prit effet le 31 décembre 1968.
3.1 Le projet de loi 85 et la loi 63: un banc d'essai
Devant le climat social qui se détériorait, le premier ministre du Québec Jean-Jacques Bertrand fit préparer un projet de loi, le "bill 85", destiné à annuler la décision des commissaires de Saint-Léonard et à garantir aux immigrants le droit à un enseignement dans la langue de leur choix, c'est-à-dire en anglais dans les faits.
Ce projet de loi présenté le 5 décembre 1968 ne pouvait que susciter de vives réactions au sein de la majorité francophone. Devant le mécontentement populaire — 3000 manifestants à Québec protestent contre ce projet de loi et font voler en éclats quelques fenêtres du Parlement —, le ministre de l'Éducation (à l'époque, Jean-Guy Cardinal) profita de l'absence temporaire (pour des raisons de santé) de son chef pour renvoyer le projet de loi à une commission parlementaire. Ce n'était que partie remise pour lancer la véritable offensive du gouvernement: la loi 63 ou Loi pour promouvoir la langue française au Québec.
La rentrée de septembre 1969 s'effectua dans un climat d'affrontements violents entre les francophones et la «coalition anglophone» (incluant les italophones); cette violence conduisit même le gouvernement à adopter la Loi de l'émeute. C'est dans un contexte de passion et de violence que le Parlement adopta, le 20 novembre 1969, la loi 63 appelée presque paradoxalement Loi pour promouvoir la langue française au Québec.
Cette loi visait avant tout à annuler la décision du conseil scolaire (appelé commission scolaire au Québec) de Saint-Léonard et à accorder officiellement le libre choix de la langue d'enseignement aux immigrants. Elle obligeait également les écoles anglaises à assurer «une connaissance d'usage de la langue française aux enfants à qui l'enseignement est donné en langue anglaise».
Cédant à la pression de l'opinion publique anglophone, le gouvernement avait tenté ainsi un grand coup: satisfaire tout le monde en accordant aux parents le droit d'envoyer leurs enfants à l'école de leur choix. Cette loi reflétait encore l'attitude timorée d'un gouvernement qui désirait avant tout s'allier l'électorat anglophone; sans attendre les recommandations de la Commission Gendron chargée d'enquêter sur la situation linguistique, le gouvernement du Québec avait fait adopter une loi improvisée et sectorielle, c'est-à-dire limitée à la langue d'enseignement. Cette loi allait à contre-courant de l'évolution démographique et des transferts linguistiques réalisés au profit de la minorité anglophone. De plus, elle était calquée sur la politique du multiculturalisme prônée par le gouvernement fédéral et ramenait le Québec dix ans en arrière. C'est ce qui allait précipiter l'affaiblissement du régime de l'Union nationale.
Enfin, les anglophones ne se leurrèrent pas sur la portée électoraliste de la loi 63 (ou Loi pour promouvoir la langue française au Québec) à leur égard: ils avaient compris que, si un gouvernement québécois avait pu adopter une loi linguistique, même favorable à leur égard, un autre gouvernement pouvait en adopter une autre, cette fois-là plus ou moins défavorable. La loi 63 fut certainement la cause principale de la défaite du gouvernement de l'Union nationale aux élections de 1970.
3.2 La loi 22: une incitation à la refrancisation
L'arrivée de Robert Bourassa
à la tête du Parti libéral et du gouvernement québécois lors des élections
provinciales de 1970 suscita de grands espoirs en raison de ses objectifs axés
sur la relance de l'économie.
 |
Le gouvernement fut cependant vite secoué par la crise d'Octobre de 1970 provoquée par le Front de libération du Québec (FLQ), par l'échec de la conférence constitutionnelle de Victoria (1971) et par les nombreuses grèves du secteur public (1972). Robert Bourassa prêcha le «fédéralisme rentable» et la «souveraineté culturelle», mais il ne réussit pas à obtenir d'Ottawa des transferts de pouvoirs et de nouvelles ressources financières. - La charte de Victoria Dans la formule de modification proposée lors de la Conférence de Victoria, communément appelée «formule de Victoria», le gouvernement canadien avait accepté de restreindre son pouvoir quant à la nomination des juges, ainsi que le pouvoir du gouverneur général de désavouer une loi. Il offrait également un veto constitutionnel au Québec, ainsi qu'à l'Ontario et aux provinces de l'Atlantique. |
Or, depuis les années soixante, le Québec demandait un nouveau partage des pouvoirs pour obtenir plus d’autonomie et freiner ou arrêter la centralisation du pouvoir fédéral. Au contraire, l'État fédéral cherchait à étouffer les revendications en faveur de la décentralisation. Il a non seulement refusé toute asymétrie constitutionnelle dans la répartition et l’usage des compétences législatives, mais il a aussi rejeté tout renforcement, même partiel, des compétences du Québec et toute référence aux concepts de «nation» et de «peuple québécois».
Pour consentir à l'offre fédérale, le gouvernement de R. Bourassa aurait désiré une augmentation des pouvoirs du Québec en matière de santé, de services sociaux, de sécurité du revenu et de main-d'oeuvre. Le Québec répondit par la négative à la proposition fédérale, le 23 juin 1971, veille de la Saint-Jean-Baptiste (la fête nationale). Pressé par les milieux nationalistes qui exigeaient davantage pour le Québec que ce qui était prévu par cet accord, M. Bourassa reconnut avoir été dans une position difficile : «Victoria fut bien plus pénible que la crise d'Octobre. Je sentais l'étau qui se refermait sur le Québec. D'un côté, nous voulons rester dans le régime fédéral, nous voulons en profiter. Mais d'un autre côté nous voulons garder notre fierté, nous affirmer, avoir le maximum de pouvoirs.»
Au lendemain du NON de Bourassa, le Telegram de Toronto reprocha au premier ministre du Québec son manque de courage et de leadership pour avoir refusé de signer son arrêt de suicide en n'acceptant pas de se faire le champion de la charte de Victoria auprès de ses concitoyens. Au Star (Toronto), dont l'intransigeance s'était manifestée dès avant la conférence de Victoria, on manifesta la même réaction outragée : l'éditorialiste du Star affirmait que, s'il n'y a pas moyen de satisfaire le Québec avec une Canadien français comme premier ministre à Ottawa et un gouvernement «fédéraliste» à Québec, quand cela sera-t-il jamais possible? Le NON du premier ministre Bourassa mena peut-être le Canada à une impasse, mais ce serait oublier que la Saskatchewan et la Colombie-Britannique se préparaient également à réviser leur position. C'est le premier ministre du Québec qui porta l'odieux du NON. Pour sa part, le premier ministre canadien, Pierre Elliot Trudeau, estimait que l'accord de Victoria, rejeté par le gouvernement québécois, représentait la meilleure offre constitutionnelle que le Québec aurait jamais pu recevoir. C'est pourquoi il ne pardonna jamais à Bourassa sa volte-face et le traita un jour de «mangeur de hot dogs» et même de «fédéraliste douteux». On peut lire les dispositions linguistiques de la «Charte de Victoria» en cliquant ICI, s.v.p.
Reporté au pouvoir aux élections de 1973, le gouvernement Bourassa décida de s'attaquer enfin à la question linguistique. Il ne pouvait plus ignorer les revendications de la majorité francophone, qui le pressait d'agir: les résultats du recensement fédéral de 1971 sur la situation du français au Canada et au Québec avaient fait l'effet d'une bombe au sein de la population francophone, qui se voyait de plus en plus menacée de minorisation.
- La Commission Gendron
Grâce au rapport Gendron, publié en 1972, le gouvernement avait à sa disposition les éléments d'analyse et de réflexion nécessaires pour satisfaire la majorité et faire taire les milieux indépendantistes sans s'aliéner la minorité anglophone. Les 15 000 pages dactylographiées des travaux de la Commission ont été résumées dans un volumineux rapport de trois tomes: Livre premier, La langue de travail (379 pages); Livre deux, Les droits linguistiques (474 pages); Livre trois, Les groupes ethniques (570 pages). Les recherches effectuées par la Commission Gendron confirmaient ce que tout le monde savait déjà: la prépondérance de l'anglais dans les communications administratives et techniques des travailleurs, dans les communications verbales et dans les exigences linguistiques du marché du travail. Au terme d'une description très détaillée de la question, le rapport concluait ainsi:
Il ressort que si le français n'est pas en voie de disparition chez les francophones, ce n'est pas non plus la langue prédominante sur le marché du travail québécois. Le français n'apparaît utile qu'aux francophones. Au Québec même, c'est somme toute une langue marginale, puisque les non-francophones en ont fort peu besoin, et que bon nombre de francophones, dans les tâches importantes, utilisent autant, et parfois plus l'anglais que leur langue maternelle. Et cela, bien que les francophones, au Québec, soient fortement majoritaires, tant dans la main-d'œuvre que dans la population totale.
Le gouvernement tint compte d'un certain nombre de recommandations de la Commission Gendron relativement à l'usage du français dans l'administration publique, le monde du travail et celui de l'économie.
- La loi 22 ou Loi sur la langue officielle
Finalement, la Loi sur la langue officielle (loi 22) fut adoptée par le Parlement québécois en juillet 1974. La loi 22 constituait le premier effort véritable d'un gouvernement québécois en vue d'une intervention globale dans le domaine de la langue; et elle rendait le français seule langue officielle du Québec. Le nombre d'articles de cette loi 22 était imposant: 123 articles.
L'article 1 proclamait que «le français est la langue officielle du Québec». Les articles 6 à 17 traitaient de la «Langue de l'administration publique»; en principe, c'était en français, mais la loi prévoyait des mesures pour assurer l'usage de la langue anglaise. Les articles 18 à 23 étaient consacrés à la «Langue des entreprises d'utilité publique et des professions»; celles-ci devaient utiliser la langue officielle pour tous les documents destinés au public, mais pouvaient en plus employer une version anglaise. Selon les articles 24 à 29, le français constituait la langue de travail et les entreprises devaient adopter et appliquer des programmes de francisation si elles voulaient obtenir un certificat pour avoir le droit de recevoir de l'administration publique des subventions ou de conclure des contrats avec le gouvernement. Les articles 30 à 39 concernaient la «Langue des affaires», ce qui impliquait les raisons sociales, les contrats, l'étiquetage, les menus de restaurant, les panneaux-réclame et l'affichage public; toutefois, une version anglaise était possible en plus de la version française. L'enseignement était traité aux articles 40 à 44. Le français constituait la langue normale des établissements d'enseignement, mais des dispositions étaient prévues pour les enfants qui recevraient leur instruction en anglais, ainsi qu'aux autochtones (Indiens et Inuits). Le ministre de l'Éducation pouvait imposer des tests d'aptitude (art. 43) aux enfants qui désiraient recevoir leur instruction en anglais. D'autres articles concernaient la recherche en matière linguistique (art. 49-53), la Régie de la langue française (art. 54-77) et les commissaires-enquêteurs (art. 78-99). Les autres articles («Dispositions finales») avaient comme objectif de rendre plusieurs autres lois conformes à la Loi sur la langue officielle. Cette loi fut par la suite abrogée en 1977 lors de l'adoption de la Charte de la langue française (loi 101).
- Les réactions de la population
Les anglophones se livrèrent à un concert de protestations, conscients de perdre certains privilèges (comme l'affichage anglais unilingue), et réclamèrent le bilinguisme officiel. Pourtant, la loi demeurait encore fortement imprégnée du principe de la dualité linguistique prônée dans le contexte fédéral. Malgré l'affirmation du fait français, la loi reconnaissait officiellement à l'anglais la place qu'il avait toujours occupée.
Quant à la majorité francophone, elle se sentait lésée par les demi-mesures de la Loi sur la langue officielle (loi 22) à l'égard de la promotion du français. Par exemple, le gouvernement n'obligeait pas les enfants d'immigrants à fréquenter l'école française et reconnaissait le principe du libre choix de la langue d'enseignement; les seuls enfants d'immigrants dirigés vers l'école française étaient ceux qui ne réussissaient pas au test de compétence en anglais, c'est-à-dire les «cancres en anglais»; seuls les incapables étaient dirigés vers les écoles françaises. En apparence, le gouvernement ne semblait pas prendre parti pour les revendications des francophones. En ce qui concerne les dispositions relatives à l'usage du français dans le milieu de travail, celles-ci se trouvaient réduites à un simple système de certificats de francisation que devaient se procurer les entreprises désirant transiger avec le gouvernement québécois. De plus, les carences de la loi 22 en matière de sanctions laissèrent croire que le gouvernement demeurait inféodé aux entreprises privées et refusait de protéger réellement les intérêts de la majorité des travailleurs.
En fait, le gouvernement Bourassa refusait de se servir des pouvoirs
du gouvernement du Québec pour renforcer le fait français.
En ce sens, la
Loi sur la langue officielle
(loi 22) ne réglait rien: elle n'endiguait pas le processus
d'assimilation des francophones et des nouveaux immigrants à la
minorité anglophone; elle n'empêchait pas plus la prépondérance
socio-économique de l'anglais. Bref, comme la
Loi pour promouvoir la langue
française au Québec (loi 63), la
Loi sur la langue officielle
(loi 22) n'améliorait pas fondamentalement la situation du français
au Québec. Au contraire, ces lois ne firent qu'aggraver le
ressentiment et l'hostilité entre les groupes linguistiques. Comme la
défunte loi 63, cette autre loi
linguistique ne réussit qu'à mécontenter
tout le monde. On peut consulter le texte de la loi 22 (aujourd'hui
abrogée)
en cliquant ICI, s.v.p.
3.3 La loi 101: la promotion socio-économique du français
|
|
La victoire électorale du
Parti québécois, au soir du 15 novembre 1976, marqua
un tournant décisif dans la politique linguistique du Québec. Héritier des
réformes amorcées par la Révolution tranquille, le gouvernement de René Lévesque
poursuivit la politique de l'État interventionniste, non seulement dans le
domaine de la langue mais dans de nombreux autres secteurs: assainissement des
finances publiques, redressement de l'économie, financement des municipalités,
lutte contre le chômage, question énergétique, assurance-automobile, protection
du territoire agricole, etc. La première année de pouvoir du gouvernement fut complètement absorbée par la question linguistique. Le gouvernement élabora sa politique linguistique en fonction de son idéal de souveraineté, aboutissement logique de la dynamique nationaliste des années 1960. Cette fois-ci, le gouvernement savait qu'il pouvait compter sur l'appui majoritaire des francophones puisque ces derniers représentaient 54 % de sa base électorale; de plus, n'étant pas lié par l'électorat anglophone ni par l'élite économique, le gouvernement se sentait libre d'agir comme il l'entendait, du moins sur cette délicate question. |
L'objectif principal du premier gouvernement du Parti québécois fut d'affirmer la prédominance du français au Québec, d'en faire la langue commune pour tous, partout, pour tout; bref, de faire un Québec aussi français que l'Ontario était anglais. Dès lors, le français devait devenir plus qu'un moyen de communication: il devait correspondre à l'expression d'un milieu de vie pour tous les Québécois, c'est-à-dire être la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, du commerce et des affaires. Mais, pour y parvenir, il fallait l'équivalent d'une "thérapie de choc", qui permettait aux francophones de retrouver le sens de leur identité et ramènerait la communauté anglophone à ses proportions réelles. Cette thérapie collective fut la Charte de la langue française (ou loi 101).
La stratégie linguistique de cette loi reposait sur quatre principes généraux visant à corriger les problèmes qui traînaient en longueur depuis plusieurs décennies:
1) Endiguer le processus d'assimilation et de minorisation des francophones
C'est pour cette raison que la loi 101 a été conçue: fermer complètement, à l'avenir, l'accès des immigrants et des francophones à l'école anglaise. Avec la «clause Québec» – qui sera remplacée par la «clause Canada» –, on utilisait les frontières du Québec comme point de référence, adoptant ainsi une solution de type territorial, plus imperméable à l'intrusion de l'anglais provenant de l'extérieur.
Cette mesure trouvait sa justification dans la volonté ferme du gouvernement de montrer que la communauté première des francophones était le Québec, non le Canada. Une telle position aurait été impensable de la part des gouvernements précédents. On sait que, suite à une décision de la Cour suprême du Canada, la «clause Canada» viendra remplacer la «clause Québec».
2) Assurer la prédominance socio-économique du français
La simple justice sociale élémentaire commandait de remettre aux francophones les secteurs du travail, du commerce et des affaires, conformément à leur représentation linguistique au sein de la population québécoise; en somme, rien de très révolutionnaire. D'où le nombre impressionnant de mesures destinées à accorder aux francophones la prise du pouvoir économique, exercé jusqu'ici par les anglophones.
En partant du principe que tous les travailleurs avaient le droit d'exercer leurs activités en français au Québec (article 4 de la loi 101), le gouvernement obligeait toutes les entreprises de plus de 50 employés à détenir un certificat de francisation, à former un comité de francisation de l'entreprise (pour celle ayant 100 employés et plus) et à augmenter la présence des francophones à tous les plans (conseils d'administration, cadres, politiques d'embauchage, etc.).
La loi fixait aussi des conditions et des normes de francisation très poussées en matière de communications (internes et externes): on exigeait la maîtrise de la langue parlée et écrite en milieu de travail, le tout assorti de sanctions à l'égard des contrevenants. Enfin, la francisation supposait la généralisation du français dans la terminologie, dans les manuels, les catalogues, etc. Bref, des mesures normales appliquées dans la plupart des pays du monde.
3) Réaliser l'affirmation du fait français
Le législateur partait du postulat que le Québec est une nation dont plus de 80 % de la population parlait le français. Cette langue devait donc devenir la seule langue officielle de la nation et le principal facteur de cohésion nationale pour tous les Québécois. Cette nation québécoise était composée d'une majorité francophone et de plusieurs minorités de langue différentes: 10,9 % d'anglophones et 6,6 % d'allophones. C'est pourquoi la majorité devait obtenir plus de droits que les minorités.
Réaliser l'affirmation du fait français au Québec, c'était faire en sorte que le français plutôt que l'anglais devienne la langue commune de tous les Québécois lorsqu'ils ont à communiquer entre eux. C'est pourquoi il fallait que le Québec présente un visage français dans l'affichage, les raisons sociales et la publicité, surtout à Montréal, qui prétendait détenir le titre de «deuxième ville française du monde». Selon un ancien président du Conseil de la langue française, M. Michel Plourde:
Au Québec, c'est le français. Le français est la langue commune de tous les Québécois: francophones, anglophones et allophones. C'est la langue que tous les Québécois ont le droit de posséder, de savoir et d'utiliser. Voilà la règle fondamentale de notre aménagement linguistique: le français d'abord, pour tout le monde.
D'où le rejet du bilinguisme généralisé ou officiel dont l'expérience passée avait démontré qu'il constituait la plus grande menace à la vitalité de la langue française au Québec, parce qu'il entraînait la dégradation du français (traduction systématique, interférences linguistiques, emprunts massifs), favorisait l'unilinguisme des anglophones et assurait la suprématie de l'anglais dans tous les secteurs. Accorder le même statut à l'anglais et au français équivaudrait à redonner la dominance à l'anglais, car des droits égaux appliqués à des langues inégales (2 % de francophones en Amérique du Nord) ne produisent jamais des situations égalitaires.
Au contraire, il fallait que le Québec recoure au principe de l'inégalité compensatoire en vertu de laquelle le français doit avoir plus de droits que l'anglais pour contrebalancer la puissance de ce dernier en cette terre d'Amérique. Il ne paraissait pas possible de vouloir que le Québec affirme résolument son caractère français et favoriser en même temps le bilinguisme généralisé.
4) Les droits linguistiques des anglophones
Cependant, le rejet du bilinguisme officiel ne signifiait pas un unilinguisme aveugle et irréaliste dans le contexte nord-américain. La législation québécoise reconnut des droits à d'autres langues, droits reconnus selon le principe du statut juridique différencié. En raison de son caractère historique, on accorda des droits étendus à la communauté anglaise, qui conservait ainsi tous ses droits dans la législation, les tribunaux, l'enseignement (du primaire à l'université), les services sociaux et culturels. Non seulement les anglophones continuaient de bénéficier d'un réseau parallèle d'institutions qu'ils contrôlaient, mais l'anglais demeurait obligatoire comme langue seconde dans toutes les écoles françaises du Québec dès la quatrième année du primaire, et l'usage de l'anglais était admis chaque fois que la nécessité le justifiait (compétitions sportives, colloques et congrès, communications avec l'extérieur, etc.).
Par ailleurs, deux universitaires torontois, Kenneth McRoberts et Dale Posgate, n'hésitaient pas à déclarer que «la loi 101 constitue [...] l'exemple le plus frappant de la modération des réformes péquistes». De fait, selon les mêmes auteurs, un an après l'adoption de la loi, «l'attention des cadres anglophones était plutôt retenue par l'augmentation de l'impôt provincial sur les revenus élevés». Selon McRoberts et Posgate, l'impact d'une hausse des impôts serait «pire» que celui de la Charte de la langue française. D'ailleurs, le fait que les rédacteurs légistes aient eu à présenter au gouvernement pas moins de 14 versions différentes de cette loi démontre bien la prudence du législateur à intervenir dans ce domaine. Il faudra 2022 pour voir apparaître des transformations majeures à la Charte de la langue française (version de 2022).
Fait significatif, au cours de toute cette période, les Canadiens anglais des autres provinces ne manifestèrent aucune solidarité envers les anglophones du Québec; ils se contentèrent de jouer le rôle de spectateurs passifs, comme s'ils se résignaient à voir le Québec devenir aussi unilingue français que les provinces anglaises étaient unilingues anglaises. Au risque de paraître machiavélique, on pourrait affirmer que, en dernière analyse, cette sorte d'«arrangement symétrique» satisfaisait le plus grand nombre tout en en incommodant le moindre (McRoberts et Posgate).
![]()
De toute façon, cette intervention dans le domaine de la langue
paraissait nécessaire et légitime, car elle contribuait
à enrayer l'assimilation, à redonner le contrôle de
l'économie à la majorité, à lui faire retrouver
le sens de son identité et à lui rendre sa fierté
collective. C'est là une réaction que connaîtront, entre autres, les Catalans
de la Catalogne (en Espagne) à l'égard de leur langue et de leurs
institutions.
Dernière mise à jour:
05 mars, 2024
Histoire du français au Québec
(1) La Nouvelle-France
(1534-1760)
(2)
Le
régime britannique (1760-1840)
(3)
L'Union
et la Confédération (1840-1960)
(4)
La
modernisation du Québec (1960-1981)
(5)
Réorientations
et nouvelles stratégies (de 1982 à
aujourd'hui)
(6)
Bibliographie
générale
Histoire de la langue française