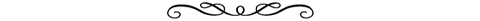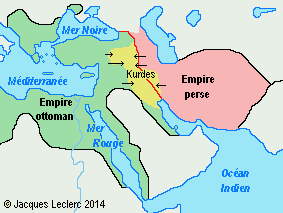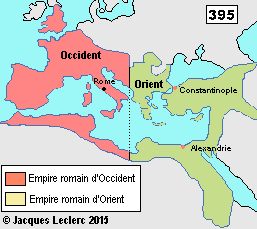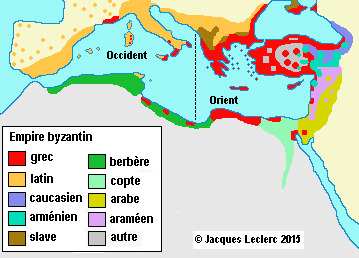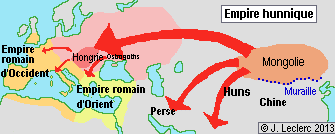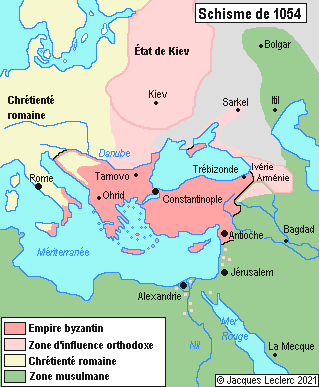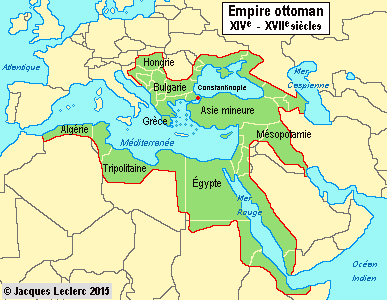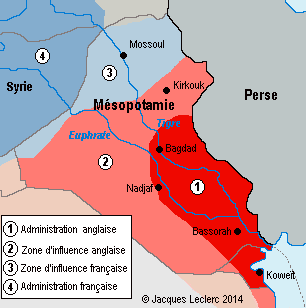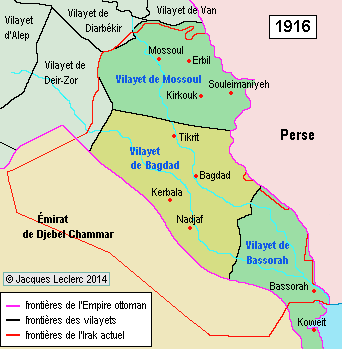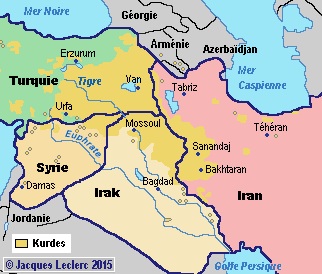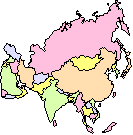La nouvelle graphie se voulait purement
phonétique, ce qui signifie qu'une lettre doit toujours correspondre à
un son. Il n'y aurait pas, comme en français ou en anglais, de
groupement de lettres, de consonnes ou de voyelles, chacune des lettres
devant représenter un seul son. Il en résulte que la différence entre
l’écrit et l’oral est minime en turc, puisque la langue écrite reflète
la langue parlée. Au final, par comparaison avec des langues comme le
français ou l'anglais, l'alphabet turco-latin est reconnu comme l’un des
plus parfaits parmi les systèmes d’écriture actuels.
5.4 Mustafa comme instituteur en chef
|
 |
La loi entrait immédiatement en vigueur dans toutes les écoles; elle
prévoyait une conversion de l'alphabet en quatre temps, étalée sur une
période de dix-neuf mois.
Le 1er
décembre 1928, les journaux, les revues, les affiches,
les enseignes, les cinémas, etc., devaient utiliser le nouvel alphabet. Á partir
du ler
janvier 1929, il devenait interdit
d'utiliser l'ancien alphabet dans les publications et la correspondance
officielles. Devaient suivre non seulement la correspondance dans toute
l'administration publique, mais aussi dans les banques, les sociétés commerciales, les
livres, etc. Enfin, au 1er juin 1929,
il ne restait plus que les actes de l'état civil, les documents du cadastre
et... autres babioles.
En quelques jours, les inscriptions arabes disparurent
des rues, alors que les journaux emboîtèrent le pas presque aussitôt. En
deux mois, la Turquie avait fait peau neuve et l'écriture arabe appartenait déjà
au passé.
Pendant ce temps, avec une craie et un tableau portatif, Mustafa Kemal,
promu Başmuallim, c'est-à-dire «instituteur en chef»,
parcourait le pays, même dans les villages les plus reculés,en donnant lui-même des leçons d'écriture de
l'alphabet latin moderne dans les écoles, les places publiques, etc.
Cette campagne menée rondement connut un immense succès et accentua la
notoriété de Mustafa Kemal.
L'ancien alphabet disparut d'autant plus vite que l'enseignement de
l'arabe et du persan dans les écoles fut tout simplement interdit. En
effet, la Loi sur l'adoption et l'implantation de
l'alphabet turc du 1er novembre 1928, qui
prohibait l’usage public des caractères arabes, réduisit au silence les
défenseurs de l’alphabet arabe. Voici
quelques extraits de cette loi du 1er novembre 1928:
|
|
Article 1er
Les lettres (lettres turques) prises
de l'alphabet latin, désignées dans leurs formes ci-jointes au lieu
des lettres arabes pour écrire le turc sont adoptées avec leur titre et
règles.
Article 2
Tous les établissements,
toutes les
sociétés, les institutions sociales et privées sont tenus d'adopter
et d'appliquer à l'écrit les lettres turques lors de la date de la
promulgation.
Article 3
La date d'application pour les
lettres turques au sein du gouvernement ne doit pas dépasser le 1er
février 1929. Il est autorisé dans les correspondances, la presse d'enquête,
les registres, les jugements, les formulaires et le livres, sous
réserve du début du mois de juin 1929.
Les documents du cadastre, les actes
de propriété, les cartes d'identité, les actes de mariage, les cartes
d'identité militaires et les documents commerciaux doivent être
rédigés en lettres turques au début du mois de juin 1929.
|
On peut consulter
l'alphabet turc, tel qu'il se présente aujourd'hui,
en cliquant
ICI
 |
En 1929, après l'adoption de l'alphabet
latin, la suppression de l'enseignement des langues et littératures
arabes et persanes devait couper le dernier lien avec le passé, et
ce, d'autant plus qu'une réforme similaire en Azerbaïdjan montrait
l'exemple.
La photo ci-contre, prise à Istanbul en
décembre 1928, montre un commerce de fournitures
scolaires exposant le nouvel alphabet. Le nom du magasin,
Mekhtebliler Pazari, est bien transcrit en alphabet latin, mais le
propriétaire n'a pas encore eu le temps d’enlever l’ancienne
enseigne au haut de son commerce, celui-ci étant encore en alphabet
arabo-persan.
Il faut se rendre compte qu'il s'agit là d'une
prouesse inimaginable dans l'Histoire. La Turquie a bel et bien
remplacé une écriture en usage depuis plus de 1000 ans par une autre
en quelques mois seulement. Il faut dire que la méthode forte de
Mustafa Kemal avait fait ses preuves.
Par la suite, d'autres peuples turcs emboîtèrent
le pas à la Turquie. En Azerbaïdjan, un comité central fut même formé en 1926 à Bakou
afin d'unifier les différents alphabets à base de
latin utilisés par les autres turcophones. Un nouvel «alphabet
unifié» fut proposé et accepté par les Azéris (Azerbaïdjan), les Ouzbeks
(Ouzbékistan) et les
Turkmènes (Turkménistan) au cours de la décennie de 1930. |
5.5
La clé de la civilisation universelle
Mustafa Kemal, pour qui la réforme linguistique
était devenue une affaire personnelle, avait déclaré la guerre à ceux qui s'opposeraient à
son projet:
|
Tous ceux qui tenteront de se
mettre en travers de mon chemin seront impitoyablement écrasés. Mes
compagnons et moi, nous sacrifierons, s'il le faut, notre vie pour le
triomphe de notre cause. |
Afin de colmater les effets trop coercitifs de la
réforme, le nouvel alphabet fut présenté comme la clé de la
«civilisation universelle» et l’instrument même du «savoir pur», ce qui allait
permettre d'ouvrir la voie à un «monde de lumière» (nûr âlemi). Suite logique des mesures
prises, il devint obligatoire de lire le Coran en turc et non plus en arabe
classique, ce qui équivalait sans doute pour un musulman orthodoxe à une
véritable hérésie.
Entre le 8 et le 25 octobre 1928, tous les fonctionnaires du
pays durent subir un examen dont la réussite était conditionnelle à la
poursuite de leur carrière. De cette façon, la réforme de l’alphabet permettait
au gouvernement une purge administrative contre les employés dont le
comportement était non conforme aux
«intérêts de la nation». La nouvelle écriture allait favoriser la fidélisation des
employés de l’État aux normes en vigueur, aux pratiques disciplinaires et
surtout à Mustafa Kemal.
5.6 Les « Écoles de la nation »
 |
Mustafa Kemal créa des «Écoles de la nation»
(en turc: "Ulus Okullar") destinées à
l'alphabétisation des adultes sous la gouverne du ministère de l’Instruction
publique. Ces écoles apparurent dès la fin de 1928, bien que leur inauguration
officielle ait eu lieu le 1er janvier 1929. Elles
furent installées dans les édifices administratifs, les écoles primaires, les
usines, les hôpitaux, les mosquées, les cafés et les salles communales.
|
Un règlement daté du 11 novembre 1929 précisait que tous les
citoyens âgés de 16 à 30 ans, qui ne connaissaient pas le nouvel alphabet, étaient
tenus de s’inscrire dans les «Écoles de la nation». Des instituteurs ambulants,
équipés d’un tableau noir portatif, de craie, de papier et de crayons noirs,
circulèrent d'un village à l'autre pour donner des cours sur le nouvel
alphabet dans les «écoles» improvisées.
En 1930, un nouveau règlement sur les «Écoles de la nation»
(voir
Birol CAYMAZ Emmanuel SZUREK) énonçait que, à partir du mois de mai 1931, les citoyens qui ne savaient ni lire
ni écrire avec le nouvel alphabet ne pourraient plus siéger aux conseils des
villages et des villes. Officiellement, l’objectif consistait à faire acquérir
aux Turcs les connaissances minimales que tout citoyen devait posséder en
matière de ses droits, mais surtout de ses devoirs nationaux.
Entre 1928 et 1935, plus de deux millions et demi
d’adultes furent alphabétisés dans les «Écoles de la nation». Toutefois, ce ne
sont pas tous les adultes qui réussirent aux examens, seulement la moitié ayant
pu satisfaire aux exigences demandées. En 1930, le directeur général
de l'enseignement primaire, Ragıp Nurettin, faisait le constat suivant à
l'occasion
d'une conférence des inspecteurs de l'Instruction publique tenue à Ankara:
|
Le peuple, à peine a-t-il su lire un
extrait, se dispense d’assiduité. Ou alors il quitte l’école au bout d’un
certain temps. La vraie raison en est, hélas, que les autorités
administratives ne font pas leur travail comme elles le devraient et que
les sanctions financières ne sont pas exécutées comme il le faudrait. (voir
Birol
CAYMAZ Emmanuel SZUREK) |
C'est que les préfets étaient les véritables responsables
de l'alphabétisation des masses, non pas les instituteurs ni les inspecteurs du
ministère de l'Instruction publique. Or, les préfets furent vite débordés et ne
suffirent plus à la tâche. Entre 1928 et 1935, les «Écoles de la nation» connurent
un rapide déclin; elles finirent par disparaître à la fin des années 1930 en
étant parvenues à alphabétiser plus de 20 % de la population. Il faut comprendre
que, à la veille de l’adoption de l'alphabet latin (1928), la Turquie comptait 13,6
millions d’habitants, dont 1,5 million étaient déjà alphabétisés, ce
qui représentait 10,6 % de la population du pays.
À la mort d’Atatürk (1938), quelque 80 % de la population demeurait encore
analphabète, soit 17 millions de personnes. En particulier, neuf femmes sur dix ne
pouvaient ni lire ni écrire. Dans les années ultérieures, ce taux
d'analphabétisme allait baisser à 30 % en 1980 et à 19 % en 1995.
5.7 La prononciation istanbuliote
Dans les faits, ce changement radical de l'alphabet n'eut
pas le même impact pour tous les Turcs. D'abord, les lettrés constituaient une
minorité, presque une exception. Par ailleurs, les nombreuses minorités non
musulmanes du pays étaient habituées à pratiquer depuis toujours plusieurs
alphabets (latin, grec, cyrillique, arabe), de même que beaucoup d'intellectuels
et de grands commerçants. Bref, le faible niveau de connaissances de l'écriture
chez la grande majorité des Turcs a favorisé le changement de l'alphabet.
Enfin, l'alphabet adopté a eu pour effet de privilégier
la prononciation istanbuliote (celle d'Istanbul) aux dépens des prononciations locales
des mots ottomans. Les modifications de l'orthographe permirent au gouvernement
de Mustafa Kemal d'imposer dans tout le pays les nouvelles normes phonétiques
d’une langue dont la graphie arabe favorisait des prononciations variables.
C'est ainsi que la romanisation de l'alphabet devint un puissant instrument pour
construire la nouvelle nation turque.
Dès lors, le nouvel alphabet
était devenu beaucoup plus qu'un changement de lettres, c'était aussi une
profonde réforme sociale destinée à assurer une domination culturelle de la part
d'une petite élite installée au pouvoir. C’était aussi la liquidation de
l'Empire ottoman et de la domination du Coran; c'était également un moyen de faire
pénétrer l'administration du nouveau régime républicain dans toutes les zones
rurales, de sorte que les notables des régions les plus reculées durent apprendre
à se conformer à la nouvelle bureaucratie kémaliste.
5.8 L'épuration du vocabulaire
La révolution linguistique (Dil Devrimi) devait être
complétée par une réforme du vocabulaire. Après la réforme de l'alphabet,
c'était le tour du lexique et de son histoire. Parallèlement, Mustafa Kemal
allait procéder à une grande
épuration des tournures arabo-persanes et surtout du lexique envahi par les mots
arabes et persans. Pour lui et ses réformateurs linguistiques, les mots autres
que
turcs furent considérés comme des «vestiges d'un passé révolu».
Dans cet esprit, Mustafa Kemal fonda, le 15 avril 1932, la
Société historique turque ("Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti"), devenue plus tard la
"Türk Tarih Kurumu", dont le mission fut de retrouver les racines de l'histoire
turque. Le 12 juillet de la même année, Kemal Atatürk fonda la Société pour
l'étude de la langue turque ("Türk Dili Tetkik Cemiyeti"), qui deviendra la
"Türk Dil Kurumu", avec une mission similaire. L'objectif de la nouvelle société
était de «dégager la beauté et la richesse propres de la langue turque, et de
l'élever parmi les langues mondiales, à un niveau digne de sa valeur» (Nicolas
Vatin). Six équipes de travail furent constituées : (1) linguistique et
philologie; (2) étymologie; (3) grammaire et syntaxe; (4) vocabulaire et
terminologie; (5) recherche des mots; (6) publications.
- Les mots turcs
La Société
pour l'étude de la
langue turque (Türk Dil Kurumu) surveilla étroitement le
travail des lexicographes. La «révolution linguistique» devait comprendre
l'élaboration d'un dictionnaire avec des mots turcs ou entièrement turquisés. Il s'agissait de remplacer le vocabulaire
arabo-persan par un vocabulaire d'origine turque, d'une part (prioritairement),
d'intégrer des mots provenant des langues occidentales, d'autre part. Le
processus s'étira sur plusieurs années, soit de 1928 à 1935. Toute la Turquie se
mit au travail. Un décret adopté en novembre 1932 ordonna aux fonctionnaires de
faire la collecte des mots de la langue parlée non recensés par les
dictionnaires. Des comités locaux eurent la tâche de prévoir des «cellules»
à installer dans chaque école. Les instituteurs et les professeurs devinrent des
«collecteurs» et durent remplir des fiches indiquant la signification, les
synonymes, les antonymes et les «utilisateurs des mots». La réforme mise en
place
reposait sur les trois principes majeurs suivants :
1) La langue turque était suffisamment riche pour exprimer
tous les messages;
2) La langue devait être expurgée de tous les mots étrangers;
3) Tout matériel turcique («turkic»), y compris les langues mortes, les dialectes et
les suffixes improductifs, était considéré recevable comme source de
nouveaux mots.
Les membres de la Société
pour l'étude de la langue turque se mirent à collecter des mots aux sources
dialectales et dans les œuvres littéraires anciennes; la Société fit publier
dans les journaux à partir de 1935 des listes de mots de substitution pour les
emprunts étrangers.
L'année précédente, le
Parlement avait adopté une loi obligeant les citoyens à prendre un nom d'origine
turque: c'est alors que Mustafa Kemal, afin de donner l'exemple, prit le
patronyme d'Atatürk, le «Père des Turcs». Le mot
ottoman fut banni
du vocabulaire officiel et il fut remplacé par le mot turc jusqu'alors
péjoré et synonyme de «paysan».
Pour ce qui est du recours aux mots turcs, il fallut
considérer le «fonds lexical des langues appartenant à la famille altaïque»:
le turkmène, l'ouzbek, l'ouïgour, l'azéri, le kazakh, le kirghiz, le tatar, etc. Le résultat de
cet énorme travail lexicologique fut publié en 1934 dans un recueil des formes
lexicales d'origine arabe ou persane avec leur équivalent turc, suivi d'une
liste alphabétique de ces mots turcs. Le turcologue Louis Bazin résume ainsi ces
modifications:
1) Suppression de mots anciens
arabo-persans sortis de l'usage; p. ex., le mot persan sehir
(«ville») remplacé par le mot azerbaïdjanais känd («village») utilisé
sous la forme kent).
2) Création de néologismes par dérivation de mots turcs;
p. ex., pour remplacer le mot arabe tahkîk («enquête»), on construisit
sorusturma sur la racine sor- («questionner») dont dérivèrent
successivement sorus- («s'entre-questionner») et sorustur
(«enquêter»).
3) Création de néologismes par composition;
p. ex., le mot réfrigérateur a été formé de buzdolabi d'après
buz («glace») et dolap («armoire»).
4) Emprunts aux langues
occidentales.
Beaucoup de
mots ont été empruntés à l’allemand (qui a inspiré l’alphabet turc), au français
(plusieurs centaines), à l’italien et à l’anglais. En voici quelques exemples:
frisör (coiffeur), restoran, omlet,
garson, apartιman, lavabo, factura, pantolon, telefon,
televizyon, tirbuşon (tire-bouchon), sendika (syndicat),
gişe (guichet), bilet (billet), traktör, otel (hôtel),
endüstri, makine (machine), baraj (barrage), büro,
polis (police), doktor, üniversite, radar, etc.
Afin de familiariser le public, Atatürk fit ses discours
en "öztürkçe", c'est-à-dire selon un emploi du turc faisant une large part aux
néologismes fondés sur des racines turques plutôt qu'arabo-persanes.
- Les mots étrangers
Bien que les «puristes» et les «fanatiques» aient favorisé la
suppression complète de tous les mots non turcs, beaucoup de fonctionnaires ont
compris que certaines des modifications suggérées tournaient au ridicule. Au début,
cette réforme avait suscité un véritable enthousiasme, mais l'engouement fut de
courte durée, car les difficultés apparurent rapidement. Les mots nouveaux
n'étaient souvent adoptés que partiellement, leur sens paraissant souvent mal
défini. Il en résulta une sorte de langue artificielle, intelligible seulement
pour un petit cercle d'initiés. Les puristes se rendirent compte que la décision
de
remplacer les mots courants d'origine étrangère par des néologismes se révélait
très peu fonctionnelle. Finalement, ils entreprirent de doter ces mots «irremplaçables»
par des étymologies inventées, qui prouvaient leurs origines turques et
justifiaient leur conservation. Mustafa
Kemal avait lui-même prononcé de nombreux discours inintelligibles en «langue
nouvelle» (en "öztürkçe") en 1934, mais en 1935 il se résolut à revenir à un usage plus
traditionnel.
Afet Inan (1908-1985), l'une des filles adoptives de Mustafa Kemal Atatürk,
avait été l'instigatrice de
cette nouvelle historiographie. Si un
équivalent approprié ne pouvait être trouvé en turc, le mot étranger pourrait
être conservé sans violer «la pureté» de la langue turque. C'est ainsi que s'est constitué ce qu'on a alors appelé
l'öztürkçe, c'est-à-dire le «turc
purifié».
Puis les dénominations étrangères furent remplacées par
des appellations turques. Par exemple, Andrinople devint Edirne; Alexandrette,
Iskanderun; Trébizonde, Trabzon; etc. Il fut aussi
décrété que tous les Turcs devaient adopter un nom de famille d'origine turque.
C'est ainsi qu'en 1934 la Grande Assemblée attribua à Mustafa Kemal le nom
d'Atatürk (le «père des Turcs»). Plus tard, en 1934, Atatürk supprima tous les
titres tels que pacha, dey, effendi ou agha par
bey («monsieur») et bayan («madame»). Cette-années-là, Atatürk fit
adopter la
Loi
sur les colonies qui créait à l'article 2 trois zones de peuplement:
|
Zones numéro 1 : Ce sont des
endroits où l’on souhaite réunir la population de culture
turque. Zones numéro 2 :
Ce sont les lieux réservés au transfert et à l'installation de
la population souhaitée pour représenter la culture turque.
Zones numéro 3 : Il s'agit de
lieux dont l'évacuation est demandée et où l'établissement et le
séjour sont interdits pour des raisons de localisation, de
santé, d'économie, de culture, de politique, de service
militaire et de police. |
Seuls les immigrants et les réfugiés
«de race turque» étaient autorisés à s'installer dans les zones 1 et 2:
étaient exclus ceux qui ne sont pas associée à la culture turque, les
anarchistes, les espions, les gitans nomades, ceux qui ont été expulsés
de leur pays et les personnes atteintes de maladies infectieuses (art.
4). C'est l'article 11 de la la
Loi sur les colonies qui semble le plus explicite pour la langue
turque:
|
Article 11
A)
Il est
illégal de recréer des villages,
des quartiers, des groupes d'ouvriers et d'artistes
parmi des
personnes dont la langue maternelle n'est pas le turc,
ou de confiner un village, un quartier, un travail ou un art
à leurs propres compatriotes.
B) Le ministère de l'Intérieur est tenu de prendre
les mesures nécessaires, par décision du Conseil exécutif,
pour des raisons civiles, militaires, politiques, sociales
et disciplinaires, à l'égard de ceux qui ne sont pas
identifiés à la culture turque ou de ceux qui sont associés
à la culture turque,
mais parlent une autre langue que le turc.
Le transfert vers d’autres lieux et la privation de la
citoyenneté, à la condition qu’il ne s’agisse pas d’une
mesure globale, sont également inclus dans ces mesures.
|
Atatürk voulait créer ainsi une Turquie
linguistiquement homogène.
 |
De plus, il encouragea les arts,
ce qui se traduisit par une multitude de monuments et de statues d'Atatürk
érigés sur les places publiques des grandes villes. Plus de 85 ans après sa
mort, le fondateur de la Turquie moderne continue d’être honoré
par d’innombrables statues. Une manière pour l’armée de
préserver son rôle, car elle sont destinées à sacraliser l’homme
qu’elles représentent.
Enfin, toutes les écoles
religieuses furent fermées, y compris les écoles coraniques et chrétiennes, pour
être remplacées par des écoles laïques. En 1923, la capitale, Istanbul, fut
transférée à Ankara parce qu'elle rappelait trop le passé ottoman. Ankara
devenait ainsi le symbole de la Turquie moderne. En 1935, le dimanche remplaça
le vendredi comme jour férié. La politique de purification linguistique
allait connaître son apogée avec la traduction de la Constitution de 1924 en
öztürkçe, parue en 1945. |
5.9 Les retombées
négatives pour les Kurdes
Les Kurdes avaient été les premières victimes de cette
politique nationaliste. Dès le 3 mars 1924, la langue kurde fut interdite dans
les écoles, les associations et les publications. Les Kurdes durent se faire
attribuer des noms de famille tels que Türk, Öztürk, Türkoglu,
etc., afin de les rattacher à la grande nation turque. Trois décennies plus
tard, en 1961, les noms des villes et villages kurdes allaient être turquifiés
par un des premiers décrets du Comité d’union nationale, lequel avait été porté
au pouvoir par un coup d’État militaire. Le mot Kurde lui-même fut
interdit, à l'instar du costume traditionnel et de la musique. Le mot
Kurdistan fut aussi banni et remplacé par Güney Dogu (de güney
signifiant sud» et doğu signifiant «est», pour «sud-est»), encore en
usage. Bref, les Kurdes n'existent pas.
5.10 La
théorie de la «langue soleil»
Mustafa
Kemal devait résoudre un problème de taille par un procédé ingénieux, qui a
par la suite embarrassé
plusieurs experts de la langue. Faisant appel au nationalisme turc, il
prétendit que, historiquement, le turc était «la mère de toutes les langues»
— en
Occident, on croyait que c'était l'hébreu, après avoir cru que c'était le grec
— et
que tous les mots étrangers avaient donc une origine turque. Ce fut la théorie
de la «langue soleil» ("Günes-dil") en vertu de laquelle toutes les langues du monde
constituaient de simples dérivées, nécessairement corrompues, de la
«langue
soleil», le turc. De là à croire
que les Turcs étaient à l’origine de la «civilisation mondiale», ainsi que leur
langue, il n'y avait qu'un pas qui fut vite franchi. En faisant dériver la plupart des
langues du monde du turc, il devenait aisé de s'approprier les mots d'origine
étrangère, car les emprunts cessaient de poser problème.
- Une théorie
nationaliste
Au demeurant, bien
que de nombreuses publications consacrées à la théorie de la «langue
soleil» aient vu le jour de 1935 à 1938, les arguments de ses partisans
demeuraient bien faibles. La Société de linguistique reconnut elle-même que la théorie
de la «langue soleil» était en grande partie fondée sur la théorie nationaliste
prônée par la Société d'histoire, selon laquelle les grandes civilisations
étaient toutes issues de la même origine : les Turcs d'Asie centrale.
En raison de l'insistance de Mustafa Kemal,
la théorie de la «langue soleil» fut activement
défendue par les membres éminents de la Société de linguistique. Selon cette
théorie, les mots d'origine étrangère devaient être d'origine turque, ce qui
autorisait les Turcs à utiliser le vocabulaire qu'ils voulaient.
Visant à faire du turc «la mère de toutes les langues», cette
théorie permettait aisément de faire du kurde «un dialecte du turc». Or, les
données montrent que le kurde est une langue de la
famille indo-européenne, tandis que le turc
est une langue de la famille altaïque.
Les témoignages relevés à l'époque révèlent que Mustafa
était fasciné par la théorie de la «langue soleil» et qu'il encouragea son
approfondissement. Cette théorie connut sa plus grande popularité lors du IIIe Congrès linguistique
de Turquie, qui eut lieu en août 1936. Bien que le Congrès ait approuvé un
nouveau programme entièrement axé sur la théorie de la «langue soleil», les
spécialistes étrangers invités refusèrent, à la grande déception de Mustafa
Kemal, de
donner leur accord.
- Le protochronisme
Ce qui est moins connu est que le «père»
de cette théorie turque est un moine capucin français: Étienne-Marie Boulé
(1864-1946) écrivant sous le nom d'Hilaire de Barenton. Des théories
similaires existent dans beaucoup d'autres pays très nationalistes: ce
mouvement de pensée pseudo-linguistique et pseudo-historique se nomme «protochronisme»
et partout il vise à démontrer que le peuple et la langue que l'on veut
promouvoir, étaient là avant tous les autres. Ce moine s'est fait connaître
de la communauté scientifique en publiant en 1936 un ouvrage de 1500 pages
intitulé L'origine des langues, des religions et des peuples, dans
lequel il soutient que toutes les langues d’Occident dérivent du sumérien.
Or, le sumérien est un isolat
linguistique, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pu être, jusqu'à
aujourd'hui, rattaché à une quelconque famille de langues connue.
Quant au nationalisme kémaliste, il glissa vers l'interprétation
«raciale» de la turcité. La chaire d'anthropologie de la Faculté de médecine
procéda en 1937, sur «ordre d'Atatürk», à de vastes enquêtes «anthropométriques»
auprès de 64 000 paysans turcs pour finalement établir, à partir de leurs crânes
«brachycéphales», l'origine aryenne de la «race turque».
- Un épisode insolite
La théorie de la «langue soleil» ne survécut toutefois pas
très longtemps. Elle tomba rapidement dans l'oubli dès 1938 avec la maladie
d'Atatürk, puis sa mort, le 10 novembre de la même année. Aujourd'hui, la
théorie de la «langue soleil» ne tient plus la route; elle est perçue comme un
épisode insolite de l'Histoire de la Turquie.
6 Les causes du succès de la réforme
linguistique
La réforme linguistique de la Turquie est considérée
comme un succès incontestable dans les annales de l'interventionnisme
linguistique. Les causes de ce succès sont multiples.
6.1 Les causes linguistiques
En ce qui concerne les causes linguistiques, il convient
tout d'abord de rappeler
que la nouvelle graphie se voulait purement phonétique et qu'une lettre
devait toujours correspondre à un son. De fait, le nouvel alphabet parut remarquablement adapté à la
langue turque et en a grandement facilité l'apprentissage.
Par la suite, les progrès furent incontestables : tandis
que 10 % de la population savait lire en 1927, la proportion s'élevait à 22,4 %
en 1940 et à 54,7 % en 1970. Quant à l'introduction des majuscules, inconnues
dans l'alphabet arabe, elles rendaient la lecture courante beaucoup plus aisée
en faisant sortir les noms propres de l'ensemble et en mettant en relief la
ponctuation. On constate ainsi l'influence des langues européennes, notamment le
français et l'allemand.
De plus, comme il y avait peu de différences entre les
formes standards proposées dans le lexique et les diverses variétés dialectales
d'Anatolie, les résistances sont demeurées très faibles dans la
population, et les oppositions se limitèrent à quelques fanatiques
religieux et à une portion infime de l'élite passéiste.
6.2 Les causes sociales
Après l'effondrement de l'Empire ottoman et la guerre d'indépendance
(1918-1922), la population turque était réceptive à des changements sociaux
importants, car il lui fallait passer d'un empire multilingue à un État-nation
unilingue. La langue comme symbole d'unité nationale devenait un motif social
suffisant pour la promotion de ces changements. Le pays devait avoir une langue modernisée
en conformité avec une nouvelle nation turque.
Il faut se rappeler qu'à cette époque le taux
d’alphabétisation, surtout en langue arabe, demeurait extrêmement faible, avec moins de
10 % d'alphabètes. On écrivait alors en «turc ottoman» avec un alphabet
arabo-persan réservé aux lettrés. Or, il est plus aisé de faire apprendre un
alphabet nouveau à des individus qui n'en ont aucune notion, puisqu'il n'est pas
nécessaire de leur faire oublier l'ancien. Autrement dit,
l'analphabétisme généralisé de la population aurait été, à ce stade de
l'histoire de la Turquie, un avantage. Un phénomène similaire s'est produit à
peu près à la même époque en Espagne, alors qu'on a simplifié l'orthographe de
l'espagnol au sein d'une population quasiment analphabète.
Soulignons aussi l’enthousiasme des membres des
commissions linguistiques qui, investis dans la purification et la modernisation
de la langue turque, ont également pris des mesures pour faire participer le peuple en
lui demandant de suggérer des formes turques aux mots étrangers. De leur côté, les
enseignants et les journalistes ont participé avec ardeur à cet effort de
modernisation du vocabulaire.
Dans les décennies qui suivirent, la radio —
plus tard, la télévision — allait exercer une
influence considérable dans l'imposition de la prononciation et, par voie de
conséquence, d'une orthographe commune. Quoi qu'il en soit, le caractère
résolument phonétique de l'alphabet turc a sûrement favorisé certaines
évolutions phonétiques qui rendaient dorénavant obsolète l'orthographe jugée autrefois
«correcte».
La clé de cette réussite réside donc dans le fait que la
politique linguistique reposait sur un nationalisme territorial moderne,
dont la base était constituée par la langue du peuple turc. Malgré
son caractère fortement volontariste et ses effets pervers sur les langues
minoritaires, beaucoup de pays arabes auraient intérêt à s'inspirer de la
réalisation de cette
politique linguistique, car elle reposait sur la «langue du peuple», non sur
celle d'une oligarchie, comme dans plupart des États arabes. Ces derniers
n'ont jamais favorisé un rapprochement entre l'oral et l'écrit, et par voie
de conséquence ils n'ont
pas toujours contribué à l'élimination de l'analphabétisme dans leur
pays. Toutes les politiques d'arabisation ont été fondées sur
l'arabo-islamisme et le modèle proche-oriental, et elles se ont été
appliquées au détriment des populations arabophones qui se sont vu imposer une
langue morte, ce qui a favorisé dans bien des cas l'intégrisme musulman.
Dans la Turquie d'Atatürk, on a procédé autrement avec le succès que l'on
connaît! C'est là la plus grande leçon que Mustafa Kemal Atatürk pouvait donner aux
«aménagistes» de la langue.
6.3 Les causes politiques
Rien de tout cela n'aurait été, il est vrai, possible sans la
détermination de Mustafa Kemal. Non seulement il a participé aux
efforts de la réforme linguistique, mais il a agi comme modèle et a favorisé la
contribution de son peuple au succès de la réforme. Il est vrai aussi que ce
succès est dû en grande partie aux méthodes autoritaires et
tyranniques du Ghazi, car elle fut imposée et non vraiment sollicitée. De
telles méthodes seraient aujourd'hui impensables dans une société démocratique.
Après la mort d'Atatürk en 1938, son successeur, Mustafa İsmet İnönü, qui
dirigea le pays de 1938 à 1950, utilisa les mêmes méthodes et poursuivit avec
acharnement les objectifs de son prédécesseur. Parmi toutes
les réformes promulguées par Atatürk et İsmet İnönü, celles concernant
l'alphabet et le lexique sont probablement celles qui sont les plus réussies. Au plan de
l'aménagement linguistique, la politique linguistique
d'Atatürk constitue dans l'histoire de l'humanité un véritable exploit, d'autant
plus que les succès du genre sont rarissimes! Cette réforme que l'on pourrait
qualifier de «radicale» fut imposée à
une population très peu rebelle, et elle ne fut rendue possible que
grâce à l'incroyable charisme de Mustafa Kemal Atatürk... et de son autoritarisme.
En somme, il y eut un prix à payer pour la turquification de la langue
nationale. Il fallut supprimer 1000 ans d'histoire et évincer toutes les
minorités nationales en imposant une assimilation incontournable.
Profitant de l'occasion, Mustafa Kemal se servit de la nécessaire turquification
linguistique pour combattre les Kurdes qui, eux, parlaient une autre langue que
le turc, ce qui a donné lieu à une politique d'oppression à l'égard des langues
non turques, que ce soit l'arménien, le grec ou l'arabe. C'est aussi à coup de décrets, de règlements et de lois que
le turc moderne a réussi à s'imposer dans toute la société turque.
7 L'épuration ethnique
Le nationalisme kémaliste s'est exprimé par des
mesures draconiennes, dont des campagnes du type «Citoyen! parle turc!». En 1924,
Mustafa Kemal parlait des non-turcophones comme des «ennemis potentiels de la
nation». Périodiquement, Grecs, Arméniens et Arabes furent qualifiés d'«ennemis
de l'intérieur». C'est pourquoi la turquification du nouvel État-nation allait
de pair avec l'élimination des minorités tant religieuses que linguistiques, ce
que l'on qualifierait aujourd'hui d'«épuration ethnique». C'était une façon de
mettre en place la
société homogène dont rêvait Mustafa Kemal, car l'élimination des populations «allogènes»,
c'est-à-dire les minorités linguistiques, a eu
un effet déterminant sur la nation turque. En très peu de temps, les Turcs
durent combler le vide laissé par les Arméniens, les Grecs et les Juifs, qui
géraient les principales activités commerciales, bancaires et
industrielles.
Un recensement entrepris par l'État ottoman en 1906
révélait que la population de l'Empire était de 33 millions d'habitants, dont 21
millions en Anatolie, répartis entre 8 millions de Turcs, 5 millions d 'Arabes,
2,5 millions de Slaves, 2 millions d'Arméniens, 1,5 million de Grecs, 1 million
d'Albanais et 1 million de Kurdes.
7.1 Les Arméniens
Avant le début des exactions contre les Arméniens à la fin
du XIXe siècle, on dénombrait sur le territoire de la Turquie actuelle plus de
trois millions d'Arméniens et presque autant de Turcs; le pays comptait aussi
près de trois millions de différents autres peuples, dont des Kurdes, des Grecs,
des Assyro-Chaldéens, des Lazes, des Tcherkesses, etc. C'est le sultan Abdülhamid II (1842-1918) qui
avait déclenché
les hostilités contre les Arméniens concentrés surtout en Anatolie orientale,
mais aussi présents à Constantinople (Istanbul). Les nombreux massacres commandés par le
sultan lui avaient valu le surnom de Kızıl Sultan, c'est-à-dire le
«Sultan rouge».
Lorsque
prit fin l'Empire ottoman le 30 octobre 1918, les Arméniens espérèrent sans
aucun doute un
assouplissement de leurs conditions, et ce, d'autant plus que les Alliés, vainqueurs des Ottomans,
avaient promis de rendre justice aux Arméniens. D'ailleurs, le
traité de Sèvres prévoyait une certaine
protection aux minorités, notamment à l'article 141: «La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et
entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de
naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.» Mais le
gouvernement des Jeunes-Turcs avait décidé plutôt d'éliminer la totalité des
Arméniens de l'Asie mineure, qu'il estimait comme «le foyer national exclusif du
peuple turc».
En 1919, Mustafa Kemal
poursuivit, lui aussi, les persécutions contre les Arméniens qui étaient accusés notamment
d’avoir collaboré avec les Russes. C'est ainsi que les autorités turques
pendirent, le 24 avril 1923, des dizaines d’intellectuels arméniens sous prétexte
de «collaboration». En 1922, Mustapha Kemal
fit massacrer les Arméniens réfugiés à Smyrne (mer Égée). Il en résulta une dernière et
importante exode. Tous les Arméniens, qui avaient survécu après
l’armistice de 1918, furent systématiquement chassés de la Turquie. En
définitive,
les deux tiers des deux millions d'Arméniens avaient trouvé la mort. Le dernier
tiers dut sa survie à l'occupation par les Russes d'une partie de la Turquie
orientale. En même
temps, Mustafa Kemal s’était approprié tous les biens des Arméniens. Aux
accusations de génocide, Mustafa Kemal répondait qu'il s'agissait avant tout d'un
«acte d'autodéfense» destiné à protéger la Turquie de la «trahison».
7.2 Les Grecs
Déjà en 1915, le gouvernement des Jeunes-Turcs avait
expulsé plus de 200 000 Grecs des rives de la mer Égée et de la mer Noire vers
le centre de l'Anatolie, parce que la population grecque aurait, disait-on,
collaboré avec l'ennemi (la Grèce). Ce sont là des accusations qui avaient comme
effet pervers de s'étendre à toute la population, y compris les femmes et les
enfants.
Cependant, c'est Mustafa Kemal qui résolut le
«problème des minorités grecques» au
traité de Lausanne, dont les art. 37 à 45 prévoyaient des échanges de population
concernant 400 000 Turcs et 1,3 million de Grecs. En conséquence, presque tous
les Grecs orthodoxes de Turquie (à l'exception de ceux d'Istanbul) furent
rapatriés en Grèce. Avec la liquidation des Arméniens, l'expulsion des Grecs
achevait de faire de la Turquie une terre exclusivement musulmane, voire
ethniquement et linguistiquement homogène. Il ne restait
que les Kurdes qui étaient musulmans. Mustafa Kemal
pouvait alors se consacrer à l'édification de la nouvelle Turquie.
7.3 Les Kurdes et les lois
répressives
À la suite à l'effondrement de l'Empire ottoman en 1918, le
traité de Sèvres
(1920) avait prévu la création
d'un Kurdistan indépendant. Cependant, les Alliés décidèrent plutôt de miser
sur le nouvel État turc (1923) dirigé par
Mustafa Kemal. Non seulement le traité de Sèvres ne fut jamais appliqué, mais
il en fut de même pour le
traité de Lausanne du 24 juillet
1923, qui accordait certaines protections aux minorités religieuses de Turquie.
De plus, le décret-loi du 3 mars 1924 interdit l'enseignement du kurde dans
toutes les écoles, de même que toutes les associations et publications kurdes.
Pendant que la Turquie décrétait en 1932 la loi martiale sur tous les
territoires peuplés par les Kurdes, le Parlement promulguait une loi de
déportation et de dispersion des Kurdes (5 mai 1932); cette loi visait la
déportation massive des Kurdes vers l'Anatolie centrale.
Pourtant, la Turquie décrétait en 1932 la loi martiale
sur tous les territoires peuplés par les Kurdes. En même temps, Ankara
promulguait une loi de déportation et de dispersion des Kurdes (5 mai 1932);
cette loi visait la déportation massive des Kurdes vers l'Anatolie centrale. Une autre loi, adoptée en 1980, autorisait même la
déportation des membres de la famille d'un prisonnier politique «jusqu'au
quatrième degré». Et pourtant, le
discours officiel a toujours
prétendu qu’il n’y avait pas de problème kurde,
puisque «les Kurdes n’existent pas».
Une autre mesure fut imposée en vue d'exterminer le peuple kurde de Turquie. Il
s'agit de la Loi sur la
réinstallation
obligatoire (Mecburi
Iskân Kanunu), n° 2510, du 14 juin 1934. Parmi
les raisons justifiant cette loi, il est écrit que
«les Turcs arrivent en tête des races qui émigrent»
et qu'ils «turquisent» les régions où ils
s'installent; que certaines races et cultures, en
raison des courants islamiques, n'ont pu être
assimilées et que, par conséquent, elles ont
sauvegardé leur langue maternelle; que le travail le
plus important à accomplir par la révolution
kémaliste est «d'inculquer la langue turque et
d'astreindre toute population n'étant pas de langue
maternelle turque à devenir turque».
 |
L'article 2 de la Loi sur
la réinstallation obligatoire (Mecburi Iskân Kanunu,
n° 2510; en anglais: Turkish Resettlement Law) du
14 juin 1934 précise que
«conformément à la carte qui sera établie par le
ministère de l'Intérieur et approuvée par les
ministres, il sera constitué en Turquie trois
catégories de zones d'habitations». La zone n° 1
comprend les régions où l'on désire augmenter la
densité des populations ayant une culture turque,
c'est-à-dire une partie du Kurdistan turc, afin d'y
installer des immigrants turcs. La zone n° 2
comprend les régions où l'on veut établir les
populations qui doivent être assimilées à la culture
turque (régions de Thrace orientale, de Marmara
et des côtes égéenne et méditerranéenne). La zone
n° 3 compte les territoires que l'on veut
évacuer et qui sont interdits pour des raisons
sanitaires, matérielles, culturelles,
politiques, stratégiques et d'ordre public
(provinces kurdes telles que Agri, Sason, Tunceli,
Van, Kars, Bitlis, Bingöl et de certaines régions de
Diyarbakir et de Mus).
L'article 11a de la Loi sur
la réinstallation obligatoire de 1934 mentionne aussi qu'«il sera interdit à ceux qui parlent une
autre langue maternelle que le turc de former des villages ou quartiers, des
groupements d'artisans ou d'employés». L'article 11b relatif à l'installation
des Kurdes déportés précise que ces derniers «s'établissant dans les bourgs et les villes ne pourront
pas dépasser les dix centièmes de la population totale des circonscriptions
municipales».
|
Conformément à l’article 12 de la même loi, les
individus qui ne parlaient pas le turc et résidaient dans la zone 1 et qui
n’étaient pas transférés dans la zone 2 devaient être installés dans les
villages, les villes et les districts ayant une population à majorité de
culture turque afin de favoriser l’assimilation. La loi exigeait également
la réinstallation des minorités musulmanes telles que les Circassiens, les
Albanais et les Abkhazes, qui avaient été considérés comme des musulmans
tout en ayant omis de se conformer pleinement à la nation turque, alors
qu'ils partageaient la même foi, ils furent contraints par les responsables
politiques de la République turque à se rallier au peuple turc afin de
devenir turcs.
Plus tard, tous ces articles
portant sur la langue furent par la loi n°
5098 du 18 juin 1947.
L'objectif visé par la loi n° 2510 se retrouvait dans les propos du
ministre turc de la Justice de l'époque, M. Mahmut Esat Bozkut : «Le Turc est le seul seigneur,
le seul maître de ce pays. Ceux qui ne sont pas de pure origine turque n'ont
qu'un seul droit dans ce pays : le droit d'être serviteurs, le droit d'être
esclaves» (dans Milliyet, du 16 septembre 1930). De son côté, le député
Sadri Maksudi déclarait: «La turquification de la langue est l'un des plus
grands dispositifs pour assurer l'avenir de la race turque et la vie du turc
en tant que turc. Tel est notre objectif. » Le ministre de l'Intérieur de
l'époque, Şükrü Kaya, exprimait l'intention du gouvernement de la manière la
plus lucide possible: «Cette loi créera un pays parlant une seule langue,
pensant de la même manière et partageant le même sentiment.» L'emploi de
termes tels que race, ascendance et sang dans la
proposition de loi et les discours des députés à l'Assemblée nationale était
clairement inspiré par le discours nationaliste turc dominant qui se
caractérisait de plus en plus par des références ethnoculturelles ouvertes
dans le contexte politique de la décennie 1930. De plus, toute personne de
«culture turque» était officiellement considérée comme une personne
musulmane qui ne parlait pas d'autre langue que le turc. Cette ségrégation
laissait forcément toutes les communautés non musulmanes, ainsi que les
musulmans non turcophones, au-delà du schéma officiel de la culture turque:
les Kurdes, les Arabes, les Albanais et les autres musulmans qui parlaient
d'autres langues que le turc, ainsi que tous les chrétiens et juifs
étrangers, ne pouvaient pas recevoir de documents de déclaration de
nationalité, ni recevoir de papiers d'immigrant, car tous étaient raités
comme des étrangers.
Évidemment, ces dispositions, lorsqu'elles étaient en vigueur, ont donné lieu à de nombreuses révoltes qui ont secoué
le Kurdistan turc jusqu'en 1939. Elles ont été toutes écrasées par le maréchal
Mustafa Kemal Atatürk. Depuis cette époque, la répression a continué de
s'abattre régulièrement. En réalité, l'écrasement des Kurdes avait comme
objectif de les dissuader de se considérer comme un groupe ethnique district des
Turcs. Ils furent ensuite appelés les «Turcs montagnards», et leur langue,
interdite. Toutefois, au-delà de la répression, l'objectif réel de Mustafa Kemal
était l'assimilation pure et simple des Kurdes, c'est-à-dire leur liquidation. À partir de ce moment, le
Kurdistan turc fut administré comme une colonie sous le contrôle de trois
inspecteurs généraux et sous la responsabilité directe du chef de l'État.
7.4 Les Juifs
Les quelque 100 000 Juifs furent également victimes de discrimination, non de
déportation ou de génocide. Au début des années
1930, il leur fut interdit de circuler librement dans le pays et ils perdirent
tous les emplois qu'ils occupaient dans les services publics. En 1934, une
violente campagne antisémite fut lancée contre les «Juifs qui refusent de parler
le turc», la plupart d'entre eux parlant en effet le grec. Le gouvernement laissa agir les instigateurs de cette campagne comme
ils le désiraient, puis décida d'expulser en masse les Juifs de Thrace (au nord)
«pour des raisons de sécurité nationale» dans le but de les «protéger». Ce genre
de campagnes se poursuivit après la mort d'Atatürk (1938), jusqu'en 1944.
D'après les nationalistes arméniens, Mustafa Kemal serait un juif converti à l'islam.
Cette assertion n'a jamais été prouvée, mais il est vrai que Mustafa Kemal fut
initié à la franc-maçonnerie de Thessalonique, sa ville de naissance, où il avait
connu de nombreux juifs et étudié avec eux. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun
doute sur son appartenance musulmane quand on note le nom de son père (Ali Riza
Efendi) et de sa mère (Zübeyde Hanim). Il resterait
aujourd'hui environ 25 000 Juifs, mais, contrairement aux Arméniens, les Juifs,
répétons-le, n'ont pas été liquidés en Turquie. Beaucoup d'entre eux ont par
ailleurs quitté le pays au moment de la
fondation de l'État d'Israël après 1947.
8
La question linguistique après Atatürk
À la mort d'Atatürk,
à Istanbul, le 10 novembre 1938, la Turquie était devenue un
pays certes stabilisé, mais était resté rural dans une proportion de 80 %, ce qui suppose
des ressources plus limitées. C'est Ismet Inönü qui accéda à la présidence, de 1938
jusqu'en 1950.
8.1
La présidence d'Ismet Inönü
 |
Ismet Inönü était un héros de la guerre
d'indépendance et il fut premier ministre d'Atatürk de 1925 à 1937.
Dès le début de son mandat, Inönü fut salué comme le «chef
national» (en turc: "Milli Sef"), son titre officiel. Le
président Inönü poursuivit la politique linguistique en
s'appuyant sur l'Institut de la langue turque ("Türk Dil
Kurumu"), ainsi que sur la politique antireligieuse du Ghazi.
Dès 1941, il durcit les peines contre les contrevenants à la
«loi du chapeau» tout en encourageant les études scientifiques
consacrées à l'islam. Il reconnut l'État d'Israël, mais pratiqua
une politique ouvertement antisémite et antiminoritaire. En
novembre 1942, une loi d'«impôt sur la fortune» fut adoptée par
le Parlement. Cette loi visait officiellement à taxer les
revenus spéculatifs et l'enrichissement illicite. Dans les
faits, elle fut appliquée essentiellement contre les
non-musulmans, c'est-à-dire les Arméniens, les Grecs et les
Juifs. Le taux d'imposition fut fixé (arbitrairement) de telle
sorte qu'aucun contribuable ne puisse l'acquitter, si bien que
plus de 8000 individus furent enfermés dans des camps de
travail. Cet impôt fut aboli en mars 1944. |
La question linguistique continua de
faire partie des «actualités politiques» en Turquie, car le président
Inönü reprit le flambeau de la langue. À l'occasion d'une
déclaration officielle en septembre 1941, il engagea les
intellectuels turcs à se consacrer à nouveau à l'épuration de la langue
turque.
L'Institut
de la langue turque ("Türk Dil Kurumu") publia en mars 1942 une liste
de mots relatifs à la philosophie, à la pédagogie et à la
grammaire, mais cette publication suscita une opposition imprévue. Les
médias et les universitaires refusèrent la dictature du
Türk
Dil Kurumu, mais l'institut continua néanmoins de publier
régulièrement ses listes de termes savants. La politique de purification
connut son apogée en 1945 avec la traduction en "öz
Türkçe", la langue turque populaire, de la Constitution de 1924.
Cette version de 1945 consacrait l'état nouveau du turc, libéré de la
syntaxe arabo-persane et des néologismes persans.
 |
Après la Seconde
Guerre mondiale, le président
Inönü commença à être perçu comme un
«dictateur» lorsqu'il décida de remplacer les portraits
d'Atatürk par les siens dans les bureaux de l'administration
publique et dans les écoles, ainsi que d'imposer sa photo sur les
billets de banque, les monnaies et les timbres.
Malgré sa réputation de dictateur,
le président Ismet Inönü prit ses distances
avec le kémalisme radical et autorisa la création des
partis politiques d'opposition. L'année 1946 marqua la fin du
parti unique, le Parti républicain du peuple ou CHP (en turc: "Cumhuriyet
Halk Partisi"), et le début du pluralisme politique dans le
pays. |
8.2 De la démocratie
aux régimes militaires
Aux élections de 1950, exploitant les mauvais
souvenirs du Parti républicain du peuple, les démocrates gagnèrent
rapidement les faveurs de la bourgeoisie et des masses paysannes. Hostile à
tout dirigisme, le Parti démocrate allait rester dix ans au pouvoir. Il
accorda d'importantes concessions aux milieux religieux et conservateurs. On
assista alors à un regain spectaculaire de la religion musulmane. L'appel à la prière
en arabe fut restauré et l'enseignement religieux devint obligatoire dans
les écoles primaires, mais fut offert à titre facultatif au secondaire.
- L'Institut de la langue turque
En même temps, l'Institut de
la langue turque vit réduire son influence et perdit son caractère
semi-officiel. Les créations de mots savants diminuèrent sensiblement, ce
qui correspondait au souhait de la plupart des citoyens, las de changer leurs
habitudes linguistiques. C'est dans ce contexte qu'il convient de
situer le retour au texte original de la Constitution par une loi du 24
décembre1952. L'opposition conservatrice reprochait à l'Institut de la
langue turque d'avoir créé une «nouvelle langue», aussi élitiste et
inintelligible de la majorité que la
langue «turque ottomane» d'autrefois. Avec l'instauration de la
démocratie, le vocabulaire redevint un sujet de discorde entre la droite
conservatrice et la gauche héritière du kémalisme, favorable aux réformes
linguistiques.
Admirateur du modèle américain, le Parti
démocrate poursuivit la politique du président Ismet Inönü, qui avait
favorisé un rapprochement avec l'Occident et les États-Unis. Se posant en
adversaire du nationalisme arabe révolutionnaire incarné par le président
égyptien Gamal Abdel Nasser, la Turquie aligna sa politique étrangère sur
celle des États-Unis. En quelques années, la Turquie adhéra au Conseil de
l'Europe, devint membre de la Banque mondiale, du Fonds monétaire
international (FMI) et de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Grâce à des capitaux étrangers généreusement accordés,
la Turquie apparut comme le seul pays de la région vraiment industrialisé.
- Les militaires
Entre-temps,
le Parti démocrate devait faire face aux militaires désireux de «sauver la
république d'Atatürk». Le 27 mai 1960, un coup d'État militaire renversa le
gouvernement en place. Cette Turquie des militaires et des politiciens
conservateurs allait renforcer non seulement le mouvement d'épuration
linguistique de l'Institut de la langue turque, mais aussi l'idéologie panturquiste. Nihal Atsiz (1905-1975), un écrivain et idéologue nationaliste
d'extrême droite, exprimait ainsi cette idéologie en 1960 au sujet des
Kurdes de Turquie :
|
Si les Kurdes courent après l'illusion
de fonder un État, leur destinée sera d'être effacés de la terre. La race
turque a montré la façon dont elle peut traiter ceux qui convoitent la patrie qu'elle a obtenue au prix de son sang.
Elle a effacé les Arméniens de cette terre en 1915 et les Grecs en 1922.
|
La région kurde a vécu sous le régime de la loi martiale jusqu'en 1946, en
plus d'être interdite aux étrangers jusqu'en 1965. En 1961, l'un des
premiers décrets du Comité d'union nationale, qui gouverna le pays après le
coup d'État de 1961, portait sur la «turquification des noms de villes et
villages kurdes». Le Kurdistan turc a alors pris le nom d'«Anatolie
orientale» ou «provinces de l'Est». Le paragraphe 89 de la Loi sur les
partis politiques (1961) interdisait à tout parti d'affirmer qu'il existait
à l'intérieur des frontières de la République des minorités fondées sur des
différences linguistiques. Cette Loi sur les partis politiques
fut modifiée en 1983. Voici l'article 81 sur la prévention contre la création
des minorités:
|
Article 81
Prévention contre la création des minorités
Les partis politiques :
a) ne peuvent affirmer qu'il
existe sur le territoire de la république de Turquie des minorités
fondées sur des différences nationales ou
religieuses, culturelles, confessionnelles, raciales ou linguistiques;
b)
ne peuvent avoir pour objectif et mener des activités visant
à saper l'unité nationale ou à participer à des activités à cette fin en créant des minorités sur le territoire de la république
de Turquie par la protection, le développement et la diffusion d'une langue et d'une
culture autres que la langue et la culture turques;
c)
ne peuvent utiliser une autre langue que le turc dans la
rédaction et la publication de leurs statuts et leur programme, ni dans leurs
congrès, rassemblements en plein air ou réunions à l'intérieur, ni
dans leur publicité; ils ne peuvent utiliser ni diffuser des
calicots, affiches, disques, enregistrements sonores, films, brochures et tracts rédigés
dans une autre langue que le turc; ils ne peuvent pas non plus rester indifférents à ce
que ce genre d'actions soient menées par d'autres. Cependant, ils peuvent traduire leurs
statuts et leurs programmes dans les langues étrangères autres que celles qui sont
interdites par la loi.
|
La même année, l'Institut de recherche sur la culture turque (Türk Kültür Ara Ò
tirma Enstitüsü) publia plusieurs ouvrages sur la question kurde. Selon ces
ouvrages, la langue kurde n'était pas perçue comme une langue distincte ou indépendante: il
s'agissait plutôt d'un «ensemble de dialectes d'origine turque» qui ont la
caractéristique d'être «dégénérés après avoir été trop longtemps isolés dans les
montagnes de l'est du pays». Selon les Turcs
de l'époque, les différents dialectes kurdes seraient
incompréhensibles entre eux.
Compte tenu des classifications turques, les dialectes (lehçe)
kurdes, soit le kurmandji et le zazaki (kirmançca et zazaca), appartiendraient
aux dialectes anatoliens de l'Est, c'est-à-dire au «groupe osmanli» lié au
groupe du turc du Sud (güney türkçesi). En prétendant ainsi que le kurde
n'était pas une «langue», mais un simple dialecte local pauvre et dégénéré, on
voulait faire croire qu'il
devenait inapproprié de l'enseigner, de l'écrire ou de le publier, ce qui
justifiait l'interdiction. Quoi qu'il en soit, toutes ces affirmations étaient
parfaitement erronées, puisque le kurde est une
langue indo-iranienne, qui n'a rien
à voir avec une langue altaïque comme le
turc.
Quant au président de la
République, Cemal Gürsel (de 1960 à 1966), il demandait de «cracher au
visage de quiconque qualifiera autrui de kurde». Au tournant des années
1970, la Turquie devint le cadre de radicalismes multiples et
d'affrontements incessants qui fragilisèrent la classe politique. De plus,
une crise économique accéléra la paupérisation de la population et aggrava
les inégalités sociales. Parallèlement aux contestations inévitables de la
part des étudiants, des ouvriers et des paysans, de jeunes officiers de
l'armée décidèrent de prendre le pouvoir afin de restaurer le kémalisme.
Mais le régime militaire de 1971 se discrédita rapidement auprès de la
population par ses mesures répressives, ses tortures et ses exécutions. Il
se saborda en autorisant la tenue d'élections libres en octobre 1973.
Celles-ci consacrèrent la
victoire de Mustafa Bülent Ecevit, président général du
Parti
républicain du peuple (CHP). Ce fut le retour de l'islamisation au moyen de
mesures favorables à la morale et à la culture religieuses.
- La crise de Chypre
 |
En 1974, un coup d'État à l'île de Chypre,
désignée officiellement comme la république de
Chypre depuis 1960, fut perpétré
par la junte au pouvoir à Athènes. C'est alors que le gouvernement Ecevit
décida d'intervenir militairement à Chypre, afin d'empêcher le «massacre des Turcs chypriotes». L'intervention des
forces armées turques
sur les côtes nord de l'île provoqua la fuite des putschistes et la chute de
la junte militaire grecque, avec comme résultat que
l'occupation turque a ainsi amputé la république chypriote de 38 % de son
territoire au nord (voir la carte),
faisant 2000 victimes parmi les Chypriotes grecs et entraînant l'expulsion
de dizaines de milliers d'autres de leur foyer.
En quelques semaines, environ 50 000 Grecs furent
forcés de partir vers le sud, tandis que 45 000 Turcs durent se
réfugier vers le nord. Ce «réaménagement» démographique regroupa
au nord tous les Chypriotes turcs qui vivaient jusqu'alors dans
des enclaves dispersées un peu partout sur l'île. |
En même temps, la Turquie fit
venir quelque 100 000 immigrants d'Anatolie. Les Chypriotes turcs allaient
désormais être sous la protection militaire de la Turquie, ce qui porta la
popularité du gouvernement Ecevit à son apogée.
- La répression militaire
Néanmoins, contre toute
attente, le président Ecevit perdit les élections de 1974, ce qui favorisa l'alternance
de divers gouvernements. Avec la droite radicale, appuyée par le régime
militaire, la violence reprit de plus belle, surtout dans les localités
dites «mixtes», où on trouvait des Kurdes ou des alévis qui pratiquent
une religion bien particulière héritée du zoroastrisme. Tous les jeunes
Turcs d'aujourd'hui connaissent encore la devise suivante : «Celui qui tue
deux alévis mérite le paradis.»
Entre-temps, le Kurde
Abdullah Öcalan fondait en 1978 le Parti des travailleurs du Kurdistan
ou PKK (en kurde: Partiya Karkerên Kurdistan), une organisation armée se
présentant comme un mouvement de guérilla.
Le coup d'État militaire
du 12 septembre 1980 par le général Kenan Evren permit à celui-ci de prendre
des mesures vigoureuses contre les hommes politiques et les intellectuels
accusés d'avoir laissé le pays s'enfoncer dans la violence. La répression
fut particulièrement sévère à l'égard des islamistes et des groupuscules de
droite et de gauche. Des milliers de personnes furent exécutées et des
dizaines de milliers d'autres furent emprisonnées. Le régime militaire
pratiqua une politique ultranationaliste et ultraconservatrice.
Les militaires décrétèrent que toute idéologie autre que le kémalisme, toute
appartenance ethnique autre que turque et toute affiliation religieuse autre
que sunnite relevaient dorénavant de la «perversion».
 |
Il
s'ensuivit que l'usage oral de la langue kurde fut interdit,
tandis que des banderoles furent installées dans les montagnes
du Kurdistan avec la devise de Mustafa Kemal 'Atatürk, le
fondateur de la république de Turquie : "Ne
mutlu Türküm diyene" («Heureux celui qui se dit Turc»).
Mais ce n'est
pas tout.
Des mosquées furent construites dans les
villages alévis (des musulmans hétérodoxes). Dans les prisons, la lecture du Coran fut fortement
«recommandée», tandis que les prisonniers politiques durent écrire sur les
murs de leur geôle les slogans du nouveau régime, soit «La Turquie plus
grande que tout le reste» et «Celui dont le front touche le tapis de prière
est mon frère.» |
Bien qu'ennemi de
l'islamisme politique, le général Kenan Evren croyait qu'un islam modéré
serait le meilleur rempart contre le radicalisme religieux et le communisme.
Dans les faits, l'islamisme préoccupait beaucoup moins le régime que le
«séparatisme kurde» et l'extrême gauche politique. Dans l'espoir de
renforcer la cohésion nationale, la junte militaire décida d'infiltrer les
milieux de l'éducation et de la culture afin de combattre, avec les armes du
nationalisme et d'un islam éclairé, les méfaits du cosmopolitisme, ce qui
n'inaugurait rien de bon pour les minorités du pays, surtout les chrétiens
et les Kurdes. Le régime militaire prôna une idéologie mariant le kémalisme
et l'islam. Toutes les institutions du pays, de l'école primaire jusqu'à
l'université en passant par la télévision, furent réformées en conformité
avec les exigences de la nouvelle «vision nationale», celle qui influencera la
Constitution de 1982 et deviendra l'idéologie officielle des années Ozal
(1982-1993).
- La Constitution de
1982
Le projet de constitution, élaboré en
1982 par une assemblée consultative, s'inscrivait en réaction à la
Constitution de 1961. Les dispositions prévues dans la Constitution de 1961
furent modifiées de façon plus restrictive dans la version de 1982:
|
Article 2 (1982)
La république de Turquie est un État de droit
démocratique, laïc et social, respectueux des droits de l'Homme dans un
esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché
au nationalisme d'Atatürk et s'appuyant sur les principes fondamentaux
exprimés dans le préambule.
III. Intégrité de l'État, langue officielle,
drapeau, hymne national et capitale
Article 3
L'État turc forme, avec son territoire et sa
nation, une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc.
Son emblème, dont la forme est définie par la loi, est un drapeau de
couleur rouge sur lequel il y a une étoile et un croissant blancs.
Son hymne national est la « Marche de l'indépendance ».
Sa capitale est Ankara.
Article 12
Chacun possède des droits et libertés
fondamentaux qui sont individuels, inviolables, inaliénables et auxquels
il ne peut renoncer. Les droits et libertés fondamentaux comprennent
également les devoirs et responsabilités de l'individu envers la
société, sa famille et les autres personnes.
II. Limitation des libertés et des droits
fondamentaux
Article 13
Les droits et libertés fondamentaux ne peuvent
être limités que pour des motifs prévus par des dispositions
particulières de la Constitution et en vertu de la loi, et pour autant
que ces limitations ne portent pas atteinte à l'essence même des droits
et libertés. Les limitations dont les droits et libertés fondamentaux
font l'objet ne peuvent être en contradiction ni avec la lettre et
l'esprit de la Constitution, ni avec les exigences d'un ordre social
démocratique et laïque, et elles doivent respecter le principe de
proportionnalité.
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)
III. Non-abus des droits et libertés
fondamentaux
Article 14
Aucun des droits et libertés fondamentaux
inscrits dans la Constitution ne peut être exercé sous la forme
d'activités ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité indivisible
de l'État du point de vue de son territoire et de sa nation ou de
supprimer la République démocratique et laïque fondée sur les droits de
l'Homme.
Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée en ce
sens qu'elle accorderait à l'État ou à des individus le droit de mener
des activités destinées à anéantir les droits et libertés fondamentaux
inscrits dans la Constitution ou à limiter ces droits et libertés dans
une mesure dépassant celle qui est énoncée par la Constitution.
La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui mènent des activités
contraires à ces dispositions.
(Al 2 et 3 modifiés par la loi n° 4709 du 3.10.2001)
IV. Suspension de l'exercice des droits et libertés fondamentaux
Article 15
En cas de guerre, de mobilisation générale,
d'état de siège ou d'état d'urgence, l'exercice des droits et libertés
fondamentaux peut être partiellement ou totalement suspendu ou des
mesures contraires aux garanties dont la Constitution les assortit
peuvent être arrêtées, dans la mesure requise par la situation et à
condition de ne pas violer les obligations découlant du droit
international.
Toutefois, même dans les cas énumérés à
l'alinéa premier, on ne peut porter atteinte au droit de l'individu à la
vie, sous réserve des décès qui résultent d'actes conformes au droit de
la guerre et de l'exécution des peines capitales, ni au droit à
l'intégrité physique et spirituelle, ni à la liberté de religion, de
conscience et de pensée ou à la règle qui interdit qu'une personne
puisse être contrainte de révéler ses convictions ou blâmée ou accusée
en raison de celles-ci, ni aux règles de la non-rétroactivité des peines
et de la présomption d'innocence de l'accusé jusqu'à sa condamnation
définitive.
(modifié par la loi n° 5170 du 7.5.2004) |
Dans cette nouvelle Constitution,
l'autoritarisme et le centralisme ont remplacé le pluralisme et la
démocratie. C'est ainsi que les dispositions concernant les droits et la
liberté comprenaient dorénavant toute une série d'exceptions qui en réduisaient la
portée. En fait, les années de violence de la décennie 1970, qui avaient
paralysé les institutions, avaient incité les rédacteurs à privilégier un
dispositif répressif, limitatif et coercitif. La Constitution fut adoptée
par référendum dans une proportion de 92 %, avec le général Evren
comme président de la République.
8.3 L'insurrection
kurde et la politique turque
 |
Le 13 décembre 1983, Turgut
Özal, d'origine kurde par sa mère, devint premier ministre du
pays et dut composer avec les militaires. Au début de son
mandat, Özal se fit le champion du nationalisme turc et d'un
État fort, apte à imposer l'ordre et la discipline.
Turgut Özal défendit une vision «eurasiste» de la
Turquie, c'est-à-dire à la fois tournée vers l'Europe et vers
l'Asie. Il accéléra la libéralisation de son
pays, ce qui favorisa
l'émergence d'une intense production littéraire et scientifique
en langue turque. On assista à un regain d'intérêt pour l'Histoire
ottomane et la traduction de livres occidentaux. En 1987, Turgut
Özal formula la demande officielle de l'adhésion de la Turquie à
l'Union européenne. Le mandat d'Özal comme premier
ministre fut terni par un violent conflit avec les Kurdes.
L'insurrection du PKK commença en août
1984 dans la région de l'Anatolie du Sud-Est, c'est-à-dire au
Kurdistan turc. En réaction, l'État turc déploya quelque 300 000
militaires dans le Kurdistan. Ceux-ci évacuèrent des
centaines de villages et détruisirent les maisons et les
installations civiles afin d'empêcher le retour des habitants.
Au total, quelque 3000 villages kurdes de Turquie furent
complètement rayés de la carte, alors que plus de 378 000
personnes durent quitter les lieux. |
En 1989, le gouvernement turc imposa dans toute la région kurde un «régime
d'exception». Par les décrets-lois 423 et 424, les militaires se se virent octroyer des pouvoirs extraordinaires. Un décret du 16 décembre 1990
vint préciser les pouvoirs du «superpréfet turc». Les résultats parlent d’eux-mêmes : détentions sans procès,
déportations de civils, recours systématique à la torture, suspension de la
liberté de presse, sans compter les opérations de nettoyage de l'aviation
turque depuis la fin de la guerre du Golfe (1991). Quant à la plupart des
dirigeants kurdes, ils furent jetés en prison et les déportations massives se
perpétuèrent, de même que le pilonnage des villages kurdes.
Le 9 novembre 1989,
Turgut Özal accéda à la présidence de la République. Durant sa
présidence, il réforma l'économie turque en autorisant les produits
qui n'étaient pas d'origine turque, et favorisa l'amélioration des relations avec
l'Occident. Depuis 1990, l'apparition de
mouvements religieux populaires a entraîné la réintroduction de nombreux
termes islamistes utilisés dans la langue turque.
Avec la disparition de l'URSS en 1991, la
Turquie se vit ouvrir au commerce les ex-républiques soviétiques de l'Asie
centrale, qui, comme on le sait, sont de langue turcique: l'Azerbaïdjan
(azéri), le Kazakhstan (kazakh), le Kirghizistan (Kirghiz) et l'Ouzbékistan
(ouzbek). Cette communauté de langues place la Turquie à la tête d'un
vaste ensemble de pays et à une participation à l'existence de plusieurs organismes de
coopération internationale.
Cependant, en raison de la rigidité de
l'État turc et de son refus de reconnaître aux Kurdes la légitimité
d'une identité culturelle à part entière et d'une autonomie administrative,
le PKK (Parti des travailleurs du
Kurdistan) intensifia sa guérilla. Devant
l'ampleur du conflit, le président Turgut
Özal amorça un virage radical avec la politique kémaliste et répressive à
l'égard des Kurdes. Il proposa des pistes de solutions politiques,
entre autres, une meilleure représentation des Kurdes au sein des
institutions politiques et administratives, une amnistie pour les membres du
PKK et une certaine autonomie pour le Kurdistan turc.
Puis le gouvernement turc finit par reconnaître la réalité kurde en
acceptant une «zone de protection» dans une partie du Kurdistan. Cette
mesure fut suivie par l'autorisation de la langue kurde orale. En
mars 1993, le chef du PKK, Abdullah Öcalan,
proposa un cessez-le-feu. Malheureusement, à peine
un mois plus tard, le 17 avril 1993, Turgut Özal décéda d'une crise
cardiaque. Sa mort laissa un grand vide et changea aussitôt la donne
politique.
 |
Sous la présidence de Süleyman Demirel (1993-2000),
la question kurde déboucha sur une guerre à outrance, mobilisant plus de 300
000 soldats turcs, ce qui correspondait à plus du tiers de l'armée.
Autrement dit, le successeur du président Özal, pourtant issu lui aussi
d’une famille kurde, opéra manifestement un retour en arrière en laissant
l’armée ratisser le Kurdistan. Évidemment, le PKK rompit sa trêve en 1994 et
reprit sa lutte armée commencée en 1984. Depuis ce temps, le conflit
aurait fait 37 000 morts et plus de deux millions de villageois déplacés
dont les villages furent brûlés par les forces armées turques. Les pires
années furent celles du gouvernement de la première ministre Tansu Ciller (de 1993 à 1996),
dont les «escadrons de la mort» d’extrême droite firent des milliers de
victimes parmi les élites kurdes. |
Depuis l’arrestation d’Abdullah Öcalan en 1999, les
violences en Turquie ont baissé considérablement. Le PKK a même annoncé
l’abandon de la lutte armée au début de 2000, ce qui n'a pas empêché la
répression turque de se poursuivre.
8.4 Le sommet d'Helsinki de 1999
En décembre 1997, le Conseil européen de Luxembourg décidait
de ne pas
retenir la candidature de la Turquie à l'adhésion à l'Union européenne.
Cette décision, on s'en doute, fut très mal perçue par l'opinion publique turque. Les
conditions politiques imposées par l'Union européenne étaient devenues plus
contraignantes, alors que la Turquie s'est souvent vu reprocher ses
atteintes aux droits de l'Homme et sa gestion brutale de la question kurde. Néanmoins, en décembre 1999, le gouvernement turc remporta
un certain succès au sommet d'Helsinki, car les chefs d'État et de
gouvernement de l'Union reconnurent le statut de «candidat à l'adhésion» de
la Turquie.
Il n'en demeure pas moins que la Turquie ne fait pas
suffisamment d'efforts pour rassembler les conditions nécessaires à cette
adhésion. Si l'on tient compte de quelques modifications mineures à la législation turque,
les réformes engagées sont toujours demeurées timides et ressemblent à du camouflage. D'un
côté, toute concession à l'égard des minorités est présentée comme une
grande politique d'ouverture; de l'autre, l'État adopte des pratiques encore plus
rigides qui contrebalancent les concessions. Par exemple, en 2003 et en 2004, le
gouvernement turc autorisait les émissions radiophoniques dans les langues
et dialectes locaux, ainsi que leur enseignement dans les écoles privées par
le
Règlement relatif aux émissions de radio et de télévision dans les
langues et dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs
dans leur vie quotidienne (2004).
Cette mesure fut présentée à l'Europe comme la levée des interdictions qui
frappaient la langue kurde.
Dans les faits, il n'en fut absolument rien. De
plus, toute manifestation de revendication du droit à l'enseignement en
kurde fut sévèrement réprimée. Quant aux violations des droits de l'Homme,
elles demeurent massives. Néanmoins, un nouveau code civil fut adopté, qui reconnaît
aux femmes l’égalité dans le mariage, l’enseignement du kurde fut finalement autorisé
à certaines conditions et la peine de mort, abolie, ce qui permit au chef
kurde Abdullah Öcalan d'échapper à la peine
de mort.
8.5 La crise irakienne et l'autonomie
kurde
En avril
1991, la résolution n° 688 de l'ONU imposa à l’Irak une
«zone de protection» dans le nord du pays; l'organisme
international décida d'en
garantir la sécurité par des patrouilles aériennes au nord
du 36e
parallèle surveillées par les États-Unis, la France
et la Grande-Bretagne dans le cadre de l'opération appelée "Provide
Comfort". Lorsque la guerre du Golfe éclata en 1991, le
Kurdistan irakien était déjà en ruines.
Néanmoins,
la création d'une zone
d'exclusion aérienne dans le nord de l'Irak, protégée par
les militaires américains et britanniques, a eu pour effet
de conférer aux Kurdes d'Irak une autonomie réelle. Pendant
ce temps en Turquie, à partir de 1991,
grâce à l'abrogation de la
Loi relative aux publications et émissions qui seront faites dans d'autres
langues que le turc, des livres, des revues et des journaux ont été publiés
en kurde, mais cette langue est demeurée longtemps interdite à la télévision.
- L'autonomie
kurde
En 1992,
les Kurdes d'Irak tinrent leurs premières élections
démocratiques, lesquelles permirent la création, à Erbil,
d'un parlement kurde autonome et d'un gouvernement régional démocratiquement
élu. Le Parlement autonome comptait 100 sièges réservés aux Kurdes, 5 aux
Assyriens et 10 aux Turkmènes. Soucieux de rassurer les États voisins, le
Parlement kurde se prononça en faveur d'un fédéralisme respectant
l'intégrité territoriale de l'Irak.
Comme on
pouvait s'y attendre, les écoles kurdes furent réouvertes
dans toutes les régions «libérées». En ce qui concerne les
diverses minorités linguistiques du Kurdistan, les autorités
kurdes entreprirent de promouvoir le statut des langues
minoritaires afin qu'elles puissent être utilisées dans les
médias et dans l'enseignement dans les écoles primaires et
secondaires. En même temps, le kurde fut promu comme
langue de l'administration dans les zones kurdes.
Les
populations arabes sunnites implantées par Saddam Hussein
furent obligées de rendre les terres aux Kurdes et
de voir leurs villes incluses dans un Kurdistan autonome.
- Les conséquences en Turquie
 |
Toutes ces mesures
eurent pour effet de
semer la panique en Turquie, car les dirigeants de ce pays n'étaient que
fort peu disposés à voir se créer une entité politique le moindrement viable
chez les Kurdes irakiens. C'est que l'autonomie dans le Kurdistan irakien
pourrait s'étendre au Kurdistan turc. La présence d'un Kurdistan autonome en
Irak, avec l'appui des États-Unis, représente donc une menace pour l'intégrité de
la Turquie.
Pour manifester son désaccord, l'armée turque massa quelque
140 000 soldats à la frontière nord de l'Irak, tout en menaçant
d'intervenir. Toute relation qui se détériorerait entre la Turquie et les
États-Unis ne pourrait que favoriser les courants anti-occidentaux,
ultranationalistes, militaristes et islamistes. La Turquie semble prête à
s'interposer
militairement en cas d'indépendance du Kurdistan irakien. Quant aux
États-Unis, ils craignent qu'une éventuelle indépendance du Kurdistan
irakien ne déstabilise toute la région en ravivant le rêve sécessionniste
des minorités kurdes de la Turquie et de l'Iran. Au fur et à mesure que les
Kurdes d'Irak renforcent leurs positions en Irak, on assiste à une
recrudescence de l'hostilité, sinon du racisme des Turcs à l'égard des
Kurdes de Turquie. La Turquie n’a d'ailleurs jamais caché qu’elle souhaitait
le rétablissement de l'autorité de Bagdad sur le
Kurdistan irakien malgré la tutelle
internationale imposée par l’ONU. Elle ne veut à
aucun prix un État kurde dans le nord de l'Irak
voisin, et ce, d'autant plus que celui-ci
risquerait d'être asphyxié par la Turquie, la
Syrie et l'administration de Bagdad. |
Depuis que les États-Unis ont
réussi à contrôler Bagdad, les Kurdes ont eu certes la vie plus facile, mais
l'armée turque a continué de surveiller ses intérêts en maintenant des
troupes près du Kurdistan irakien. Cependant, en janvier 2018, alors que
l’État islamique était pratiquement à l’agonie, les États-Unis ont abandonné
lâchement leurs alliés kurdes et, par la voix de leur secrétaire d’État,
reconnaissaient plutôt «le droit légitime de la Turquie» à se «protéger».
C'est ainsi que, avec la bénédiction de la Russie, la Turquie a pu
tranquillement lancer son offensive terrestre et aérienne (appelée «Rameau
d’olivier») contre les Kurdes en Syrie. Pourtant, en août 2016, l’émissaire
des États-Unis auprès de la coalition internationale antidjihadistes jugeait
«inacceptables» les frappes menées par la Turquie contre les forces
arabo-kurdes, qui menaient leur combat contre le groupe État islamique dans
le nord de la Syrie. La Turquie craint toujours qu’un éventuel Kurdistan
irako-syrien ne donne une base arrière idéale aux Kurdes turcs aspirant à
libérer leurs terres ancestrales.
8.6 Les effets de la répression
Selon un bilan officiel établi par le ministre d'État du gouvernement
turc, la
guerre entre les Kurdes et les forces armées turques aurait fait au moins 40
000 morts depuis 1984, dont quelque 15 000 parmi les militaires turcs. Elle aurait
coûté à l'État turc quelque 84 milliards de dollars US et 3000 villages
kurdes auraient été détruits. On ignore en réalité combien coûte exactement la guerre
antikurde, car de nombreux fonds ne sont pas soumis au contrôle du Parlement,
mais certains économistes estiment que plus des trois cinquièmes du budget
annuel sont consacrés à la «pacification» du territoire. Le gouvernement
turc croit encore éradiquer la guérilla kurde, sans rien céder aux
aspirations culturelles ou politiques des Kurdes! Évidemment, c'est une
politique dont les chances de réussite semblent quasi nulles.
Ce n'est pas un hasard si l’armée turque a acquis une importance
démesurée
dans ce pays. Celle-ci dévore un budget impressionnant qui fragilise toute l’économie
de la Turquie, avec une inflation qui dépasse, depuis 1991, les 80 %. Cette
armée n’a qu’un projet : conserver l’alliance américaine et constituer
son bras armé contre les Russes et les Arabes. Cette puissante armée a aussi
un droit de veto sur tous les budgets votés au Parlement d’Ankara; elle
soumet d’abord son propre budget aux parlementaires, mais aucun d’eux ne
peut le contester sous peine d’être accusé de trahison.
Il est
certain par ailleurs qu’une bonne partie de l’armée turque, par exemple les généraux
et les autres officiers, les miliciens pro-gouvernementaux, les policiers, sans
compter les fonctionnaires en poste dans les régions kurdes, les marchands de
canons, les trafiquants de drogue, etc., ont intérêt à poursuivre ce conflit
qui renforce leur emprise sur le pays. Il est vrai en outre que la Turquie conserve une très
longue tradition militariste pour des raisons de sécurité nationale. La guerre
contre les Kurdes aurait coûté, selon les estimations des militaires, plus de
100 milliards de dollars US. La Turquie abrite en même temps une base permanente de 5000
militaires américains (sans compter des soldats britanniques et français)
ainsi que des armes nucléaires.
8.7 L'actualité des
questions linguistiques
La question linguistique continue encore aujourd'hui
de faire partie des «actualités politiques» en Turquie. Depuis la mort d'Atatürk
en 1938, chaque décennie amène l'inévitable débat, à savoir s'il faut favoriser un
lexique plus traditionnel ou plus moderne.
Le domaine religieux n'a, quant à lui, jamais été beaucoup affecté par la réforme
linguistique. Les publications religieuses ont continué de véhiculer un discours
qui est encore aujourd'hui lourdement arabe ou persan dans le vocabulaire et
très persan dans la syntaxe. Entre-temps, les successeurs d'Atatürk ont repris
le flambeau en reprenant l'idéologie de l'épuration de la langue.
En fait, l'objectif d'Atatürk a toujours été la religion, plus précisément son
élimination en tant qu'héritage de l'Empire ottoman. Son ambition était de
créer un nouvel homme turc, dépouillé de tout ce qui pouvait lui rappeler son
ancienne appartenance ottomane, ce qui incluait la religion musulmane. Pour ce
faire, il fallait rejeter non seulement l'alphabet arabe, mais aussi les
influences linguistiques islamistes, le calendrier, même les vêtements.
Depuis une trentaine d'années, la Turquie semble avoir cessé de considérer la
langue comme un problème majeur. Les alternances politiques n'ont
guère favorisé une action constante en la matière, bien que la presse turque
n'ait jamais cessé de consacrer de nombreux articles à la question. Il y eut
une tentative de réforme autoritaire par le gouvernement militaire en 1982, mais elle
provoqua de vives réactions même chez les partisans, qui y virent
une trahison d'Atatürk.
- Le «paquet démocratique» pour les droits des Kurdes
En septembre 2013, le premier ministre turc,
Recep Tayyip Erdoğan, dévoilait un
«paquet démocratique» pour les droits des Kurdes; il annonçait des réformes
destinées notamment à accroître les droits des Kurdes. En éducation, le
gouvernement turc préconisait un enseignement en kurde dans les établissements
d'enseignement privés tout en précisant que certaines matières continueraient
d'y être offertes en turc: «Nous rendons à présent possible l'enseignement dans
différentes langues et dialectes dans les écoles privées.»
Recep Tayyip Erdoğan (devenu président de la Turquie en août 2014) a également annoncé des mesures
permettant que certaines
localités kurdes, dont le nom avait été turquisé après le coup d'État de 1980,
puissent reprendre leur nom kurde. Il comptait aussi autoriser la libre
utilisation des lettres kurdes Q, W et X, longtemps bannies de Turquie, car elles
n'apparaissaient pas dans l'alphabet turc.
En fait, l'enseignement en kurde serait autorisé comme matière optionnelle au
même titre que les langues étrangères comme l'anglais, le français ou
l'allemand, et ce, à la condition qu'il y ait un nombre suffisant d'élèves. Quoi
qu'il en soit, les nouvelles lois et les anciennes lois modifiées
contiennent encore des dispositions restrictives, alors que les tentatives de
réformes se heurtent aux résistances de l'appareil de l''État. Bref, les effets
positifs se font encore attendre.
- Des mesures jugées symboliques
Dans les faits, les réformes ont été perçues comme
essentiellement «symboliques» par les associations et les mouvements kurdes qui revendiquent le droit à l’enseignement en langue maternelle kurde dans
les écoles publiques, une forme d’autonomie pour les régions à majorité kurde de
l’Est et du Sud-Est, une révision de la loi antiterroriste afin de permettre la
libération de milliers de personnes et une mention de l’identité kurde dans la
Constitution. À l'heure actuelle, aucune école publique n'est autorisée à donner un
enseignement dans la langue de cette minorité. Les réformes
proposées apparaissent de toute évidence comme nettement insuffisantes («trop légères») pour les
Kurdes.
Pourtant, les revendications des Kurdes semblent acceptables. Ce peuple
progressiste demande une auto-gouvernance démocratique dans le sud du pays – et
non pas l’indépendance – et le respect de ses droits culturels et linguistiques.
Or, ces demandes sont jugées inacceptables et considérées comme provocatrices
par le gouvernement turc, nationaliste et conservateur, qui en a fait un
prétexte à la rupture du cessez-le-feu.
- La poursuite de la répression contre les Kurdes
En 2015, la Turquie a vu en effet réapparaître une vague de violence et a lancé une
opération aérienne contre les groupes terroristes actifs en Syrie voisine, comme
le groupe armé État islamique (EI). Or, comme il n'y a pas de guerre contre le
groupe État islamique, Ankara se sert de ce prétexte pour couvrir sa répression
de la guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). De fait, l'Agence
France-Presse signale que, sur des dizaines de frappes aériennes menées par la
Turquie en Syrie, seules trois visaient officiellement l’EI, les autres
ciblaient les rebelles kurdes.
La Turquie semble encore s'enfoncer dans une
guerre ouverte avec les Kurdes, qui répliquent par des attaques meurtrières aux
raids aériens visant leurs bases, laissant les Américains en première ligne dans
la lutte contre les djihadistes. La télévision nationale retransmet chaque jour
en direct les funérailles officielles accordées aux «martyrs» victimes du PKK.
Encore en septembre 2015, le gouvernement turc, par la voix de son premier
ministre islamo-conservateur, promettait d’éradiquer les rebelles du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) au lendemain de l’opération la plus meurtrière
menée depuis des années contre les forces armées. Ainsi, le pays se retrouve replongé dans son accablant cauchemar du «problème
kurde». Aujourd'hui encore, l'opinion publique
turque et les médias sont prêts à accepter toutes les violations des droits de
l'Homme, pourvu que le «terrorisme kurde» soit supprimé. Comme par le passé, le
gouvernement turc préfère régner par la peur. Entre-temps, l'État turc
continue d'emprisonner des intellectuels et historiens turcs qui soutiennent la
reconnaissance du génocide arménien.
Depuis le mois d'août 2015, le régime turc du président Erdoğan a imposé une
cinquantaine de couvre-feux dans les régions kurdes du sud-est de la Turquie,
isolant plusieurs villes du reste du pays. De nombreuses exactions ont été
relevées, tandis que les maisons étaient rasées une à une. Certains observateurs
parlent d’une volonté d’éradiquer, non pas le PKK, mais le peuple kurde dans sa
totalité. De fait, Nusaybin, Cizre, Silopi, Sur, Dargeçit, etc., toutes des
villes kurdophones sont devenues le théâtre d’intenses combats entre les soldats
turcs et les combattants du PKK. Ankara a déployé 10 000 soldats et policiers
dans les seules villes de Cizre et Silop, et a bombardé les bases du PKK jusque
dans les montagnes irakiennes. L'objectif du gouvernement du président Recep
Tayyip Erdoğan, c'est de «pacifier» et de «nettoyer» le sud-est du pays, à
majorité Kurde et «d'enterrer tout le monde dans les tranchées». C’est toute
l’ironie de la situation: tandis que les forces kurdes combattent l'EI en Irak
et en Syrie, elles sont bombardées quotidiennement par l’aviation turque. Cela
signifie aussi que les civils touchés par cette guerre n'ont plus d'électricité,
plus d'eau, plus d'hôpitaux, plus de téléphone, plus le droit de mettre le pied
dans la rues, etc.
 |
Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan,
est à la fois proche des États-Unis et des milieux islamiques radicaux.
D'ailleurs, le régime est accusé de complicité avec les djihadistes par de
nombreux d’observateurs : fourniture d’armes, transit du pétrole, soins des
blessés, soutien économique, laissez-passer à la frontière, etc. Ce double jeu,
longtemps ignoré et nié par les États-Unis et leurs alliés, de plus en plus
dénoncé. Sans une forte pression de la communauté internationale, la répression
sanglante du peuple kurde a peu de chances de s’arrêter, et ce, d’autant plus
que le président turc a déclaré ne vouloir ni processus de paix ni discussions
avec les «terroristes» kurdes. Pour le moment,
le gouvernement d’Erdoğan
ne semble pas enclin à laisser quelque liberté d’action que ce soit aux Kurdes
présents sur son territoire.
La Turquie a sombré dans la guerre civile.
C'est à nouveau l'impasse avec les
Kurdes. L'héritage laissé par Mustafa Kemal Atatürk pèse encore lourdement sur
la Turquie, du moins en ce qui concerne les Kurdes. Atatürk ne voulait rien savoir des Kurdes et de leur prétendue
autonomie; c'est pourquoi il a eu recours à l'armée pour les neutraliser. Près
d'un siècle plus tard, la Turquie mène le même combat rétrograde, autocratique
et antidémocratique. |
Le président Recep Tayyip Erdoğan semble exceller pour
amplifier la polarisation de son pays. Il s'agit pour lui de pousser ses
partisans à se dresser contre l’autre partie du pays: jouer les sunnites
contre les chiites, les Turcs contre les Kurdes, les religieux contre
les laïcs, puis souffler sur les braises d’un nationalisme fascisant.
Les opposants du président Erdoğan l'accusent d'atteintes aux libertés
individuelles, de mise au pas de la justice, d'attaques contre la presse
d’opposition, d'islamisation de la société, d'autoritarisme croissant,
de folie des grandeurs et de corruption (depuis le scandale de décembre
2013).
L'un de ses plus récents
thème de prédilection
concerne les femmes
et le planning familial. Le président turc estime qu'aucune famille
musulmane ne peut accepter la contraception et le planning familial; il
en appelle «aux mères pour accroître le nombre de Turcs». Par le passé,
il a déjà assuré que les femmes devaient avoir au moins trois enfants;
il a décrit l’avortement comme un «crime contre l’Humanité», mais il a
aussi dénoncé la «trahison contre des générations de Turcs» que
représente à ses yeux le planning familial. Évidemment, l'opposition et
les mouvements féministes turcs reprochent au régime du président
islamo-conservateur d’entretenir les violences contre les femmes avec
des préjugés religieux.
- La fierté linguistique
Le retour de la fierté linguistique — plutôt
l'«expansion» linguistique — fait aujourd'hui pleinement partie
du projet politique de l'AKP (en turc : Adalet ve Kalkınma Partisi
= Parti de la justice et du développement). La diffusion du turc dans le
monde est devenue un objectif avoué et poursuivi avec des moyens
soutenus. L'agence d'aide extérieure TIKA (en turc: Dirk ve
Koordinasen Ajan =
Agence de coopération et de coordination) mène à bien son projet de
«Turcologie» depuis 1999. Les instituts culturels Yunus-Emre, créés en
2007, ont pour mission officielle l'enseignement de la langue et la
promotion des arts et de la culture turque à l'étranger. Il en existe à
l'heure actuel 45 dans 34 pays, mais l'objectif officiel est de se
rendre à au moins une centaine de centres actifs d'ici à 2023. Le réseau
des écoles de Fethullah Gülen a aussi pleinement participé à cet effort
national linguistique entre 2003 et 2014, avant le conflit avec l'AKP
qui les a marginalisées dans le dispositif de la diplomatie informelle
turque.
- Le coup d'état raté de
juillet 2016
C'est pourquoi le coup d'état raté de juillet 2016 n'a
pas surpris grand monde en Turquie, même si la planète entière s'en est
inquiétée. La méfiance profonde que se vouent mutuellement le président
du pays, Recep Tayyip Erdoğan, et les forces armées turques, longtemps
toutes-puissantes dans le pays, n’est un secret pour personne. Lorsqu’il
a pris le pouvoir en Turquie en 2003, Erdoğan avait promis de retourner
les militaires dans leurs casernes en les excluant du pouvoir politique.
Or, selon le modèle turc hérité de l'époque de Mustapha Kemal Atatürk, l’armée joue le rôle de garant de la stabilité
et de la laïcité dans le pays, un concept rejeté aujourd'hui par le parti islamo-conservateur d’Erdoğan.
Du fait que le pays souffre d'une très mauvaise économie attribuée à
l'escalade de la violence avec les Kurdes, aux attentats terroristes et
à la menace djihadiste, à l'afflux des réfugiés et à l’évaporation des touristes, le moment semblait
propice pour que l'armée, fidèle à son habitude, intervienne pour
rétablir l'ordre, comme elle l'a fait en 1960, en 1971, en 1980 et en
1997.
Le président Erdoğan s'est retrouvé renforcé par l’échec
des putschistes, mais il faudrait qu'il se rende compte que la façon dont il
gouverne le pays est également une source de divisions au sein du peuple
turc, bien qu'il bénéficie de beaucoup d'appuis auprès des musulmans
pratiquants, lesquels ont eu le sentiment d'être marginalisés par le passé en
raison de l'influence des militaires sur les précédents gouvernements.
Le régime du président Erdoğan est marqué par des scandales de corruption et aussi
par une tactique politique de plus en plus visible qui ne manifeste par
des restrictions sur la liberté d'expression et de la presse, des
licenciements abusifs de magistrats et de dirigeants militaires, des
violences et l'usage excessif de la force, des détentions illégales, la
torture, la chasse aux Kurdes, etc. Cette dérive politique autoritaire
semble être devenue le symbole de mobilisation qui caractérise désormais
la société turque.
De fait, comme il fallait s'y attendre, non seulement
l’armée n’a pas été épargnée par les purges après le putsch avorté, mais
la purge s'est généralisée et est devenue une épuration dans
l'administration publique, les universités, les stations de radio et les
chaînes de télé. Selon un comptage de l’AFP, au moins 25 000
fonctionnaires, dont plusieurs milliers de policiers et de gendarmes et
des enseignants, ont été suspendus ou démis dans cette chasse nationale.
De toute évidence, le gouvernement Erdoğan n’a toujours
pas compris qu’un malaise profond traverse la société turque et qu’il ne
pourra pas le surmonter en mobilisant ses partisans et en recourant
constamment à la théorie du complot.
- Un gouvernement islamiste et corrompu
Le gouvernement islamiste et corrompu de Recep Tayyip Erdoğan est
contesté par beaucoup de Turcs. À la faveur de diverses crises, le
président Erdoğan a imposé un programme islamiste. En bon dictateur, il
a réussi à cumuler les pouvoirs grâce en partie à la tentative ratée de
coup d'État, lequel a servi de prétexte pour emprisonner les leaders
d'opinion qui lui sont hostiles et pour instaurer un régime de terreur.
Six mois plus tard, quelque 110 000 personnes avaient perdu leur emploi
ou avaient été suspendues parce qu'elles ont été soupçonnées d'avoir
participé au coup d'État. Dix-neuf universités ont été fermées, quatre
chercheurs et plus de 400 étudiants ont été jetés en prison pour délit
d'opinion. Plus de 170 journaux, radios, chaînes de télé ont été fermés.
Il en résulte aujourd'hui qu'il n'y a plus de liberté de parole en
Turquie.
Pour en revenir aux Kurdes, le président Erdoğan a
élaboré une propagande ultranationaliste qui le rend populaire auprès de
certaines parties de la population. Ainsi, Erdoğan a déclaré que la
ville de Mossoul avait déjà été sous le contrôle des Turcs (il y a plus
d'un siècle). Du même souffle, Erdoğan a demandé que les Turcs
participent à la libération de Mossoul, ce qui a été refusé par l'Irak.
Néanmoins, la Turquie a envoyé des troupes en Irak et en Syrie contre la
volonté des gouvernements de ces deux pays.
 |
Évidemment, peu
d'informations filtrent en provenance des territoires kurdes
de Turquie. Les journalistes étrangers n'y sont pas admis.
Mais les destitutions de maires kurdes, les attentats kurdes
en Turquie et l'histoire récente laissent présager qu'une
situation épouvantable règne dans ces régions. Les massacres
de Kurdes se succèdent les uns aux autres.
N'oublions pas que l'armée
turque est considérée comme la 10e
armée la plus puissante au monde. Une fois l'État islamique
neutralisé, la Turquie voudra mâter les Kurdes établis au
sud de sa frontière. Qui l'empêchera de le faire? Les
Américains et leurs alliés protègent les Kurdes parce qu'ils
sont les meilleurs combattants contre l'État islamique.
Vont-ils risquer une rupture avec la Turquie? Si le
gouvernement turc poursuit ses politiques de répression, c'est
pourtant ce qu'il faudrait faire. Parce que personne ne peut
rien attendre de bon de la part d'un pays islamiste,
corrompu et qui terrorise et manipule sa population.
Signalons que, le 24 juin 2016, le Parlement turc a voté
l’immunité des poursuites judiciaires pour les membres des
forces armées, et ce, pour l'ensemble des actes commis dans
le cadre des opérations militaires au Kurdistan turc.
|
Le 16 avril 2017, le président Recep Tayyip Erdoğan
a organisé un référendum qui proposait d'instituer un régime
présidentiel au lieu d'un régime parlementaire. L'objectif d'Erdoğan
était de restaurer la gloire de l'Empire ottoman en se dotant des
pouvoirs accrus. La victoire à l'arraché au référendum du 16 avril
va probablement polariser la société turque : les deux partis
politiques qui se sont prononcés en faveur du référendum auraient
normalement dû récolter plus de 60 % des voix. Ils n'en ont obtenu
que 51,3 % et n'auraient pas dépassé la majorité si les bulletins de
vote non scellés n'avaient pas été comptés.
Les objectifs évidents du président Erdoğan sont de
détruire complètement toute forme de gouvernement kurde non
seulement en Turquie, mais aussi en Syrie. Il a même déclaré qu’il
n’hésiterait pas à envoyer ses troupes jusqu’à la frontière
irakienne. En fait, Erdoğan semble caresser le rêve de reconstruire
l’Empire ottoman, lequel étendait ses frontières sur l’Irak et la
Syrie et qui faisait la promotion d’un islam intolérant. C'est ce
qui explique aussi la «christianophobie» institutionnelle dont on
accuse la Turquie. L'Union européenne a d'ailleurs averti le
gouvernement turc que la liberté religieuse appliquée en Turquie ne
répondait pas encore aux critères fixés par l'Europe.
En juin 2018, Le chef de l’État turc a été réélu dès
le premier tour pour un nouveau mandat aux pouvoirs renforcés. En
effet, sa victoire aux élections de 2018 assoit encore son pouvoir,
car le scrutin marque le passage du système parlementaire en vigueur
à un régime présidentiel où le chef de l’État concentre la totalité
du pouvoir exécutif, aux termes d’un référendum parlementaire qui
s’est tenu l’année précédente. La réforme constitutionnelle prévoit
le transfert de tous les pouvoirs exécutifs au président, qui pourra
nommer les ministres et de hauts magistrats, décider du budget et
gouverner par décrets; la fonction de premier ministre est
supprimée.
La Turquie se retrouve à la croisée des
chemins. C'est aujourd'hui un système présidentiel dans lequel le
pouvoir est de plus en plus centralisé entre les mains d’une seule
personne. C'est un État dans lequel des dizaines de journalistes et
des centaines d’opposants politiques sont actuellement emprisonnés.
C'est un allié occidental qui bloque l’adhésion de la Suède à l’OTAN
et qui ménage à la fois ses relations avec la Chine, l’Arabie
saoudite, la Russie et l’Ukraine. C'est aussi un système
parlementaire dans lequel le Parlement n’a pas d'emprise, la justice
n’est pas indépendante et la presse est muselée. Le régime laïc
hérité de Mustafa Kemal Atatürk semble
volatilisé pour le moment afin de faire place à un régime
autoritaire et impérial. La nostalgie de l'Empire ottoman s'affiche
sans détour. Le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan a mis au pas
l'armée, s'est rapproché de l'Iran et s'est éloigné de l'Europe.
Atatürk et Erdoğan sont mûs par le même nationalisme, même si les
moyens pour atteindre leur but sont opposés.
De plus, en mai 2023, le
président Erdoğan a démenti les médias occidentaux qui, prenant
leurs désirs pour la réalité, avaient parié sur sa défaite
électorale. La victoire de son parti aux législatives du 14 mai et
sa réélection à la présidence le 28 mai vont vraisemblablement aggraver l’isolement avec l’Union
européenne, déjà confrontée à la guerre du président russe
Vladimir Poutine. L’un et l’autre semblent avoir ambitionné de
restaurer la grandeur des deux grands empires dont la Russie et la
Turquie sont les héritières : l’Empire
des tsars et l’Empire
ottoman.

Les actes de répression sanglants forment un chapitre
peu
glorieux de l'Histoire de la Turquie. On peut regretter que la
naissance de ce pays se soit faite de façon aussi violente, soit en éliminant ou
en tentant d'éliminer les minorités arméniennes, grecques, arabes, kurdes et
juives. Paradoxalement, sans cette violence, jamais ce pays n'aurait atteint cette unité ethnique
et cette commune vision morale, qui ont contribué à la renaissance turque.
Quoi qu'il en soit, l'épuration ethnique a entraîné des
conséquences linguistiques importantes. En éliminant les minorités arméniennes
et grecques, en matant les communautés kurdes, la Turquie se transformait en une
société homogène, à la fois totalement de langue turque et de religion musulmane, tout en restant la
première république musulmane laïque. Tout compte fait, l'épuration ethnique
faisait partie d'un programme visant à implanter durablement la langue turque au sein
de la société anatolienne. Sans des mesures autoritaires et répressives, la Turquie de Mustafa Kemal
Atatürk n'aurait jamais pu entreprendre une réforme orthographique aux
répercussions sociales et politiques aussi profondes. Mais le prix pour
atteindre cet objectif fut très élevé, surtout quand on apprend le sort qui
attendait les minorités nationales: les Grecs, les Arméniens, les Kurdes et les
Arabes. L'Histoire de la Turquie montre en même temps que
la langue peut servir d'instrument puissant à une élite pour imposer sa domination.
En ce qui concerne la question kurde, la Turquie a encore
bien des efforts à faire si elle veut parvenir à régler un problème vieux d'un
siècle. Elle n'y parviendra pas en cherchant des solutions cosmétiques
destinées à apaiser les revendications kurdes ou, pire, en recourant à la
répression systématique. Il faudra plus que cela, car il faudra consentir enfin à ramer dans le sens du courant.
Or, la Turquie n'en est pas encore là, et ce, d'autant plus qu'elle
considère que tous les Kurdes sont des terroristes. Pourtant, il faudra bien que ce pays remette en question ses mauvaises relations
avec ses minorités, surtout les Kurdes, et reconsidère son passé passablement sanguinaire. Chose certaine,
les 15 millions de Kurdes de Turquie ont le droit de vivre comme les
turcophones. Mais les politiques d'assimilation vont à l'encontre du droit des peuples à la
vie et à leur pleine autodétermination.
Si la Turquie persiste dans cette
voie de la liquidation des Kurdes, il ne restera plus aux pays occidentaux
qu'à soutenir la création d'un État kurde puissant au grand dam des
autorités turques. Le conflit syrien a remis au goût du jour la question de
la création d'un Grand Kurdistan au Proche-Orient. Les Kurdes sont néanmoins
conscients qu’un Grand Kurdistan n'est pas possible pour le moment, mais ils
pourraient aspirer à des «provinces fédérales» plus autonomes au sein des
frontières de leur pays. Cette solution permettrait la résolution d’un
conflit de longue date né de la revendication d’un peuple dispersé sur
plusieurs États sans violer le principe d’intangibilité des frontières.
Toutefois, le scénario d’une autonomie en douceur semble pour l'instant
impossible en Turquie et en Iran, les gouvernements de ces deux pays étant
très forts au point de vue politique et institutionnel. À l'heure actuelle, sous la présidence d'Erdoğan, la
Turquie a régressé sur plusieurs fronts. Ses institutions s'écroulent,
ses universités sont devenues dysfonctionnelles, ses médias sont
pratiquement muselés, l'économie est en recul, les rapports avec
l'Europe se dégradent et le problème interne avec les Kurdes refait
surface. Recep Tayyip Erdoğan orchestre cette régression et la
Turquie va tôt ou tard en payer le prix.
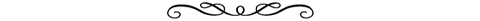
Dernière mise à jour:
10 déc. 2024
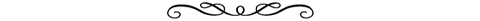
La Turquie
Kurdistan